L’État pèse trop lourd, mais combien pèse-t-il ?, par Philippe Kaminski.
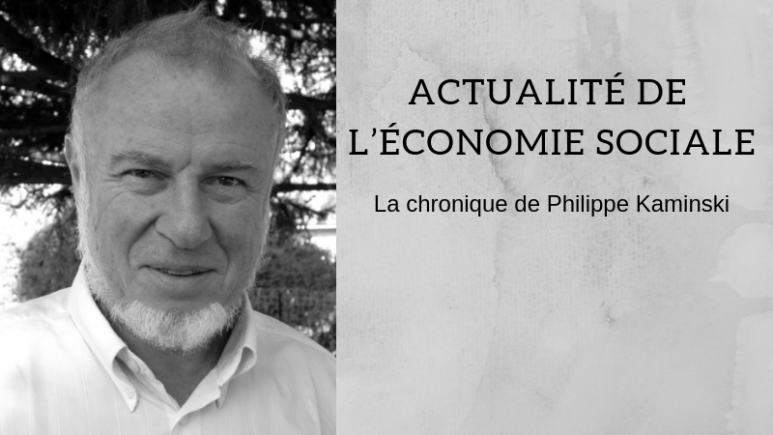
Source : https://www.profession-spectacle.com/
Avec la crise sanitaire et le confinement, le PIB annuel va chuter dans des proportions jamais vues, tandis que la dépense publique, elle, aura fortement augmenté. Mais ne faisons pas dire aux chiffres qu’on ne manquera pas de nous répéter au fil des mois, ce qu’ils ne disent pas. Explications.
Actualité de l’économie sociale
Je suis souvent amené à déplorer la trop grande prépondérance de l’État dans notre économie et dans notre société. Je n’en fais ni un dogme, ni une fixation, comme certains apôtres acharnés d’un libéralisme absolu ; mais il faut bien convenir que les occasions de stigmatiser notre État omniprésent, obèse et inefficace sont assez nombreuses et touchent à tous les aspects de notre existence.
Les comparaisons internationales, à qui on peut faire dire tout et son contraire, placent la France aux tous premiers rangs selon le « degré de socialisation de l’économie ». Fort bien mais de quoi s’agit-il ? Sait-on effectivement « mesurer » l’emprise de l’État ? Et comment juger de ses performances ? Comment savoir s’il fait mieux, ou moins bien, que ne le ferait un acteur privé ?
On entend souvent dire qu’il est urgent de « réduire la dépense publique » et de la limiter aux « domaine régalien ». Fort bien. Prenons au hasard un paquet de cent milliards de dépense publique, par exemple la santé, et privatisons tout ça. La Nation, ou la population, se sera-t-elle enrichie de cent milliards ? Bien sûr que non ; ce que nous n’aurons plus à payer par nos impôts, nous le payerons autrement. Tout au plus pourra-t-on arguer que nous saurons nous montrer plus économes de nos propres sous que ne l’est un État prodigue et dispendieux, et qu’une offre médicale privée sera mieux gérée et plus efficace que des structures publiques lourdes et bureaucratiques. Cela se défend, mais ce n’est pas garanti ! Et même en postulant, avec beaucoup d’optimisme, que nous y gagnerions 10 % de productivité, la nation y aura gagné dix milliards, pas cent.
Ce n’est donc pas tant le volume des dépenses qui importe, car en les transférant ailleurs on n’y gagnera au mieux que des montants de second ordre. Il faut sans doute porter davantage l’analyse sur le plan de l’autonomie des citoyens, de leur désir et de leur capacité à maîtriser une part plus grande de leurs activités de production comme de consommation en « retirant » celles-ci du giron protecteur de la puissance publique. Sur ce point, l’Économie Sociale est au cœur de la solution du problème, bien mieux que ce qu’on entend généralement par « le secteur privé ». Mais on se heurte alors frontalement à deux écueils. D’abord le fait qu’une grande partie de la population ne demande pas mieux que de continuer à se laisser materner par un État qui en veut toujours plus, ensuite parce qu’on quitte alors le monde des grandeurs facilement mesurables et compréhensibles, comme les milliards du budget de la Santé, pour celui plus subtil de données qualitatives et subjectives.
Contentons-nous dès lors, dans un premier temps, de chercher à comprendre ce que recouvrent les agrégats macroéconomiques les plus fréquemment mis en avant.
Deux indicateurs se sont imposés, que ce soit auprès des commentateurs réputés spécialisés ou du grand public. Il s’agit d’abord du ratio des prélèvements obligatoires au produit intérieur brut (PIB), puis du ratio des dépenses publiques au même PIB. Le premier tournait, les années passées, autour de 45 %, le second autour de 56 %. Je remarque, de plus en plus souvent, une tendance à prendre le chiffre le plus élevé, donc le second, pour lui donner le sens le plus parlant, c’est à dire le premier, entendu comme « les richesses produites par le valeureux secteur privé qui s’en fait dépouiller par un État prédateur ». À cela d’autres répondent que l’État aussi produit de la richesse, et de meilleure qualité puisqu’elle sert l’intérêt général, et qu’il lui est donc légitime de prélever le fruit d’activités qui ne servent que des intérêts particuliers. Encore heureux qu’il n’en prenne pas davantage.
Ces deux positions opposées sont également caricaturales mais les débats ne vont généralement pas plus loin. En particulier, il serait utile de chercher à s’entendre sur ce que serait un niveau optimal de prélèvement, et quel sens lui donner, assez pour financer le secteur public, pas trop pour ne pas asphyxier l’entreprise privée. Faute d’investir dans ce genre de réflexion, on se contente de fixer le « trop » et le « pas assez » en référence à ce qui se fait dans d’autres pays, ce qui ne mène pas loin.
Qu’est-ce qui sépare nos deux indicateurs ? Les 45 % de recettes publiques obligatoires vont bien entendu contribuer au financement des 56 % de dépenses publiques, mais d’où viennent les 11 % restants ? Eh bien il y a d’abord des recettes de production, c’est à dire tout ce qui est vendu ou retenu (ticket modérateur, forfait hospitalier…) par un organisme public. Je n’en ai pas trouvé de liste précise, mais ça va chercher tout de même dans les 90 milliards. Il y a ensuite des recettes de propriété, dont les dividendes perçus et les privatisations, et d’inévitables divers. Tout cela fait beaucoup mais le compte n’y est toujours pas ; le reste, c’est le fameux déficit, qu’on s’est engagé à tenir en dessous de 3 %, qu’il faut combler par des emprunts et qui alimente la progression de la dette.
Mais que l’on prenne 45 % ou 56 %, j’estime que l’un et l’autre de ces indicateurs sont trompeurs. Si je vous dis que le Mont Blanc représente 54 % de Everest, j’aurais raison dans la mesure où ma division est juste. Mais j’aurais tort car l’Everest n’est pas constitué du Mont Blanc et de 46 % de je ne sais quoi. Le rapport de la dépense publique au PIB est de même nature. Quand un journaliste écrit que « l’État dépense à lui seul 56% de la richesse nationale », il sous-entend fortement que le secteur privé et les ménages n’ont que les 44 % qui restent à se partager, ce qui est absurde. En effet la dépense publique n’est pas plus un morceau du PIB que le Mont Blanc n’est un morceau de l’Everest. Le ratio au PIB n’est calculé que pour avoir un ordre de grandeur, et permettre les comparaisons internationales et un suivi dans le temps, mais ne doit pas être interprété au-delà.
Le PIB est très critiqué, parce qu’on voudrait lui faire dire plus qu’il ne peut. C’est très frustrant et cela dure depuis les origines. Frustrant comme peuvent l’être les lois élémentaires de la physique ; on aimerait aller contre, on aimerait s’en affranchir, mais c’est impossible. Dans le PIB, chaque événement créateur de richesse n’est comptabilisé qu’une seule fois ; or toute transaction économique met en scène deux agents, l’acheteur et le vendeur, et on ne peut les compter tous les deux. Prenons le cas d’une entreprise de travaux publics cotée en Bourse qui va réaliser un gros chantier pour l’État. Cette opération relève-t-elle du secteur privé, le vendeur, ou du secteur public, l’acheteur qui finance ? À l’évidence, des deux. Or elle ne sera comptée qu’une fois dans le PIB. Mais selon la manière dont on analysera les composantes de ce PIB, elle pourra être vue comme dépense publique, et donc donner consistance à l’image d’un État omniprésent et prépondérant, ou comme une production privée, et conforter alors l’idée d’une puissance sans limite des grands groupes capitalistes. Chacun y trouvera matière à étayer ses arguments.
Or il y a trois manières de décomposer le PIB, ce qu’on appelle l’approche production, l’approche demande finale et l’approche revenus. Chacune donne lieu à une représentation différente du poids de l’État. Bien sûr elles ne s’opposent pas ; elles sont complémentaires, mais elles ne se ressemblent pas et ne disent pas la même chose.
Il faut tout d’abord s’entendre sur ce que, dans le calcul du PIB, on désigne sous le nom d’État, plus exactement d’APU, pour « Administrations Publiques » (car l’équilibre entre le langage courant et le sabir de la comptabilité nationale est un exercice périlleux). On confond trop souvent État et gouvernement, État et administration, État et secteur public, État et centralisation (ou jacobinisme), État et bureaucratie, État et personnel politique… Or en économie, on a besoin de définitions précises et internationales. Les APU rassemblent donc, outre l’État central proprement dit, les collectivités territoriales, les institutions de Sécurité Sociale (au sens large, comprenant l’assurance chômage) et les ODAC, conglomérat de plusieurs centaines d’organismes comme par exemple, dans la culture, les musées nationaux et les théâtres nationaux.
Selon l’approche du PIB la plus communément utilisée, celle des utilisations finales de l’ensemble des biens et services produits par l’économie, la part des APU ressort à 27 % :
– consommation finale des ménages (ce que vous et moi avons acheté pendant l’année) : 53 %
– dépense nette des APU : 27 %
– investissements des entreprises : 13 %
– investissements des ménages (logement) : 5 %
– divers (associations, variation des stocks, solde du commerce extérieur) : 2 %
Ces 27 % des APU se décomposent à leur tour ainsi :
– 57 % pour les services non marchands dits individualisables (notamment éducation et santé) ;
– 30 % pour les services non marchands dits collectifs (défense, sécurité intérieure, justice…) ;
– 13 % pour les investissements publics (équipements et bâtiments).
L’approche selon la production conduit également à un chiffre de 27 %, mais de nature différente :
– valeur ajoutée des entreprises (sociétés, financières et non financières) : 61 %
– valeur ajoutée des APU : 16 %
– solde des impôts sur les produits (TVA) et des subventions sur les produits : 11 %
– valeur ajoutée des ménages : 8 %
– valeur ajoutée des entrepreneurs individuels : 4 %
sachant que la valeur ajoutée des ménages contient cette bizarrerie comptable que sont les loyers fictifs imputés aux propriétaires de leur logement.
L’approche par les revenus, généralement interprétée comme indicateur du partage entre revenus du travail et revenus du capital, donne un chiffre de moitié inférieur :
– rémunération brute des salariés : 52,5 %
– excédent brut d’exploitation des entreprises : 34 %
– impôts sur la production et les importations, moins subventions : 13,5 %
Le chiffre pour les entreprises contient le « revenu mixte » des entrepreneurs individuels. Une indication complémentaire permet de mieux situer le poids des APU dans les revenus des personnes physiques : 75 % de la masse des salaires bruts sont distribués par les entreprises, contre 25 % par les APU (la comptabilité nationale ne permet pas de distinguer ici la part de l’Économie Sociale, qui revendique environ 15 % des salaires du privé).
Ces chiffres peuvent être complétés à l’infini par tous les ratios qu’on voudra, mais ce sont les seuls pour lesquels le haut de la fraction est effectivement une partie du bas et où chaque élément n’est compté qu’une seule fois. On est loin des 45 % ou 56 %. Ceci étant, 27 % c’est considérable ! Mais cela ne préjuge en rien de l’utilité de la dépense publique, ni de l’équité de la répartition de la charge de l’impôt entre les contribuables.
La question de savoir ce qu’il en sera pour 2020, après l’épreuve du confinement qui aura provoqué une chute encore jamais vue du PIB, est sur toutes les lèvres. Cela dépendra bien entendu de l’ampleur du rattrapage qu’il sera possible d’effectuer au cours du second semestre.
Le PIB annuel va chuter, les prélèvements obligatoires aussi, je ne sais lequel l’emportera sur l’autre, mais il est vraisemblable que le ratio de 45 % variera peu. Ce qui est certain en revanche, c’est que la dépense publique aura fortement augmenté, propulsant son ratio au PIB à des niveaux encore jamais vus. Cela sera-t-il cependant représentatif du considérable mouvement d’étatisation qu’aura provoqué le coronavirus ?