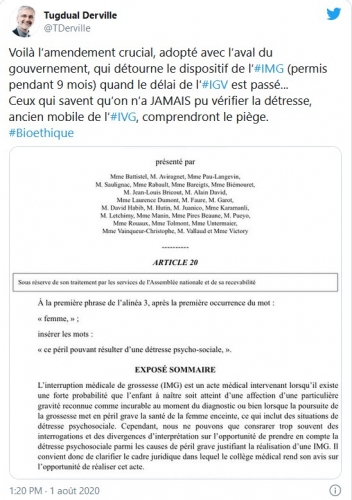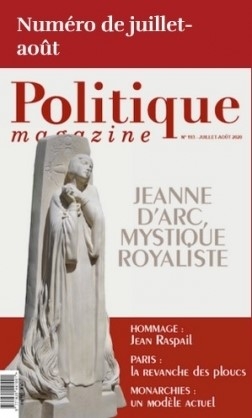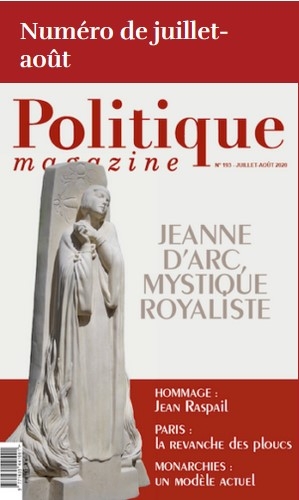Black Lives Matter à la sauce antifa ou le dernier épisode en date d’une longue liste de crises de folies sociétales amé

Aux États-Unis, d'épisodiques crises de folie sociétale 1
Puritanisme et néo-inquisition : l'hystérie politiquement-correcte plonge la superstructure des États-Unis, notamment son infosphère 2, dans d'épisodiques crises d'une épilepsie sociétale mal comprise, vu d'Europe.
Voici déjà un quart de siècle, le journaliste-star américain Edward Behr avertit que si cela s'aggrave - et ça s'est aggravé - "l'Amérique deviendra non seulement ingouvernable, mais aussi, pour ceux qui ignorent encore ces changements radicaux, totalement imprévisible". Behr conclut prophétiquement "Je vois monter une nouvelle intolérance, un nouvel appel à la violence entre hommes et femmes et une très étrange tendance à l'autocensure dans ce pays où la liberté de l'information est sacrée. Je vois en somme une Amérique nouvelle, porteuse de fausses idéologies prêtes à contaminer le reste du monde. Je souhaite vivement me tromper".
Behr ne se trompait pas du tout et ce qu'il voyait alors de ses yeux n'était que l'amorce de la présente crise délirante US genre Antifa-Black Lives Matter :
- Hystérie puritaine : en 1980 (Pocket Books) paraît "Michelle remembers", livre dans lequel Michelle S. révèle avoir "récupèré" des souvenirs occultés de son enfance ; ceux de messes noires et rituels sataniques perpétrés dans son village, où "plus de 1 000 individus adhèrent à l'église de Satan". Dès son sous-titre ""L'histoire vraie d'une femme qui, encore enfant, fut livrée à l'Antéchrist", le bouquin pue le canular à plein nez - mais non, toute l'Amérique du Nord, Canada inclus, embraye.
Désormais adulte, Michelle "en transe", décrit d'une voix de fillette, "Le diable et ses longues jambes, ses drôles d'orteils, qui me brûle le cou avec sa queue"... Dans le plus charitable des cas, c'est un reflux inconscient du film Rosemary's Baby (sorti aux États-Unis en septembre 1968). Sous hypnose, Michelle décrit force viols, tortures et homicides ; puis dénonce sa propre mère (morte en 1964). En 1983, sous le fouet des médias, l'Amérique s'enflamme pour ces Satanic Ritual Abuse (SRA) affectant - croit-on alors - les classes moyennes blanches suburbaines.
Un État après l'autre en fait un chef d'inculpation formel - 63 cas de SRA au seul comté de Los Angeles en 1983-84... 50 000 enfant par an disparaitraient aux États-Unis, s'affolent alors les médias. À la fin, le FBI enquête avec le National Center for the Analysis of Violent Crime : de 1983 à 1990, le pays compte, par an, de 52 à 158 disparitions inexpliqués de jeunes, aux 2/3, des fugueurs. Bien entendu, nulle trace de quelque "réseau satanique" que ce soit.
- Hystérie puritaine encore : l'affaire de la "mémoire récupérée" (Recovered Memory). À l'origine, Lenore T., jeune femme perturbée, toxicomane, suicidaire, écrit deux livres "Too scared to cry" (1990) et "Unchained memories" (1994) où elle prétend avoir vécu des horreurs dans son enfance, sa mémoire traumatisée alors occultée, mais récupérée à l'âge adulte, grâce à un psychiatre 3. Son premier livre à peine paru, l'Amérique s'embrase derechef : dès janvier 1991, George F., père de Lenore T., est condamné à la prison à vie pour homicide, sur l'unique base de la "mémoire récupérée" de sa fille, prétendant qu'il a sous ses yeux "violé et tué une de ses petites copines", quand elle était enfant.
Lors de ces procès - qui ensuite se multiplient bien sûr - le contenu des charges "obtenues par thérapie" est caché à l'inculpé - secret médical oblige, "les révélations pouvant compromettre la guérison du sujet". Procédé qui renvoie les inquisiteurs dominicains et Andreï Vichinsky (procureur des procès de Moscou) au rang de pâles amateurs. Dans ces procès - nous sommes dans la décennie 1990 - nul témoignage n'est admis hors celui des "victimes". Le "politiquement-correct" oblige à croire les enfants, les femmes et toutes victimes, donc à gober aveuglément les "diagnostics" de "thérapeutes"-gourous-escrocs, dans un phénomène vite proliférant. En 1989 encore, Oprah Winfrey invite la fameuse "Michelle" dans son émission et reprend ses propos démentiels comme vérité du Bon Dieu.
Ceux qui témoignent à décharge sont férocement poursuivis. Dénoncé en août 1991 par de petites hystériques (Salem, encore et toujours), un directeur d'école maternelle californien est condamné à 89 fois la prison à perpétuité, sans nulle preuve concrète. Excités par les médias, les parents des "victimes" en rajoutent. Un jury écoute pieusement une agitée "se souvenir" d'une de ses amies de maternelle dévorée vivante "par un requin dans une mare" et condamne ensuite l'auteur du crime.
Pour la New York Review of Books - référence s'il en est 4 - les États-Unis connaissent, depuis la décennie 1980, un million de cas de "mémoire récupérée" portant sur des abus sexuels, ayant déclenché ± 500 000 enquêtes de police. Apogée sous la présidence du "progressiste" Bill Clinton (1993-2000), dont la ministre de la Justice, la fanatique féministe et ex-procureur Janet Reno, croit dur comme fer aux témoignages (féminins) de "mémoire récupérée".
Dans la société de l'information, qui résiste de front à un tsunami médiatique ? Le temps passant, vient le moment où quand même, des journalistes enquêtent ; pour la "mémoire récupérée", le pot-aux-roses se découvre en 1990-1994 : bien sûr, tout était bidon. Incarcérés depuis parfois des années, des innocents sont libérés avec de vagues excuses ; voire une maigre compensation financière.
Cela assagit-il l'Amérique ? Du tout.
Avez-vous apprécié les Satanic Ritual Abuse ? Aimé la Recovered Memory ? Vous adorerez la lubie suivante, le Multiple Personality Disorder, ou MPD. Dans la décennie 1990, d'autres psychiatres (facétieux ou délirants) font gober aux magistrats que leurs clients possèdent certes, une unique enveloppe charnelle, mais des "personnalités multiples". Au Wisconsin, un inculpé d'un procès dépose ainsi à la barre "en tant que chien". En mai 1994 en Arizona, un violeur en série débarque avec ses "11 personnalités", dont celle du jour : la "prostituée lesbienne". Le juge, à qui l'hurluberlu explique d'abord qu'il voulait venir en robe, mais qu'en ce cas, il "rate la cuvette quand il va aux toilettes" ; l'autorise gentiment à comparaître en perruque, collant rose et hauts talons. 5.
1 Edward Behr "Une Amérique qui fait peur", Plon, 1995 - livre qui significativement, n'a jamais été publié en anglais aux États-Unis, quoi que l'auteur soit lui-même Américain.
2 Pour le sociologue Michel Maffesoli, l’infosphère assemble, en haut de la société, ceux qui monopolisent la parole dans les médias, d'usage propriété de milliardaires : élites du faire, élus, hauts fonctionnaires, grands patrons (industrie, finance) ; et du dire, savants, intellectuels, écrivains, magistrats, journalistes.
3 Autres chefs-d'œuvre de la bibliothèque "mémoire récupérée" (inceste, viols et homicides infantiles, etc.) 'The Courage To Heal" Harper & Row, NY, 1988 ; "Secret survivors", Ballantine, NY, 1990 ; "Repressed memories", Simon & Schuster, NY 1992 ; "Escaping the shadows, seeking the light", Harper, San Francisco, 1991 - tous chez de grands éditeurs, qui les vendent comme des petits pains.
4 "The revenge of the repressed", New York review of Books, 17/11/1994.
5 Si le lecteur trouve que l'auteur exagère, il lira avec bonheur, dans le fort grave Journal of Forensic Psychiatry (Routledge - Taylor & Francis Group) l'article du 4 janvier 2008 "Multiple personality disorder in the courts: a review of the North American experience", 20 pages serrées du plus accablant feu d'artifice de pitreries judiciaires, pouvant à elles seules fournir vingt scénarios de sketches au Monty Python.