ESPÉRER ET LUTTER

par François Marcilhac
 Il y a « une ligne infranchissable : l’Etat de droit » : les Français peuvent être rassurés. Notre Premier matamore, dans un entretien au Monde, a défini, le 29 juillet dernier, la frontière qu’il ne saurait être question de franchir en Hollandie pour lutter contre le terrorisme islamique. C’était trois jours seulement après l’égorgement rituel d’un prêtre célébrant la messe, dans la banlieue de Rouen ; quinze jours après le massacre de Nice, qui avait fait quatre-vingt-quatre morts.
Il y a « une ligne infranchissable : l’Etat de droit » : les Français peuvent être rassurés. Notre Premier matamore, dans un entretien au Monde, a défini, le 29 juillet dernier, la frontière qu’il ne saurait être question de franchir en Hollandie pour lutter contre le terrorisme islamique. C’était trois jours seulement après l’égorgement rituel d’un prêtre célébrant la messe, dans la banlieue de Rouen ; quinze jours après le massacre de Nice, qui avait fait quatre-vingt-quatre morts.
Certes, l’immense écho rencontré dans la société française par l’assassinat d’un prêtre en pleine messe a révélé combien celle-ci est encore marquée par le catholicisme, ce qui, au milieu de la douleur et par-delà la légitime colère, est un signe d’espérance. Car si toutes les victimes de l’islamisme ont, en tant que telles, un droit égal au respect, le fait que, symboliquement parlant — et nous employons cet adverbe à dessein —, l’assassinat d’un prêtre soit ressenti dans sa dimension spécifique et ait même contraint, ne serait-ce que pour des raisons politiques, François Hollande à se rendre à Notre-Dame de Paris, montre combien notre pays est toujours marqué, dans son essence même, et en dépit de tout, par le baptême qui fut à l’origine de sa naissance.
On peut évidemment penser à Paul Reynaud faisant la même démarche en pleine débâcle, le 19 mai 1940, à la tête du gouvernement. Et s’il est vrai que nous n’avons à opposer que ces mantras que sont la « démocratie » et l’ « Etat de droit » comme armes de destruction massive aux cinquièmes colonnes de l’Etat islamique tapies dans « nos quartiers » et prêtes à intervenir sur simple injonction, alors c’est aussi la figure du général Gamelin qui nous vient à l’esprit. Car comment lutter, en se contentant d’invoquer une telle ligne Maginot intellectuelle et morale, contre cet ennemi intérieur que quatre décennies de folle politique migratoire a introduit chez nous, et qu’une politique extérieure erratique a conduit à se révéler comme tel ? D’autant que c’est au nom de ces mêmes principes que la droite puis la gauche ont déstabilisé la Libye et aidé à la déstabilisation du Proche-Orient, libérant un monstre islamiste qui ne demandait pas mieux pour surgir de ténèbres... fort peu épaisses.
Qu’on ne s’y trompe pas ! Nous ne réclamons pas la disparition de nos libertés fondamentales, même si nous envisageons comme intellectuellement possible une restriction temporaire de l’exercice de certaines d’entre elles, comme cela s’est toujours pratiqué en temps de guerre. Encore faut-il avoir un État à la fois capable de prendre ces mesures et de le faire dans le seul souci du Bien commun. Comme le rappelait Jacques Sapir dans nos colonnes, fin juin, la dictature, à Rome, était une magistrature peut-être exceptionnelle, mais, comme telle, conforme à l’ « Etat de droit » — il en est ainsi, sous la Ve république, de l’article 16, de la loi martiale,... et de l’état d’urgence.
 Du reste, si celui-ci est devenu une mascarade dans la lutte contre les islamistes, puisque tous les terroristes qui sont passés à l’acte étaient connus de nos services de renseignement, il n’est pas impossible que l’exécutif ne finisse par s’en servir dans son propre intérêt, c’est-à-dire contre les patriotes, surtout si, à la faveur de nouveaux massacres, il le prolonge en 2017, année électorale. Dans Le Figaro des 30 et 31 juillet, Natacha Polony n’hésite pas à demander : « n’est-ce pas ce que certains espèrent : l’action folle d’un militant d’extrême droite, ou d’un simple citoyen indigné perdant son sang-froid, qui permettrait de brandir le spectre du racisme et de réduire au silence aussi bien les candidats à la primaire de la droite [...] que les intellectuels courageux » — au rang desquels elle se place — « qui appellent à la résistance par la laïcité, l’intégration et la transmission » ? On a tout lieu de le craindre lorsqu’on entend Manuel Valls ou tel autre hiérarque socialiste reprocher à la droite parlementaire d’être en voie de « trumpisation » quand elle propose pour lutter contre le terrorisme islamiste des mesures « démagogiques » qui s’affranchirait du sacro-saint « État de droit ». La ficelle est un peu grosse, mais que ne peut-on pas faire avaler à un peuple que de nouveaux attentats traumatiseraient gravement ? La majorité légale socialiste sait pratiquer l’amalgame lorsqu’il s’agit d’invoquer l’unité nationale pour mieux diviser les Français et diaboliser tous ceux qui proposent une autre politique de lutte contre l’ennemi intérieur.
Du reste, si celui-ci est devenu une mascarade dans la lutte contre les islamistes, puisque tous les terroristes qui sont passés à l’acte étaient connus de nos services de renseignement, il n’est pas impossible que l’exécutif ne finisse par s’en servir dans son propre intérêt, c’est-à-dire contre les patriotes, surtout si, à la faveur de nouveaux massacres, il le prolonge en 2017, année électorale. Dans Le Figaro des 30 et 31 juillet, Natacha Polony n’hésite pas à demander : « n’est-ce pas ce que certains espèrent : l’action folle d’un militant d’extrême droite, ou d’un simple citoyen indigné perdant son sang-froid, qui permettrait de brandir le spectre du racisme et de réduire au silence aussi bien les candidats à la primaire de la droite [...] que les intellectuels courageux » — au rang desquels elle se place — « qui appellent à la résistance par la laïcité, l’intégration et la transmission » ? On a tout lieu de le craindre lorsqu’on entend Manuel Valls ou tel autre hiérarque socialiste reprocher à la droite parlementaire d’être en voie de « trumpisation » quand elle propose pour lutter contre le terrorisme islamiste des mesures « démagogiques » qui s’affranchirait du sacro-saint « État de droit ». La ficelle est un peu grosse, mais que ne peut-on pas faire avaler à un peuple que de nouveaux attentats traumatiseraient gravement ? La majorité légale socialiste sait pratiquer l’amalgame lorsqu’il s’agit d’invoquer l’unité nationale pour mieux diviser les Français et diaboliser tous ceux qui proposent une autre politique de lutte contre l’ennemi intérieur.
Ou font mine de proposer. Car ne nous y trompons pas : les mesures préconisées par la droite parlementaire sont de l’esbroufe, puisque cette dernière a montré, lorsqu’elle dirigeait l’Etat, combien elle était soumise aux diktats de la Cour européenne des droits de l’homme qui, aussi bien pour elle que pour Manuel Valls, définissent précisément ce qu’il faut entendre par « Etat de droit » et « démocratie ». Imagine-t-on que, retournant aux affaires, cette droite molle et lâche, dont les promesses d’autorité n’ont jamais engagé que les nigauds d’électeurs qui croient toujours en elle, romprait avec un catéchisme qui fait le fonds de commerce et du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, deux instances supranationales avec lesquelles l’actuel pays légal ne veut pas rompre, surtout en matière d’immigration ou de droits fondamentaux ...des criminels ?
Si nous quittons, en ce début du mois d’août, ces zones pestilentielles de la démagogie politicienne, sans savoir toutefois, avant que nous ne reprenions la plume début septembre, combien de nouveaux morts nous devrons compter, force est de reconnaître que les lignes bougent en profondeur. Et que des réponses commencent à être apportées aux interrogations sur l’état du pays. C’est le cardinal Vingt-Trois dénonçant le 27 juillet, dans son homélie à Notre-Dame sur le martyre du père Hamel, le prêtre assassiné, le « silence des élites devant les déviances des mœurs et la législation de ces déviances . [...] C’est sur cette inquiétude latente que l’horreur des attentats aveugles vient ajouter ses menaces. » C’est Jacques Juillard qui, suivant les traces de Renan, regrette que la France ne soit « devenue intellectuellement et moralement le maillon faible de l’Europe. » Elle « ne sortira du marasme actuel, fait d’angoisse et d’incertitude, que par un renouveau intellectuel et moral. » Et ce républicain de gauche d’ajouter : « Jeanne devant le Dauphin, Clemenceau devant le Parlement, de Gaulle au micro de Radio Londres n’ont qu’un seul et même message : oui le royaume de France existe ; oui la République existe. Oui, la France existe. » [1]
Il nous appartient à nous aussi d’assumer l’histoire de France dans sa totalité, tout en sachant que la tradition est critique. Peu s’aperçoivent, sous les tabous qui demeurent encore, de la révolution intellectuelle et spirituelle aujourd’hui engagée. Nous y participons au plan politique : tel est le sens, chaque année, de notre université d’été, où nous définirons, fin août, dix axes de salut national, pour retrouver les vrais fondements de l’amitié française. Comme le déclare Mgr le comte de Paris, dans l’important entretien qu’Il a bien voulu nous accorder : « Le multiculturalisme est un leurre dangereux, dont le résultat serait une “bouillabaisse” sans espoir et l’éradication des racines de notre civilisation. » Nous en subissons aujourd’hui les conséquences sanglantes. Mais le renouveau sera au bout de l’épreuve, si, du moins, nous savons espérer et lutter.
[1] Le Figaro des 30 et 31 juillet 2016
L’Action Française 2000 [Editorial]

 On commence à s'y habituer : à chaque attentat terroriste, une bonne partie du système médiatique active le logiciel du déni d'islamisme. Cela a aussi été le cas après l'attentat de Nice. Une chose semble plus importante encore que de pleurer les victimes et d'encombrer les lieux du crime de fleurs et de bougies: c'est de dépolitiser l'attentat. Dans la mesure du possible, on multipliera les hypothèses qui nous éloignent d'un constat pourtant enregistré depuis longtemps dans la conscience populaire : la paix perpétuelle à laquelle nous aspirions dans la dernière décennie du vingtième siècle a été fracassée une fois pour toutes. L'islamisme nous a déclaré la guerre. Il ne nous est plus possible de croire que la guerre appartient à la préhistoire de l'humanité occidentale et qu'il suffirait d'étendre à travers le monde la logique des droits de l'homme pour l'éradiquer une fois pour toutes. Mais le système médiatique travaille fort à nier cette réalité.
On commence à s'y habituer : à chaque attentat terroriste, une bonne partie du système médiatique active le logiciel du déni d'islamisme. Cela a aussi été le cas après l'attentat de Nice. Une chose semble plus importante encore que de pleurer les victimes et d'encombrer les lieux du crime de fleurs et de bougies: c'est de dépolitiser l'attentat. Dans la mesure du possible, on multipliera les hypothèses qui nous éloignent d'un constat pourtant enregistré depuis longtemps dans la conscience populaire : la paix perpétuelle à laquelle nous aspirions dans la dernière décennie du vingtième siècle a été fracassée une fois pour toutes. L'islamisme nous a déclaré la guerre. Il ne nous est plus possible de croire que la guerre appartient à la préhistoire de l'humanité occidentale et qu'il suffirait d'étendre à travers le monde la logique des droits de l'homme pour l'éradiquer une fois pour toutes. Mais le système médiatique travaille fort à nier cette réalité.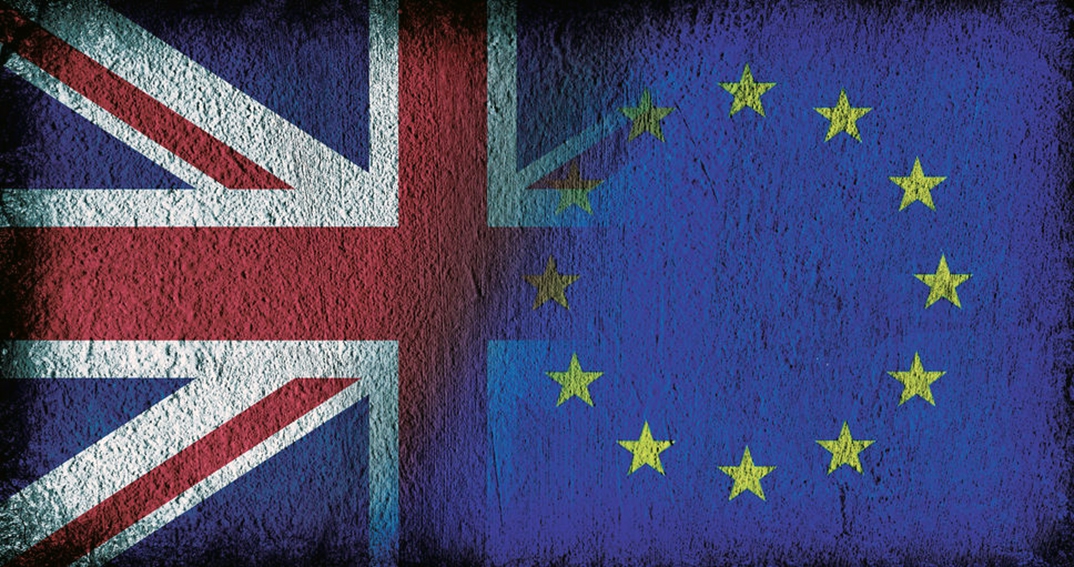
 Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.
Le référendum sur le Brexit a été un formidable révélateur du caractère illusoire de la démocratie dans laquelle on pense évoluer. On s’imagine qu’en démocratie, le peuple est souverain. C’est de plus en plus faux. On constate ces jours-ci ce que veut dire évoluer dans un système idéologique qui se prend pour le seul visage possible de la réalité – un système idéologique qui s’incarne dans un régime politique avec des capacités coercitives variées et bien réelles, et qui prétend mater le peuple au nom de la démocratie. Autrement dit, derrière les institutions démocratiques, il y a une idéologie à laquelle nous devons obligatoirement adhérer. Et ceux qui n’y adhèrent pas pleinement sont sous surveillance. Ce qui m’intéresse, ici, c’est le statut réservé à l’opposition dans le système idéologique dans lequel nous vivons. Je distinguerais, essentiellement, deux figures possibles de l’opposition.
 On avait décrété sa victoire impossible. Au mieux, on considérait Donald Trump à la manière d'un porte-voix du désespoir d'un nombre croissant d'Américains. Donald Trump était le symptôme d'une misère politique et culturelle qui frappait même les classes populaires de l'empire de notre temps. Au pire, on se le représentait à la manière d'un bouffon monstrueux, sexiste, raciste et grossier. Il faudra changer notre regard et apprendre à voir Donald Trump le malappris dans le rôle du président des États-Unis. Celui que Barack Obama redoutait de voir en possession des codes nucléaires deviendra pour quatre ans l'homme le plus puissant du monde. Il faut dire que les craintes d'Obama n'étaient pas infondées. La réputation d'aventurier mégalomane erratique de Donald Trump n'est pas nécessairement imméritée.
On avait décrété sa victoire impossible. Au mieux, on considérait Donald Trump à la manière d'un porte-voix du désespoir d'un nombre croissant d'Américains. Donald Trump était le symptôme d'une misère politique et culturelle qui frappait même les classes populaires de l'empire de notre temps. Au pire, on se le représentait à la manière d'un bouffon monstrueux, sexiste, raciste et grossier. Il faudra changer notre regard et apprendre à voir Donald Trump le malappris dans le rôle du président des États-Unis. Celui que Barack Obama redoutait de voir en possession des codes nucléaires deviendra pour quatre ans l'homme le plus puissant du monde. Il faut dire que les craintes d'Obama n'étaient pas infondées. La réputation d'aventurier mégalomane erratique de Donald Trump n'est pas nécessairement imméritée.

 Avec une récurrence que d'aucuns trouveraient obsessive, je ne cesse de reprocher au personnel politique d'opposition leur refus de comprendre que la bataille intellectuelle et médiatique est la mère de toutes les batailles.
Avec une récurrence que d'aucuns trouveraient obsessive, je ne cesse de reprocher au personnel politique d'opposition leur refus de comprendre que la bataille intellectuelle et médiatique est la mère de toutes les batailles.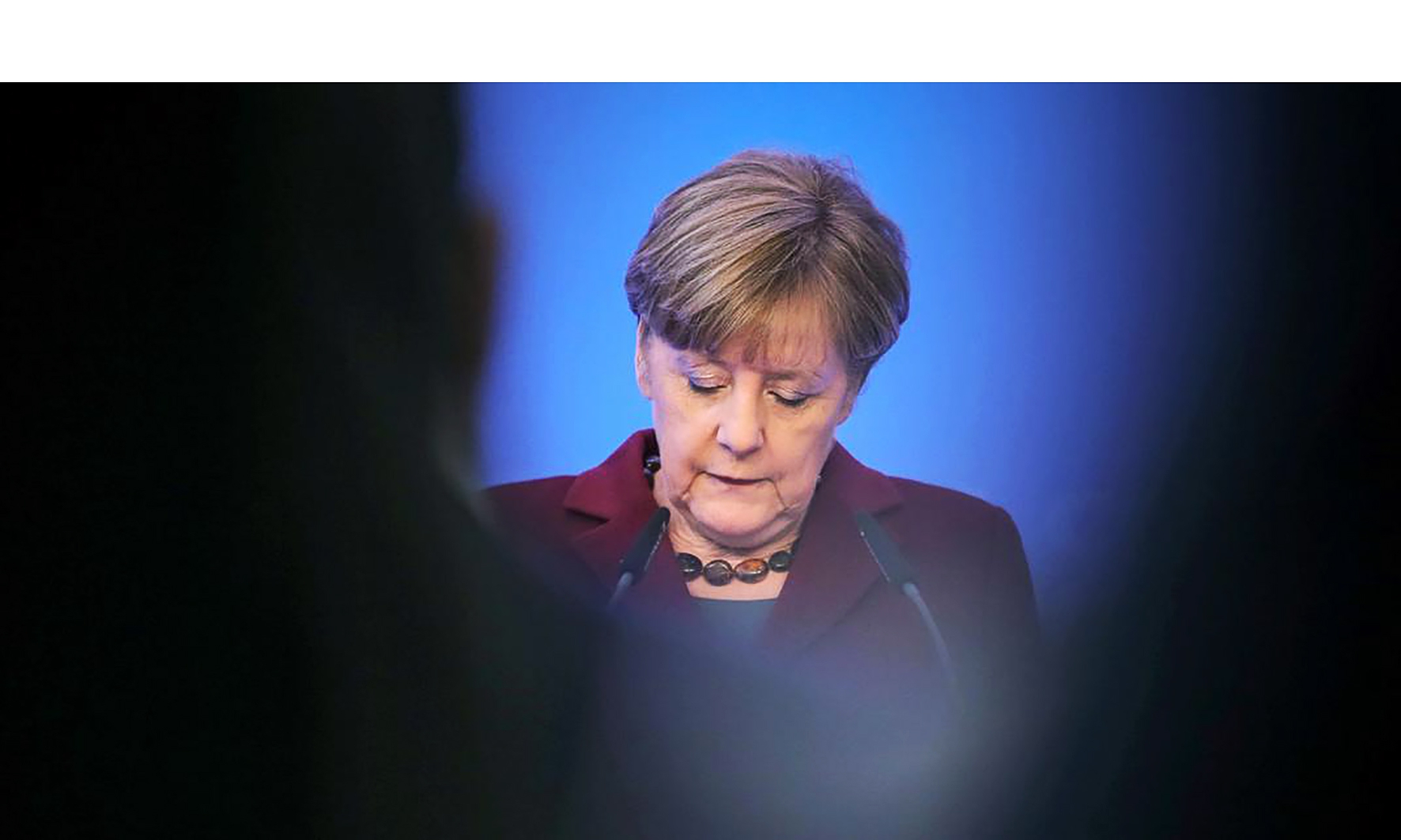
 L'information circulait depuis quelques jours sur Internet sans qu'on ne parvienne vraiment à la valider: y avait-il eu vraiment une vague massive d'agressions sexuelles sur les femmes à Cologne, la nuit de la Saint-Sylvestre, par des migrants ou des bandes d'origine étrangère ? Il a fallu que la rumeur enfle suffisamment pour que les autorités reconnaissent les événements et que le système médiatique consente à rendre compte du phénomène, dont on ne cesse, depuis, de constater l'ampleur, tellement les témoignages accablants se multiplient à la grandeur de l'Allemagne.
L'information circulait depuis quelques jours sur Internet sans qu'on ne parvienne vraiment à la valider: y avait-il eu vraiment une vague massive d'agressions sexuelles sur les femmes à Cologne, la nuit de la Saint-Sylvestre, par des migrants ou des bandes d'origine étrangère ? Il a fallu que la rumeur enfle suffisamment pour que les autorités reconnaissent les événements et que le système médiatique consente à rendre compte du phénomène, dont on ne cesse, depuis, de constater l'ampleur, tellement les témoignages accablants se multiplient à la grandeur de l'Allemagne.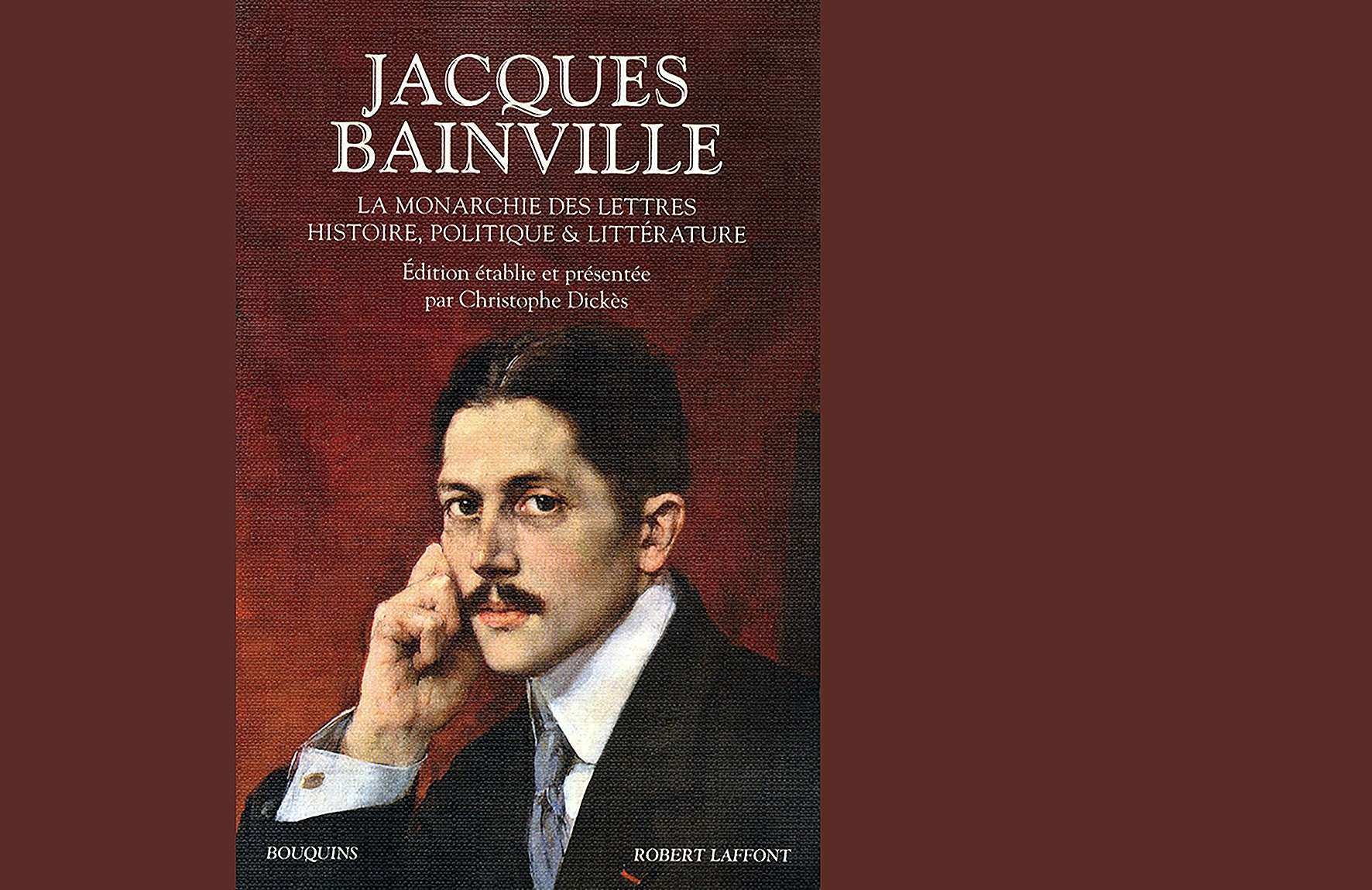
 A la question de savoir quel a été le moment le plus important de l’année 2015, il me semble qu’il ne s’agit pas d’un événement en particulier, mais plutôt d’un mot : celui de civilisation. Ce mot avait beaucoup été utilisé au lendemain des attentats du 11 septembre. On parlait alors du choc des civilisations, en écho au célèbre livre de Samuel Huntington.
A la question de savoir quel a été le moment le plus important de l’année 2015, il me semble qu’il ne s’agit pas d’un événement en particulier, mais plutôt d’un mot : celui de civilisation. Ce mot avait beaucoup été utilisé au lendemain des attentats du 11 septembre. On parlait alors du choc des civilisations, en écho au célèbre livre de Samuel Huntington.
 La table est mise, les Britanniques se prononceront le 23 juin sur leur sortie de l'Union européenne. Les cyniques ont déjà leur formule toute trouvée : les Britanniques envisagent d'autant plus librement de sortir de l'Europe qu'ils n'y sont jamais vraiment entrés. Il n'en demeure pas moins que la vie politique européenne tournera pour les prochains mois autour de ce débat fondamental : est-ce qu'un État est en droit de sortir d'une association politique qui était censée représenter un grand bond en avant dans l'histoire universelle ? Est-il même en droit de définir selon ses intérêts nationaux spécifiques sa participation à une telle union ?
La table est mise, les Britanniques se prononceront le 23 juin sur leur sortie de l'Union européenne. Les cyniques ont déjà leur formule toute trouvée : les Britanniques envisagent d'autant plus librement de sortir de l'Europe qu'ils n'y sont jamais vraiment entrés. Il n'en demeure pas moins que la vie politique européenne tournera pour les prochains mois autour de ce débat fondamental : est-ce qu'un État est en droit de sortir d'une association politique qui était censée représenter un grand bond en avant dans l'histoire universelle ? Est-il même en droit de définir selon ses intérêts nationaux spécifiques sa participation à une telle union ?
 La scène avait quelque chose d'atroce et, en même temps, de terriblement banale. À quelques jours du 25 décembre, un camion se lance sur un marché de Noël de Berlin, tue une douzaine de personnes et en blesse une cinquantaine. On croit revivre les événements de Nice quand Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait frappé le soir du 14 juillet. Là aussi, il s'agissait de semer la terreur dans un moment de réjouissance et de traumatiser la population. On peut imaginer la suite médiatique : certains diront que l'événement demeure un incident isolé. On chantera en chœur « pas d’amalgame ». D'autres se demanderont encore une fois si l'Occident ne l'a pas cherché, bien qu'on se demandera de quelle manière l'Allemagne a bien pu se rendre coupable d'une forme plus ou moins intransigeante de laïcité néocoloniale, pour emprunter le jargon à la mode. Le système médiatique, devant l'islamisme, cultive l'art du déni. Il déréalise les événements, les égrène en mille faits divers et empêche de nommer la guerre faite à l'Occident.
La scène avait quelque chose d'atroce et, en même temps, de terriblement banale. À quelques jours du 25 décembre, un camion se lance sur un marché de Noël de Berlin, tue une douzaine de personnes et en blesse une cinquantaine. On croit revivre les événements de Nice quand Mohamed Lahouaiej Bouhlel avait frappé le soir du 14 juillet. Là aussi, il s'agissait de semer la terreur dans un moment de réjouissance et de traumatiser la population. On peut imaginer la suite médiatique : certains diront que l'événement demeure un incident isolé. On chantera en chœur « pas d’amalgame ». D'autres se demanderont encore une fois si l'Occident ne l'a pas cherché, bien qu'on se demandera de quelle manière l'Allemagne a bien pu se rendre coupable d'une forme plus ou moins intransigeante de laïcité néocoloniale, pour emprunter le jargon à la mode. Le système médiatique, devant l'islamisme, cultive l'art du déni. Il déréalise les événements, les égrène en mille faits divers et empêche de nommer la guerre faite à l'Occident.
 La mort de Michel Rocard a permis à la classe politique et médiatique de dire le bien qu'elle pensait d'un homme dont tous, à un moment ou un autre, ont reconnu les vertus et les talents. Avec raison, on a louangé un politique honorable. Ces bons mots n'étaient pas exempts de mélancolie: l'homme aurait pu avoir un autre destin et devenir président de la République. La gauche française, avec lui, se serait enfin modernisée et elle aurait même devancé le travaillisme britannique dans la mise en place de ce qu'on appellera plus tard la troisième voie. La France aurait aujourd'hui un autre visage et ne serait pas une société bloquée si la deuxième gauche l'avait pilotée.
La mort de Michel Rocard a permis à la classe politique et médiatique de dire le bien qu'elle pensait d'un homme dont tous, à un moment ou un autre, ont reconnu les vertus et les talents. Avec raison, on a louangé un politique honorable. Ces bons mots n'étaient pas exempts de mélancolie: l'homme aurait pu avoir un autre destin et devenir président de la République. La gauche française, avec lui, se serait enfin modernisée et elle aurait même devancé le travaillisme britannique dans la mise en place de ce qu'on appellera plus tard la troisième voie. La France aurait aujourd'hui un autre visage et ne serait pas une société bloquée si la deuxième gauche l'avait pilotée.
 Un jour, badinant avec Malraux, le Général de Gaulle a dit : « Au fond, vous savez, mon seul rival international, c’est Tintin ! Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s’en aperçoit pas à cause de ma taille ». L’aphorisme est célèbre. Tintin est universellement connu, à la manière de Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jésus, Superman ou Mahomet. Les aventures du petit jeune homme à la houppette blonde ont été traduites depuis des décennies pour les lecteurs de pays improbables où les habitants ont des mœurs condamnables et parlent des dialectes plein de mots étrangers. Après avoir parlé serbo-croate, chinois et même corse, on attend Le Sceptre d’Ottokar en borduro-syldave… Ceux qui sont nés au début du siècle dernier ont découvert Tintin dans les colonnes du “Petit Vingtième”, supplément jeunesse d’une publication catholique quotidienne, les baby-boomers l’ont découvert à la radio (il y a eu une série…) et au cinéma (quiconque n’a pas vu Tintin et les Oranges bleues (1964) ignore ce qu’est cette star potagère que nous appelons communément « navet »), bien des gamins de notre temps ont eu connaissance des aventures du petit belge par la série animée diffusée jadis par France 3, et certain des plus jeunes l’ont découvert à travers le film de Steven Spielberg… Les 24 albums (dont le dernier, L’Alph Art, est inachevé) ont leur place au panthéon des bestsellers mondiaux, avec la Bible et le petit livre rouge de Mao.
Un jour, badinant avec Malraux, le Général de Gaulle a dit : « Au fond, vous savez, mon seul rival international, c’est Tintin ! Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s’en aperçoit pas à cause de ma taille ». L’aphorisme est célèbre. Tintin est universellement connu, à la manière de Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jésus, Superman ou Mahomet. Les aventures du petit jeune homme à la houppette blonde ont été traduites depuis des décennies pour les lecteurs de pays improbables où les habitants ont des mœurs condamnables et parlent des dialectes plein de mots étrangers. Après avoir parlé serbo-croate, chinois et même corse, on attend Le Sceptre d’Ottokar en borduro-syldave… Ceux qui sont nés au début du siècle dernier ont découvert Tintin dans les colonnes du “Petit Vingtième”, supplément jeunesse d’une publication catholique quotidienne, les baby-boomers l’ont découvert à la radio (il y a eu une série…) et au cinéma (quiconque n’a pas vu Tintin et les Oranges bleues (1964) ignore ce qu’est cette star potagère que nous appelons communément « navet »), bien des gamins de notre temps ont eu connaissance des aventures du petit belge par la série animée diffusée jadis par France 3, et certain des plus jeunes l’ont découvert à travers le film de Steven Spielberg… Les 24 albums (dont le dernier, L’Alph Art, est inachevé) ont leur place au panthéon des bestsellers mondiaux, avec la Bible et le petit livre rouge de Mao. L’exposition, composée pour l’essentiel de planches du dessinateur, prêtées par le Studio Hergé, permet aussi de mieux comprendre le processus créatif, des premiers crayonnés où l’on sent que le dessinateur tourne autour de ses personnages, les “cherche”, jusqu’aux planches finales, en passant par l’étape de la colorisation (en grand aplats de couleurs, sans effets d’ombres). C’est ainsi une toute une “famille de papier” qui nous est présentée, et l’on redécouvre, autour d’une maquette géante du château de Moulinsart, les visages familiers de la Castafiore, du Professeur Tournesol, du Capitaine Hadock ou encore de méchants que nous avons adoré détester tels que Rastapopoulos ou l’infâme Docteur Müller de l’Île noire. Au détour de ces portraits, on croise aussi des figures entrées dans le langage quotidien : le fameux sparadrap qui empoisonne Hadock, ou les récurrents appels téléphoniques destinés à la boucherie Sanzot qui aboutissent irrémédiablement à Moulinsart… Soulignons deux salles particulièrement intéressantes : l’une consacrée à la période de crise traversée par Hergé (et le monde entier) dans les années 40 et l’autre à l’Asie. Les années 40 : c’est le succès et la tourmente. Les albums se vendent très bien. Ils commencent à être traduits. Après avoir présenté une Europe au bord du gouffre dans Le Sceptre d’Ottokar (1939), Hergé confronte son petit héros au spectre de la fin du monde dans L’étoile mystérieuse (1942). C’est dans les pages du quotidien Belge Le Soir que le dessinateur publie ses histoires en feuilletons, passant des 40.000 lecteurs habituels du Petit Vingtième à 300.000… On ne manquera pas de reprocher par la suite cette collaboration à Hergé : le journal est alors contrôlé par l’occupant allemand. L’autre salle passionnante est consacrée au rapport d’Hergé à l’orient, avec des planches du chef d’œuvre du dessinateur Le lotus bleu et une traduction hilarantes des inscriptions chinoises omniprésentes dans l’album, dont certaines sont des publicités ou des slogans politiques tels que “A bas l’impérialisme !“. L’amitié d’Hergé avec un jeune étudiant chinois, Tchang, est mise en avant ; Tchang qui ouvrira Hergé à l’altérité, Tchang qui fournira au dessinateur d’abondants conseils pour cet album, et finira même par devenir un personnage des aventures du petit reporter blond – dans le très dépressif Tintin au Tibet (1960).
L’exposition, composée pour l’essentiel de planches du dessinateur, prêtées par le Studio Hergé, permet aussi de mieux comprendre le processus créatif, des premiers crayonnés où l’on sent que le dessinateur tourne autour de ses personnages, les “cherche”, jusqu’aux planches finales, en passant par l’étape de la colorisation (en grand aplats de couleurs, sans effets d’ombres). C’est ainsi une toute une “famille de papier” qui nous est présentée, et l’on redécouvre, autour d’une maquette géante du château de Moulinsart, les visages familiers de la Castafiore, du Professeur Tournesol, du Capitaine Hadock ou encore de méchants que nous avons adoré détester tels que Rastapopoulos ou l’infâme Docteur Müller de l’Île noire. Au détour de ces portraits, on croise aussi des figures entrées dans le langage quotidien : le fameux sparadrap qui empoisonne Hadock, ou les récurrents appels téléphoniques destinés à la boucherie Sanzot qui aboutissent irrémédiablement à Moulinsart… Soulignons deux salles particulièrement intéressantes : l’une consacrée à la période de crise traversée par Hergé (et le monde entier) dans les années 40 et l’autre à l’Asie. Les années 40 : c’est le succès et la tourmente. Les albums se vendent très bien. Ils commencent à être traduits. Après avoir présenté une Europe au bord du gouffre dans Le Sceptre d’Ottokar (1939), Hergé confronte son petit héros au spectre de la fin du monde dans L’étoile mystérieuse (1942). C’est dans les pages du quotidien Belge Le Soir que le dessinateur publie ses histoires en feuilletons, passant des 40.000 lecteurs habituels du Petit Vingtième à 300.000… On ne manquera pas de reprocher par la suite cette collaboration à Hergé : le journal est alors contrôlé par l’occupant allemand. L’autre salle passionnante est consacrée au rapport d’Hergé à l’orient, avec des planches du chef d’œuvre du dessinateur Le lotus bleu et une traduction hilarantes des inscriptions chinoises omniprésentes dans l’album, dont certaines sont des publicités ou des slogans politiques tels que “A bas l’impérialisme !“. L’amitié d’Hergé avec un jeune étudiant chinois, Tchang, est mise en avant ; Tchang qui ouvrira Hergé à l’altérité, Tchang qui fournira au dessinateur d’abondants conseils pour cet album, et finira même par devenir un personnage des aventures du petit reporter blond – dans le très dépressif Tintin au Tibet (1960).



 S'il faut rechercher les sources et les responsabilités les plus déterminantes dans les graves événements d'Espagne, il serait léger de ne voir que les apparences. Peut-être un peu de recul n'est-t-il pas de trop et permettrait de les mieux comprendre.
S'il faut rechercher les sources et les responsabilités les plus déterminantes dans les graves événements d'Espagne, il serait léger de ne voir que les apparences. Peut-être un peu de recul n'est-t-il pas de trop et permettrait de les mieux comprendre.

