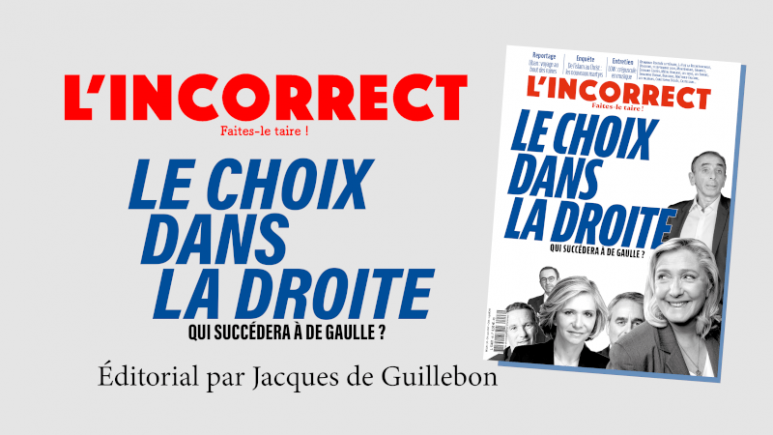Il est étonnant que libéral soit devenu un mot de droite, voire de chrétiens, quand il désignait originellement ce mouvement révolutionnaire simplet consistant à remplacer toutes les antiques vertus de la cité, justice, bien commun, vérité, honneur, par les petits mots de liberté individuelle. On ne discutera pas ici des fameuses « lois du marché » – apparemment les seules dont le vaniteux contemporain admet de porter le joug ; fameux et glorieux joug que celui du cours de la carotte et de la patate – mais plutôt de ce sentiment de propriété de soi qui anime l’homme moderne libéré et lui fait songer qu’il n’a plus à rechercher rien qui le dépasse sinon pour que ça le satisfasse. D’ailleurs, rien ne le dépasse et il est en tout la somme de tout. Aussi le moindre événement l’inquiète, le tend, le rend semi-fou, car à qui ne souhaite que sa liberté le moindre extérieur se révèle foncièrement contrariété.
Et la droite est plus coupable que quiconque d’avoir goûté au fruit de l’arbre de la liberté, la liberté n’étant au fond que le cadeau du fort fait au faible, car le fort recherche la vérité et quand il la connaît il n’a nul besoin d’exiger quelque liberté d’en jouir. La vérité est un don, la liberté une aumône faite aux aveugles.
Mais on dirait que le monde des forts s’est changé en un tas de victimes. La droite ressemble à ces filles de nouveaux livres d’aventures pour enfants promus par des ordures éditoriales, qui combattent le sexisme partout, et triomphent finalement du méchant garçon (blanc, évidemment). La droite est devenue une pleureuse, fille de Guizot et de Daladier : munichienne, elle gémit devant ses droits perdus, remuant à peine l’orteil, mais éructant son malheur à la face du monde, et réclamant qu’un deus ex machina vienne la sauver. Et c’est le petit homme qui nous gouverne, né d’un croisement de la banque et de la licence, qui est obligé de nous rappeler à l’ordre, de redire à des Français grincheux que pour que France et civilisation continuent, les devoirs passent avant les droits. Banalité certes, mais que ces temps odieux nécessitent.
Ce microbe sera tel la zizanie ou le grain de moutarde le moyen ou de notre chute ou de notre salut
Finalement, la providence à son habitude se sera servi du plus minuscule des êtres – un virus – pour nous renverser de notre trône, nous les superbes, nous les puissants (que nous croyions). Ce microbe sera tel la zizanie ou le grain de moutarde le moyen ou de notre chute ou de notre salut. Et c’est ici que la vraie liberté, pas n’importe laquelle, celle du libre-arbitre, entre en jeu : que ferons-nous de cette situation qui nous est donnée, de ce temps qui nous reste à vivre ? Ou l’occasion de nous déchirer, ou l’occasion de nous réconcilier dans une destinée supérieure.
Au milieu du chemin de cette vie, nous nous retrouvons au carrefour : que proposerons-nous à ce pays, à nos enfants, à nos contemporains, le sang, la sueur et les larmes ; ou la sempiternelle réaffirmation de notre droit à jouir ?