LIVRES • Le patriotisme tranquille d'Alain Finkielkraut, selon Mathieu Bock-Côté
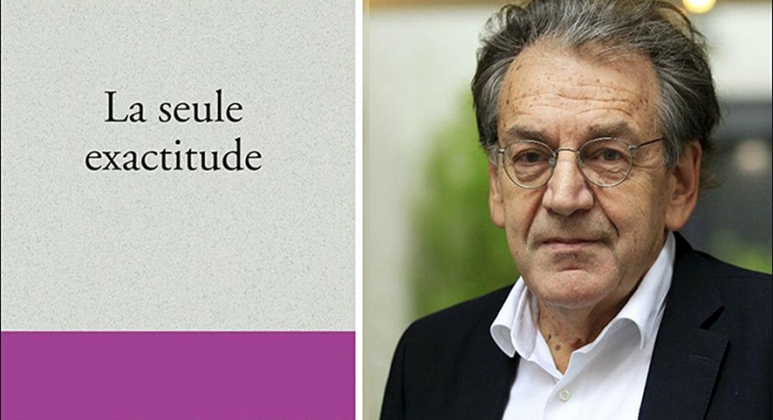
Mathieu Bock-Côté a lu pour Le Figaro l'ouvrage d'Alain Finkielkraut, La seule exactitude. Il estime que notre philosophe cultive pour la France un « patriotisme tranquille », sans prétention impériale aucune. Tranquille n'est pas le mot que l'on associe le plus, en général, à l'image d'Alain Finkielkraut. On le voit plutôt habité d'une forme anxieuse et agitée du souci contemporain, au sens de Chantal Delsol. On lui reproche contradictoirement un excès d'amour - qui confinerait à l'obsession - pour la culture traditionnelle, la civilisation françaises et d'être tout autant judéo-centré. Ce qui, dans ce dernier cas ne nous paraît pas tout à fait faux et un rien dommageable au point de lui rendre le Maurras profond, ou le vrai Barrès, inintelligibles voire a priori intellectuellement infréquentables. La difficulté, on s'en souviendra, n'a ni empêché ni troublé le dialogue foisonnant et fécond pas plus que l'admiration réciproque de Pierre Boutang et George Steiner... Mais s'agissant de l'œuvre et du statut d'Alain Finkielkraut, s'agissant de son analyse de la modernité, profonde et juste, nous sommes d'avis que Mathieu Bock-Côté dit une fois de plus l'essentiel. Et avec une argumentation, un fond qui est aussi le nôtre. LFAR
 Rien n'est plus important que ne pas se tromper d'époque. Telle est, d'une certaine manière, la grande obsession qui traverse La seule exactitude, le dernier ouvrage d'Alain Finkielkraut. Elle n'est pas vraiment nouvelle. Lecteur de Hannah Arendt, Finkielkraut souhaite depuis longtemps « penser l'événement », en s'ouvrant à sa part de nouveauté, à ce qui dans le monde qui vient, n'est pas une simple reconduction de celui d'hier. Malgré ce qu'en pensent les esprits désenchantés, l'histoire qui se fait n'est pas soumise à la seule loi du retour du même. Pourquoi cette mise en garde ? Essentiellement parce que Finkielkraut n'en peut plus d'entendre certains petits sermonneurs progressistes nous expliquer que les années 1930 seraient de retour, généralement ralliés à une forme d'antifascisme parodique qui n'en finit plus d'assimiler tout ce qui contredit le métissage euphorique du monde à une nouvelle peste brune.
Rien n'est plus important que ne pas se tromper d'époque. Telle est, d'une certaine manière, la grande obsession qui traverse La seule exactitude, le dernier ouvrage d'Alain Finkielkraut. Elle n'est pas vraiment nouvelle. Lecteur de Hannah Arendt, Finkielkraut souhaite depuis longtemps « penser l'événement », en s'ouvrant à sa part de nouveauté, à ce qui dans le monde qui vient, n'est pas une simple reconduction de celui d'hier. Malgré ce qu'en pensent les esprits désenchantés, l'histoire qui se fait n'est pas soumise à la seule loi du retour du même. Pourquoi cette mise en garde ? Essentiellement parce que Finkielkraut n'en peut plus d'entendre certains petits sermonneurs progressistes nous expliquer que les années 1930 seraient de retour, généralement ralliés à une forme d'antifascisme parodique qui n'en finit plus d'assimiler tout ce qui contredit le métissage euphorique du monde à une nouvelle peste brune.
L'exercice n'est pas simple. Il faut révéler l'époque à travers l'événement. C'est au fil de ses chroniques hebdomadaires à la Radio communautaire juive et mensuelles à Causeur qu'il s'y est adonné. À sa manière, il s'est livré à l'exercice du bloc-notes, non pas pour dépeindre des caractères, comme le faisait Mauriac, mais pour voir en quoi de jour en jour, les événements nous obligent à réviser nos schèmes de pensée. On a beaucoup chanté, depuis vingt ans, la fin des idéologies. On s'imaginait un monde asséché, où ne se poserait plus la question de la légitimité. Nous accepterions tous, à différents degrés d'enthousiasme, une société se convertissant à la figure de la mondialisation heureuse, où les identités fondraient et les frontières se dissiperaient. Finkielkraut est de ceux qui refusent de voir dans cela un processus inéluctable. Il y décrypte plutôt une nouvelle idéologie dominante dont il cherche à nous déprendre.
Cette idéologie, on trouve en son cœur une thèse forte: celle de l'interchangeabilité de toutes choses. Notre époque se montre radicalement incapable de penser le particulier, ce qui ne se laisse pas dissoudre dans une forme d'universalisme radical. Ainsi, Finkielkraut montre comment, en réduisant les langues à de simples instruments de communication, on perd le génie de chacune, qui s'exprime à travers la littérature. Il en est de même lorsqu'on cède au mythe de l'interchangeabilité des cultures et qu'on s'imagine possible, pour combler les besoins du marché du travail, d'importer des millions d'hommes en croyant pouvoir les séparer de leur culture et de leur religion. On découvre pourtant, tôt ou tard, qu'elles finissent par s'entrechoquer. Le mythe de l'interchangeabilité des sexes ne vaut guère mieux, lorsqu'il passe de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes à celle de l'abolition du féminin et du masculin, comme si le simple rappel d'une différence poussait inévitablement à la discrimination.
Mais Finkielkraut pousse plus loin encore son analyse. Les militants antiracistes d'aujourd'hui ne cessent de pratiquer un amalgame particulier : les musulmans seraient les nouveaux juifs. En un mot, l'antisémitisme des années 1930 trouverait un écho dans la soi-disant islamophobie des années 2000. D'une époque à l'autre, une même passion noire se déploierait : la peur de l'autre, qui pousserait au repli national, alimenté par le culte de l'homogénéité ethnique. Cela consiste, dans les faits, à croire la civilisation occidentale atteinte d'une pathologie ethnocentrique fondamentale, qui se déploierait rageusement chaque fois qu'on ne la refoulerait pas et qu'on ne se montrerait pas vigilant. En un mot, l'attachement national serait la dernière étape avant la xénophobie, qui pousserait au racisme et nous replongerait dans les heures les plus sombres de l'histoire. En se sachant atteint d'une telle maladie, l'Occident aurait raison de se détester et de ne pas vouloir transmettre une culture toxique, ruinée par les préjugés les plus odieux.
Finkielkraut corrige ce diagnostic et ne se laisse pas berner par l'étrange amalgame. Les juifs furent victimes de la furie génocidaire et exterminatrice au cœur de l'idéologie nazie, qui animalisait et zoologisait l'humanité en la triant en races. Le IIIe Reich entendait « purifier » l'humanité en la libérant d'un peuple maudit, ou pire encore, d'un peuple diabolique qui se glisserait dans chaque civilisation pour la pousser à la dissolution. On ne trouve rien de tel dans le rapport à l'Islam qui s'installe en Europe à travers des migrations massives qu'il est de moins en moins possible de nommer. De périphrases en périphrases, on doit bien convenir, pourtant, d'une révolution démographique qui s'accompagne d'une mutation identitaire massive, comme si on voulait fabriquer un nouveau peuple sans le dire. Or, nous dit Finkielkraut, cet amalgame sert à empêcher une réflexion sérieuse sur l'intégration des populations musulmanes et l'assimilation de la défense de l'identité française à l'islamophobie.
Finkielkraut le dit et redit : on ne saurait calquer bêtement une situation historique sur une autre. Et le malaise causé par l'Islam dans les sociétés européennes n'est pas le fruit d'une paranoïa collective, quoi qu'en pensent ceux qui croient faire disparaître les tensions entre les cultures en niant leur existence. Il ne s'agit pas de radicaliser le conflit entre les sociétés européennes et l'Islam, mais de constater qu'une immigration de peuplement aussi massive que constante n'ira pas sans bouleverser la société d'accueil. Une nation n'est pas qu'un ensemble de règles et de principes juridiques: c'est aussi, à certains égards, une communauté de mœurs, comme on le constate avec la place des femmes dans la société. Finkielkraut rappelle la tradition de la mixité à la française, qui est aussi celle du féminin dans l'espace public, qu'on ne saurait voiler sans mutiler au même moment la nation. En suivant cette piste, il cherche à redécouvrir ce qu'il y a de spécifique à la culture française - on pourrait dire, ce qu'il y a d'irremplaçable. C'est une manière, et probablement la meilleure, de penser politiquement l'héritage culturel.
En un mot, on ne se rendra pas très loin en réduisant le patriotisme français à la seule défense des droits de l'homme. On sortira un peu de l'ouvrage de Finkielkraut pour rappeler que ce n'est pas seulement au nom des droits de l'homme qu'on a lutté contre le totalitarisme au vingtième siècle. Ce ne sont pas des libertaires en culottes courtes qui incarnèrent la résistance contre le nazisme mais le général de Gaulle et Winston Churchill, deux hommes qui seraient aujourd'hui considérés comme des infréquentables absolus dans la démocratie européenne. Le premier défendait l'honneur de la France dans un vocabulaire inintelligible à nos contemporains, le second était attaché à la gloire de l'empire et de la civilisation chrétienne. En un sens, la démocratie occidentale ne veut plus entendre parler de ses limites et des vertus nécessaires à sa défense, qui puisent dans un imaginaire assez étranger à la modernité radicale. On évoquera aussi la résistance des nations d'Europe de l'est contre le communisme, qui puisait ses ressources dans leur identité culturelle et religieuse, sans croire qu'elles heurtaient de cette manière la démocratie qu'elles souhaitaient restaurer.
C'est l'honneur des pères, en quelque sorte, qui vient du fond de l'histoire, et qui lie les hommes entre eux au fil des générations, qui poussera les meilleurs d'entre eux, au moment d'une crise, à consentir à la possibilité de l'ultime sacrifice pour entrer en résistance. C'est ce que suggère Finkielkraut en parlant du devoir d'honorer nos pères en évoquant, dans un dernier chapitre fort émouvant, une filiation, un héritage, qui ne se laissera jamais complètement recycler par le contractualisme démocratique. Il y a au cœur de la cité une part sacrée, quelque chose comme un trésor, qu'on ne peut oublier sans sacrifier l'idée même d'un monde commun. Notre monde, en fait, vaut la peine d'être poursuivi et l'héritage de notre civilisation. Mais on ne saura le transmettre qu'en renouant avec la conscience intime de la finitude, et surtout, de la gratitude envers le donné. Pour reprendre une des formules de Finkielkraut, l'homme naît dans un monde qui le précède et qui lui survivra et s'il doit éviter de le muséifier, il n'en est pas moins le conservateur désigné.
C'est un thème présent chez Finkielkraut depuis ses premières réflexions sur le sort des petites nations, telles qu'on les retrouve dans Comment peut-on être Croate ? et dans l'aventure intellectuelle absolument passionnante du Messager européen. Le propre de la petite nation, disait alors Finkielkraut, est d'avoir une conscience intime de sa précarité. Elle sait très bien qu'elle pourrait ne pas être et elle n'a jamais la prétention d'embrasser à elle seule l'ensemble du destin de l'humanité. Pour cela, dans les métropoles, on l'accusera de provincialisme. Et pourtant, les petites nations éduquent à leur manière la philosophie politique en rappelant qu'un corps politique s'enracine toujours dans une expérience historique singulière. C'est cette conscience de la précarité des choses humaines qui l'avait conduit dans L'ingratitude, son livre d'entretiens avec Antoine Robitaille, à se dire ami de la cause québécoise. Finkielkraut y allait alors de cette belle formule: nous sommes tous des Québécois. Il a depuis suivi cette piste assez fidèlement et Éric Zemmour avait raison de dire de Finkielkraut qu'il cultivait pour la France le patriotisme des petites nations, sans prétention impériale aucune. Toutes les nations, un tant soit peu conscientes du monde qui vient, sont aujourd'hui attentives à cette fragilité. Finkielkraut fut un des premiers à s'en rendre compte.
Le livre de Finkielkraut nous oblige à poser la question de son rapport à la philosophie. Il le mentionne en passant, des esprits mesquins lui contestent de temps en temps son statut de philosophe. On voudrait en faire un essayiste grincheux parmi d'autres, même pas un intellectuel digne de ce nom. Sur les réseaux sociaux, qui donnent un écho disproportionné aux conversations grossières autrefois réservées aux tavernes les moins fréquentables, on se permet de l'insulter régulièrement. De petits agents de police qui se font passer pour des universitaires qualifiés cherchent aussi à le transformer en propagandiste réactionnaire qui ne mériterait même plus qu'on lui réponde. Il faut dire qu'ils réservaient aussi le même sort, il y a un peu plus d'un an, à une figure aussi importante que Marcel Gauchet. La gauche critique veut bien débattre, mais à ses conditions, de quoi elle voudra, et avec qui elle voudra. En un mot, elle souhaite définir les conditions de respectabilité dans le débat public et chasser les indésirables en les frappant d'ostracisme.
C'est évidemment une sottise sans nom. À la différence de ces philosophes qui n'en finissent plus de rejouer les vieilles scènes d'un antifascisme passé de mode, ou de ces autres philosophes, plus civilisés mais tout aussi stériles, qui réduisent la philosophie politique à un exercice strictement académique, aussi ennuyeux que pédant, où on déconstruit et reconstruit sans cesse le modèle d'une société aussi idéale que désincarnée, Alain Finkielkraut, fidèle ici à Péguy, plonge dans le monde, ses brumes et ses impuretés, pour chercher à l'éclairer un peu, tout en sachant qu'on ne sait jamais exactement dans quelle époque on vit. Raymond Aron disait que l'homme fait l'histoire mais ne sait pas l'histoire qu'il fait. Finkielkraut cherche néanmoins à le savoir un peu. Et même si Raymond Aron n'est pas une de ses inspirations intellectuelles majeures, on pourrait dire de Finkielkraut qu'il est aujourd'hui le spectateur engagé par excellence. Il est l'interlocuteur dont on ne peut se passer, au cœur de la cité, pour comprendre un peu le monde dans lequel on vit.
Nous sommes devant un philosophe majeur qui est aussi un écrivain remarquable. Il est normal qu'il trouble la médiacratie, qui ne sait plus trop quoi faire devant lui. Au moment de son passage à On n'est pas couché, Léa Salamé répétait la nouvelle ligne de défense de la gauche progressiste : les conservateurs auraient maintenant l'hégémonie culturelle. Cela en dit beaucoup sur la psychologie de l'intelligentsia, qui ne tolère tout simplement pas qu'on la contredise et qui panique dès lors qu'une autre voix que la sienne parvient à se faire entendre. Elle se croit assiégée dès qu'elle rencontre un contradicteur minimalement persistant. Mais Finkielkraut, comme d'autres, représente une parole libre, qui médite sur l'histoire sans se laisser conscrire, et qui subtilement, mais profondément, nous réapprend la liberté de pensée. Il arrive un moment où vient le temps de dire ce qu'on voit. Le dernier ouvrage de Finkielkraut n'est pas seulement un livre événement. C'est un livre capital. •
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologue et chargé de cours aux HEC à Montréal. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 2007). Mathieu Bock-Côté est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada.
Commentaires
Très belle analyse. Ce Mathieu Bock-Côté est un jeune universitaire avec lequel il va falloir compter tant sa pensée est claire, profonde et pertinente.