Jean-Frédéric Poisson : « La prolifération de l’islam ne se nourrit que de la faiblesse de notre propre conviction à déf
Jean-Frédéric Poisson a été député et maire de Rambouillet dans les Yvelines. Un territoire qui, une fois de plus, a été endeuillé par l’égorgement d’une fonctionnaire de police dans les locaux du commissariat. Quelques mois avant, le même département avait connu l’assassinat du couple de policiers de Magnanville et l’égorgement de Samuel Paty.

Qui sont les responsables ? Nos principes républicains sont-ils taillés pour faire rempart à la menace islamiste ? La fermeture des frontières suffirait-elle à protéger les Français ?
Réponses de Jean-Frédéric Poisson au micro de Boulevard Voltaire.
Vendredi, la ville de Rambouillet se retrouvait endeuillée. Un clandestin tunisien tout juste régularisé a égorgé une fonctionnaire de police de 49 ans, mère de deux enfants, au sein du commissariat de Rambouillet. C’est la première fois qu’une telle chose se produit dans cette ville.
C’est la première fois, et si la preuve devait être faite que cela peut maintenant frapper n’importe où n’importe quand et sur n’importe qui, on le savait déjà. On se considère toujours comme un peu à l’écart de ces coups du sort. Il faut avoir en tête que le département des Yvelines n’est pas, non plus, n’importe quel département. C’est le département qui a envoyé le plus grand nombre de djihadistes en Irak et en Syrie. Dans ce département, il y a des foyers de radicalisation de l’islam conquérant très actifs, des agressions régulières contre les forces de l’ordre et des actes de délinquance répétitifs. Les Yvelines ne sont donc pas un département aussi calme et aussi tranquille que ce que nous pourrions croire. Ce département est très bigarré, dans lequel l’islam conquérant est extrêmement présent. Les Yvelines ne sont pas épargnées par tout cela. On aurait préféré rester à l’écart de cette folie.
Selon vous, qui est responsable de ce qui s’est passé, vendredi, à Rambouillet ?
La très belle chanson de Bob Dylan « Qui a tué Davey Moore » est l’histoire d’un boxeur mort sur le ring. Son entraîneur, son adversaire et l’arbitre n’ont pas fait attention et il est mort. Il y a une forme de dilution de la responsabilité. Personne ne peut prétendre sérieusement qu’aucune mesure ne garantira jamais qu’un attentat de cette nature puisse se reproduire. Personne ne peut empêcher quelqu’un de déterminé de donner la mort à quelqu’un d’autre. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas traiter les causes. Je vois deux types de causes.
La première, c’est la complaisance que nous continuons d’avoir à l’égard de l’islam conquérant, de l’islam tout court comme système politique et comme idéologie. Dans le cœur de l’islam sont inscrits des ferments de violence. Dans la politique de l’islam est inscrite la volonté de dominer tous les esprits et de soumettre, dans la loi islamique, tous les comportements individuels. Dans la diplomatie des États musulmans est inscrit le projet de faire dominer la charia en Europe.
Le président Erdoğan n’est que le porte-voix d’un certain nombre de pays sunnites qui veulent faire régner la loi islamique sur l’Occident. Nous ignorons tout cela et n’avons pas pris la mesure de ce bras de fer de civilisation engagé par l’islam à notre encontre. Nous faisons comme si cette percussion n’existait pas, qu’elle était aimable et comme si elle pouvait être résolue, atténuée ou amortie par des accommodements raisonnables. On nous dit que ces fameux accommodements raisonnables pourraient améliorer la situation. Je n’y crois pas du tout.
Autant je crois que le dialogue avec les musulmans est indispensable, autant je pense que la conciliation avec l’islam est impossible.
Marine Le Pen face à Gérald Darmanin avait pris grand soin de dissocier l’islamisme et l’islam.
Cela n’existe pas. Je suis curieux de savoir ce qu’il y a derrière ces termes. Il y a une différence entre l’islam et les musulmans. Il y a l’islam comme système et doctrine d’un côté et, de l’autre côté, le rapport qu’entretiennent les croyants à ce système et à cette doctrine. Politiquement, vous pouvez travailler sur la doctrine si vous engagez un combat culturel contre les idées. C’est cela qui n’existe pas, en France. Malgré les annonces et les coups de menton, la détermination sans faille, etc., on ne voit toujours pas de grands courants orientalistes renaître en France et toujours pas de soutien à ceux qui engagent une critique rationnelle de l’islam en tant que système.
Par ailleurs, il y a ce qui est à faire contre les foyers de résonance de cet islam conquérant. La loi contre le séparatisme a essayé d’engager deux ou trois choses assez timides. Je ne suis pas certain qu’elles produiront des effets. C’est bien sur cette relation entre les musulmans et le système intellectuel qu’est l’islam qu’il faut travailler. La distinction islam/islamisme n’a aucun sens !
Ce message porté par les gens du printemps républicain démontre que la République telle qu’elle est vue et interprétée aujourd’hui n’est peut-être pas armée pour lutter contre cet islamisme radical ?
C’est un formidable signe de faiblesse. Quel plus grand signe de faiblesse que de vouloir faire taire celui qui ne pense pas comme vous ? Trouvez-vous que cette attitude est une attitude de force ?
Pensez-vous que c’est l’attitude de quelqu’un qui est sûr de ses propres principes et qui est à l’aise avec sa propre doctrine ?
Quelle est cette République, paraît-il, de la tolérance, de la liberté d’expression, de la liberté de croyance et de la liberté d’association ? Quelle est cette République qui, tout d’un coup, se met à interdire ?
Plus on renonce à traiter cette question et plus on est obligé d’entrer sur un régime d’interdiction, de privation et de contrainte pour expliquer aux musulmans qu’ils ne pensent pas droit.
On est en train de se rendre compte que ces fameuses valeurs de la République ne veulent rien dire. Pour beaucoup de Français, c’est du vent ! Les valeurs de la République répétées en particulier aux Français musulmans ne leur parlent pas. Je ne dis pas que cela ne parle à personne, je dis simplement que cela n’a aucune efficacité sur le plan de la capacité à refaire corps et à essayer de vivre les uns à côté des autres et, encore mieux, les uns avec les autres.
Au fond, plus on est faible sur les finalités que l’on doit poursuivre, plus on doit devenir fort sur les procédures et les méthodes. Lorsque vous êtes forts sur les fins que vous poursuivez et lorsque vous savez les énoncer clairement, vous avez besoin de moins de procédures. Je peux comprendre l’agacement des gens qui voudraient voir interdire, une fois pour toutes, le voile dans l’espace public. Mais au nom de quoi ? Je me mets à la place de certains musulmans. Pourquoi des personnes pourraient porter des voiles sur la tête lorsque des processions sont faites dans la rue pour des fêtes religieuses chrétiennes, alors que les femmes musulmanes ne le peuvent pas ? On va me dire que c’est à cause de la civilisation.
Si vous imaginez la variété des raisons pour lesquelles les femmes musulmanes se mettent à porter le voile, vous seriez surpris. Il n’y a pas qu’une logique de soumission. Il y a aussi une logique de protection, de pudeur et d’affirmation identitaire. C’est parce que nous avons renoncé à notre idéal de civilisation que les gens vont chercher ailleurs. Au fond, la prolifération de l’islam et sa capacité à s’installer en France durablement ne se nourrissent que de la faiblesse de notre propre conviction à défendre notre civilisation.
D’un point de vue très pragmatique, que faudrait-il mettre en place ? Est-ce que la fermeture des frontières et les contrôles d’immigration sont efficaces ?
Il faut faire tout cela en ayant conscience que ce sont des signaux politiques et que cela ne va rien régler du jour au lendemain. Comme je le disais tout à l’heure, le meurtrier de Rambouillet est en France depuis dix ans. Même si vous fermez les frontières maintenant, cela ne réglera rien pour ceux qui sont déjà rentrés. Mais c’est un signal politique et l’affirmation d’une volonté. Si, effectivement, vous cessez les naturalisations pendant un temps, vous envoyez un signal politique. Si vous décidez de faire une vraie bagarre aux clandestins, et peu importe que vous n’en expulsiez que 2 ou 3 %, cela envoie tout de même des signaux politiques. Cela ne traite pas la question des attentats terroristes, mais cela envoie des messages à ceux venant des pays étrangers qui pourraient considérer qu’ils peuvent être les bienvenus en France. Cela ne peut plus être le cas.
L’attentat de vendredi est encore une manifestation qui fait suite aux dizaines d’agression, toutes les semaines, sur tout le territoire, contre les forces de police. Un de mes amis m’expliquait que, dans la métropole lyonnaise, les forces de l’ordre sont agressées presque tous les soirs. La seule réponse du gouvernement est de dire « on sera ferme ». Mais lorsqu’on est ferme comme au tribunal de Créteil, lorsque les criminels de Viry-Châtillon ont été blanchis pour certains d’entre eux par la Justice, ce n’est pas formidable en termes d’efficacité. Au fond, c’est la réflexion sur les causes de cette violence et sur la désespérance qui atteint le peuple français et sur le fait que nous sommes en train de toucher la limite d’un système matérialiste et d’un système de consommation. Nous sommes en train de toucher la limite de la vision individualiste du corps social. Tout cela n’engendre que de la violence. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de régulation spirituelle, et je ne parle même pas de religion. Nous avons renoncé à notre ferment de civilisation, donc nous n’avons plus de régulation spirituelle. Par conséquent, la violence s’installe.
Il y a quelque chose de presque mécanique. C’est une constante historique que nous voyons à peu près partout. Qui s’apprête à traiter ce sujet politique ? Qui s’apprête à placer le débat sur ce bon niveau politique ? Les autres sont des enjeux de gestion. Je ne suis pas contre la fermeture des frontières, je l’approuve. Je suis d’accord pour que l’on arrête de naturaliser. Je ne peux pas être accusé de complaisance à l’égard de l’islam comme doctrine. Mais la racine de tout cela est le fait que nous ne savons plus qui nous sommes. Nous sommes diversement entendus. Peut-être que, cette fois-ci, nous le serons un peu plus et, malheureusement, la fois d’après, encore davantage.




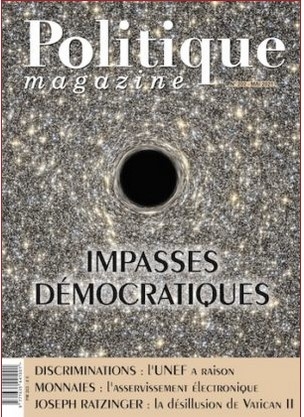


 Dans Le Monde du 18 novembre 1952, deux jours après la mort de Maurras, André Fontaine écrivait ces lignes : « Devant cette tombe ouverte, devant le corps d'un homme qui, cinquante ans durant, a honoré les lettres et le génie français, ne serait-il plus possible de tenter d'être juste ? » Pour le centième anniversaire de sa naissance, le même journal, le 20 avril 1968, consacrait une double page à Charles Maurras, avec un article critique de l'académicien Pierre-Henri Simon (« Puissance et fissures d'une pensée »), et un autre de Gilbert Comte, un journaliste maison, qui invitait à redécouvrir, au-delà du « Maurras intraitable des quinze dernières années, durci par le malheur, figé dans son orthodoxie », le « jeune prophète conquérant du renouveau royaliste ». En 2018, là est le paradoxe : l'aversion à l'égard de Maurras est inversement proportionnelle à son éloignement dans le temps.
Dans Le Monde du 18 novembre 1952, deux jours après la mort de Maurras, André Fontaine écrivait ces lignes : « Devant cette tombe ouverte, devant le corps d'un homme qui, cinquante ans durant, a honoré les lettres et le génie français, ne serait-il plus possible de tenter d'être juste ? » Pour le centième anniversaire de sa naissance, le même journal, le 20 avril 1968, consacrait une double page à Charles Maurras, avec un article critique de l'académicien Pierre-Henri Simon (« Puissance et fissures d'une pensée »), et un autre de Gilbert Comte, un journaliste maison, qui invitait à redécouvrir, au-delà du « Maurras intraitable des quinze dernières années, durci par le malheur, figé dans son orthodoxie », le « jeune prophète conquérant du renouveau royaliste ». En 2018, là est le paradoxe : l'aversion à l'égard de Maurras est inversement proportionnelle à son éloignement dans le temps.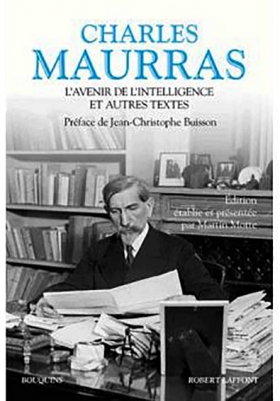 Tout penseur doit être soumis à un bilan critique, ce qui suppose de connaître son œuvre. Entreprise malaisée, dans le cas de Maurras, auteur de milliers d'articles et d'une centaine de livres introuvables ailleurs que chez les bouquinistes. Or, voici enfin la possibilité de le lire grâce à la publication, dans la collection « Bouquins » de Robert Laffont, d'un volume de près de 1300 pages reprenant un choix de ses textes philosophiques, littéraires et politiques, et de ses poèmes. Cette édition, établie et présentée par Martin Motte, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études, est préfacée par Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, qui signe une utile introduction à la vie et à l'action d'un homme souvent cité, mais si peu connu.
Tout penseur doit être soumis à un bilan critique, ce qui suppose de connaître son œuvre. Entreprise malaisée, dans le cas de Maurras, auteur de milliers d'articles et d'une centaine de livres introuvables ailleurs que chez les bouquinistes. Or, voici enfin la possibilité de le lire grâce à la publication, dans la collection « Bouquins » de Robert Laffont, d'un volume de près de 1300 pages reprenant un choix de ses textes philosophiques, littéraires et politiques, et de ses poèmes. Cette édition, établie et présentée par Martin Motte, directeur d'études à l'Ecole pratique des hautes études, est préfacée par Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, qui signe une utile introduction à la vie et à l'action d'un homme souvent cité, mais si peu connu.


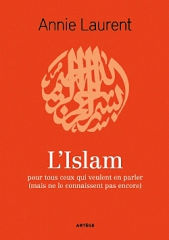



 Tempête à la tête de Les Républicains. Laurent Wauquiez, le président, vient de destituer la vice-présidente, Virginie Calmels, qui contestait sa ligne. Ce genre de prise de bec ne doit pas surprendre en un parti dépourvu d’unité et tiré à hue et à dia par ses ténors du moment.
Tempête à la tête de Les Républicains. Laurent Wauquiez, le président, vient de destituer la vice-présidente, Virginie Calmels, qui contestait sa ligne. Ce genre de prise de bec ne doit pas surprendre en un parti dépourvu d’unité et tiré à hue et à dia par ses ténors du moment. État minimal sur les prérogatives régaliennes, renoncement de fait aux fondements théoriques et aux « valeurs » morales de la droite, recherche effrénée d’un consensus éthique et politique entre droite modérée, centristes et ce qui reste de la gauche sociale-libérale ou sociale-démocrate, souplesse dans la limitation de l’immigration et la lutte contre le terrorisme. Elle pourrait reprendre à son compte le propos du non-regretté Michel Guy en son temps, lequel se disait « de droite pour l’économie, de gauche pour tout le reste ».
État minimal sur les prérogatives régaliennes, renoncement de fait aux fondements théoriques et aux « valeurs » morales de la droite, recherche effrénée d’un consensus éthique et politique entre droite modérée, centristes et ce qui reste de la gauche sociale-libérale ou sociale-démocrate, souplesse dans la limitation de l’immigration et la lutte contre le terrorisme. Elle pourrait reprendre à son compte le propos du non-regretté Michel Guy en son temps, lequel se disait « de droite pour l’économie, de gauche pour tout le reste ».





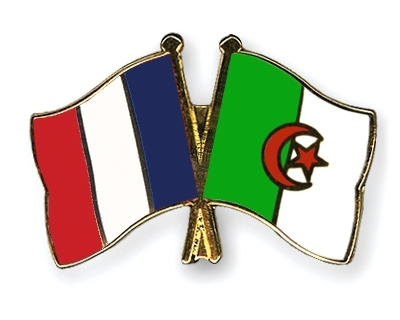




 Et, comme ces observations de bon sens le faisaient traiter de catholique et de clérical, « oui », ripostait Proudhon, « oui, je suis, par position, catholique, clérical, si vous voulez, puisque la France, ma patrie, n'a pas encore cessé de l'être, que les Anglais sont anglicans, les Prussiens protestants, les Suisses calvinistes, les Américains unitaires, les Russes grecs ; parce que, tandis que nos missionnaires se font martyriser en Cochinchine, ceux de l'Angleterre vendent des Bibles et autres articles de commerce. » Des raisons plus hautes encore inspiraient Proudhon, et il osait écrire : « La Papauté abolie, vingt pontificats pour un vont surgir, depuis celui du Père Enfantin, jusqu'à celui du Grand Maître des Francs-Maçons » , et il répétait avec une insistance désespérée : « Je ne veux ni de l'unité allemande, ni de l'unité italienne ; je ne veux d'aucun pontificat. »
Et, comme ces observations de bon sens le faisaient traiter de catholique et de clérical, « oui », ripostait Proudhon, « oui, je suis, par position, catholique, clérical, si vous voulez, puisque la France, ma patrie, n'a pas encore cessé de l'être, que les Anglais sont anglicans, les Prussiens protestants, les Suisses calvinistes, les Américains unitaires, les Russes grecs ; parce que, tandis que nos missionnaires se font martyriser en Cochinchine, ceux de l'Angleterre vendent des Bibles et autres articles de commerce. » Des raisons plus hautes encore inspiraient Proudhon, et il osait écrire : « La Papauté abolie, vingt pontificats pour un vont surgir, depuis celui du Père Enfantin, jusqu'à celui du Grand Maître des Francs-Maçons » , et il répétait avec une insistance désespérée : « Je ne veux ni de l'unité allemande, ni de l'unité italienne ; je ne veux d'aucun pontificat. » 

 Nos compatriotes inclinent à percevoir le président comme le représentant des maîtres du pouvoir économique, et ne pensent pas que, de toute façon, même s’il le désirait, ou même s’il était remplacé par quelque autre, il puisse mettre en œuvre une politique qui ne satisferait pas les intérêts des détenteurs de capitaux. Ils sont, au fond, pénétrés de cette conviction fataliste que la politique d’austérité est « la seule politique possible », comme disait Alain Juppé, au temps où il était Premier ministre, en 1995. À cette époque, les Français ne se résignaient pas à ce douloureux principe de réalité, et ils partaient en grève à la moindre annonce de réforme de la SNCF ou du régime des retraites. Puis, vaincus par le découragement et par l’expérience vécue de la dégradation continue de leurs conditions de vie, déçus par les mensonges et palinodies des partis (à commencer par le PS), ils ont accepté ce qu’ils refusaient quelque vingt ans plus tôt : la réforme du Code du Travail, la réforme de la SNCF, celle des études secondaires et de l’accès aux études supérieures, etc. Ils ont, certes, montré avec le mouvement des Gilets jaunes les limites de ce qu’ils pouvaient supporter. Mais ils sont néanmoins sans illusion. Et cela explique à la fois la résignation de ceux qui souhaitent un arrêt du mouvement, persuadés de l’inanité de la poursuite de cette action, et la détermination désespérée de ceux qui rechignent à lever le camp, refusant que tout continue comme avant. C’est la révolte de l’impuissance, de tous ceux qui sont écrasés par des forces économiques qui les asservissent, et qui ne voient pas comment s’en délivrer pour améliorer leur sort, et qui croient leurs dirigeants politiques aussi incapables qu’eux-mêmes de changer les choses (les socialistes, en 1981, disaient « changer la vie »), à supposer qu’ils en aient l’intention. Ce que révèle le mouvement des Gilets jaunes, c’est que les Français sont des victimes impuissantes, et qui croient leurs dirigeants eux aussi impuissants. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont infirmer ce jugement. Dernièrement, nous avons vu Ford refuser tout net le sauvetage de son usine de Blanquefort, malgré ses promesses, à la colère de notre ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui ne peut rien faire d’autre que se déclarer « indigné » et « écœuré », c’est-à-dire trépigner d’une rage impuissante. Certes, M. Le Maire, inspecteur des Finances, connaît très bien le monde de l’industrie et du business, et est donc peut-être moins surpris et indigné qu’il ne l’affirme. Mais cette hypothèse confirmerait alors l’idée d’une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique (nonobstant certains accrocs), et cela n’est pas fait pour réconcilier les Français avec leurs représentants et dirigeants.
Nos compatriotes inclinent à percevoir le président comme le représentant des maîtres du pouvoir économique, et ne pensent pas que, de toute façon, même s’il le désirait, ou même s’il était remplacé par quelque autre, il puisse mettre en œuvre une politique qui ne satisferait pas les intérêts des détenteurs de capitaux. Ils sont, au fond, pénétrés de cette conviction fataliste que la politique d’austérité est « la seule politique possible », comme disait Alain Juppé, au temps où il était Premier ministre, en 1995. À cette époque, les Français ne se résignaient pas à ce douloureux principe de réalité, et ils partaient en grève à la moindre annonce de réforme de la SNCF ou du régime des retraites. Puis, vaincus par le découragement et par l’expérience vécue de la dégradation continue de leurs conditions de vie, déçus par les mensonges et palinodies des partis (à commencer par le PS), ils ont accepté ce qu’ils refusaient quelque vingt ans plus tôt : la réforme du Code du Travail, la réforme de la SNCF, celle des études secondaires et de l’accès aux études supérieures, etc. Ils ont, certes, montré avec le mouvement des Gilets jaunes les limites de ce qu’ils pouvaient supporter. Mais ils sont néanmoins sans illusion. Et cela explique à la fois la résignation de ceux qui souhaitent un arrêt du mouvement, persuadés de l’inanité de la poursuite de cette action, et la détermination désespérée de ceux qui rechignent à lever le camp, refusant que tout continue comme avant. C’est la révolte de l’impuissance, de tous ceux qui sont écrasés par des forces économiques qui les asservissent, et qui ne voient pas comment s’en délivrer pour améliorer leur sort, et qui croient leurs dirigeants politiques aussi incapables qu’eux-mêmes de changer les choses (les socialistes, en 1981, disaient « changer la vie »), à supposer qu’ils en aient l’intention. Ce que révèle le mouvement des Gilets jaunes, c’est que les Français sont des victimes impuissantes, et qui croient leurs dirigeants eux aussi impuissants. Et ce ne sont pas les derniers événements qui vont infirmer ce jugement. Dernièrement, nous avons vu Ford refuser tout net le sauvetage de son usine de Blanquefort, malgré ses promesses, à la colère de notre ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, qui ne peut rien faire d’autre que se déclarer « indigné » et « écœuré », c’est-à-dire trépigner d’une rage impuissante. Certes, M. Le Maire, inspecteur des Finances, connaît très bien le monde de l’industrie et du business, et est donc peut-être moins surpris et indigné qu’il ne l’affirme. Mais cette hypothèse confirmerait alors l’idée d’une collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique (nonobstant certains accrocs), et cela n’est pas fait pour réconcilier les Français avec leurs représentants et dirigeants. À l’évidence, un tel pouvoir ne peut plus prétendre représenter la nation. Souvenons-nous, d’ailleurs, que M. Macron n’est que l’élu des deux tiers de 43% d’électeurs inscrits, autrement dit d’une très étroite minorité. L’affaire des Gilets jaunes aura aggravé ce déficit de légitimité. Il est d’ailleurs inquiétant de songer à la possible influence de ce mouvement sur notre vie politique. À quoi ressemblerait une république des Gilets jaunes ? À une sorte d’anarchie, sans dirigeants, sans hiérarchie, sans représentants élus. Quelle peut être l’influence des Gilets jaunes sur les élections ? Une phénoménale abstention, ou des listes ou candidatures individuelles de Gilets jaunes absolument dissonantes. Cela promet.
À l’évidence, un tel pouvoir ne peut plus prétendre représenter la nation. Souvenons-nous, d’ailleurs, que M. Macron n’est que l’élu des deux tiers de 43% d’électeurs inscrits, autrement dit d’une très étroite minorité. L’affaire des Gilets jaunes aura aggravé ce déficit de légitimité. Il est d’ailleurs inquiétant de songer à la possible influence de ce mouvement sur notre vie politique. À quoi ressemblerait une république des Gilets jaunes ? À une sorte d’anarchie, sans dirigeants, sans hiérarchie, sans représentants élus. Quelle peut être l’influence des Gilets jaunes sur les élections ? Une phénoménale abstention, ou des listes ou candidatures individuelles de Gilets jaunes absolument dissonantes. Cela promet.