”Anemic cinéma”, par Michel Onfray.
LES CÉSARS D'UN EMPIRE EFFONDRÉ
Cette anagramme, Anemic cinema, est de Marcel Duchamp. A ce jour, elle a donc déjà plus d’un siècle… A l’époque où ce bon mot, qui est aussi une bonne idée, se trouve proféré, le cinéma lui-même est vieux d’une vingtaine d’année, c’est donc un art naissant.
Si l’on en juge par ce qu’en fit Abel Gance dans Napoléon (1927) ou, rions un peu, avec… J’accuse (1919), le cinéma offrait de magnifiques potentialités esthétiques. C’était un art nouveau, au sens littéral du terme, comme le théâtre ou l’opéra le furent en leurs temps reculés, l’antiquité grecque pour le premier, le baroque italien pour le second, il s’agissait dans ce cas de l’Europe industrielle. On était en passe d’en attendre des chefs d’œuvre, il y en eut –la plupart en noir et blanc…

 J’ai parlé du théâtre et de l’opéra: ce sont des arts qui coûtent cher, au contraire d’une peinture ou d’une sculpture, d’un recueil de poèmes ou d’une partition pour instrument seul. Car, en plus des comédiens, des acteurs ou des chanteurs lyriques, il faut à l’auteur d’une pièce ou au compositeur d’un opéra, le lourd dispositif d’un lieu avec son personnel, des régisseurs, des costumiers, des comédiens, des metteurs en scène, des éclairagistes, des machinistes, des habilleurs, des coiffeurs, des maquilleurs, des directeurs, des administrateurs, des communicants, des publicitaires, des tourneurs –j’en oublie probablement… De sorte qu’un opéra n’est pas qu’un opéra, c’est aussi une aventure commerciale.
J’ai parlé du théâtre et de l’opéra: ce sont des arts qui coûtent cher, au contraire d’une peinture ou d’une sculpture, d’un recueil de poèmes ou d’une partition pour instrument seul. Car, en plus des comédiens, des acteurs ou des chanteurs lyriques, il faut à l’auteur d’une pièce ou au compositeur d’un opéra, le lourd dispositif d’un lieu avec son personnel, des régisseurs, des costumiers, des comédiens, des metteurs en scène, des éclairagistes, des machinistes, des habilleurs, des coiffeurs, des maquilleurs, des directeurs, des administrateurs, des communicants, des publicitaires, des tourneurs –j’en oublie probablement… De sorte qu’un opéra n’est pas qu’un opéra, c’est aussi une aventure commerciale.
Longtemps ce fut aussi, mais c’est maintenant devenu surtout une affaire commerciale. Car, depuis les pleins pouvoirs donnés au Veau d’or, autrement dit après l’ère post-gaulliste donc post-Malraux, les responsables de productions culturelles n’ont plus aucun souci de la qualité d’un roman ou d’un opéra, d’un film ou d’une pièce: ils veulent enchaîner et accumuler les affaires rentables.
Le cinéma, plus qu’un autre art, est une entreprise commerciale dispendieuse: il est à notre civilisation des machines l’équivalent des pyramides ou des cathédrales pour les civilisations des pharaons ou des rois de France. C’est un art Moloch, insatiable, qui exige pour nourriture des millions de dollars.
Le film qui arrive en tête des ventes mondiales est américain, on ne s’en étonnera pas, il a pour titre: Avengers : Endgame. Les réalisateurs ont pour nom: Anthony et Joe Russo. Il a coûté 356.000.000 $ et rapporté 2.569.125.278 $: il a donc enregistré un rentabilité de 822 %. Qui dit mieux? Les trente films de ce classement mondial sont américains, seul le vingt-et-unième est anglais. Voici donc la mesure. Cette œuvre, disons-le tout de même avec ce mot-là, est classée dans le genre "super-héros"…
Le cinéma n’est pas un genre neutre, bien au contraire: il est un art de masse qui permet d’imposer la mythologie américaine en lieu et place de la vérité historique.
Par exemple: ce qui a eu lieu historiquement avec le débarquement du 6 juin 1944 n’a pas grand-chose à voir avec ce que montre Le Jour le plus long en 1962.
Pour l’histoire: Pearl-Harbour a eu lieu le 7 novembre 1941, Hitler a déclaré la guerre aux Etats-Unis le 11 décembre 1941, le III° Reich travaille à une bombe atomique depuis 1939 et à des avions à réaction, qui effectuent leur premier vol en mars 1944 -l’ingénieur nazi Wernher von Braun qui pilote ce projet sera embauché après guerre, sans passer par la case prison, par les Etats-Unis qui enverront le premier homme sur la lune grâce à son zèle. Les USA ne veulent pas qu’Hitler exporte cette guerre sur leur sol national. Ils décident donc de la mener en Europe, en commençant par la France, avec pour première hypothèse d’aller jusqu’à Moscou afin d’en finir avec le régime bolchevique. Pour ce faire, ils ont le projet de vassaliser la France: le nom de code du débarquement est Overlord, ce qui veut dire Suzerain. On ne peut mieux annoncer la couleur! Dans ce projet, la France libérée se fait immédiatement occuper par leurs libérateurs avec une politique coloniale ayant pour nom l’AMGOT (l’acronyme d’Allied Military Government of Occupied Territories, autrement dit Gouvernement militaire allié des territoires occupés). L’université de Charlottesville (Virginie) forme les cadres de cette vassalisation des Français; une monnaie est battue, des billets sont imprimés. La France sert donc de tête de pont à une opération militaire plus vaste qui vise à libérer l’Europe du national-socialisme, certes, mais également l’URSS du marxisme-léninisme. Le général de Gaulle réussira à contrecarrer ce projet américain. On connaît la suite, du moins je le suppose... Du vivant du général, la France reste souveraine. Ce qui ne sera plus le cas après son départ des affaires en 1969 et sa mort l’année suivante.
Pour le cinéma: les Américains aiment tellement la liberté qu’ils auraient mis sur pied, bénévolement, gratuitement, généreusement, gracieusement, la plus grande opération militaire de tous les temps! Ils mobilisent pour ce faire des héros du cinéma: John Wayne, Robert Mitchum, Richard Burton, Henry Fonda, Curd Jürgens, Gert Fröbe, Mel Ferrer, Clint Eastwood, John Crawford, on trouve dans l’équipe des scénaristes Romain Gary et Erich Maria Remarque, l’auteur d’A l’ouest rien de nouveau, la société de production est la Twentieth Century Fox. Pour cette super production, pas moins de quatre réalisateurs sont embauchés -Ken Annakin, Andrew Marton, Darryl F. Zanuck, Bernhard Wicki et Gerd Oswald.
En même temps, comme dirait l’autre, Bourvil, bien connu pour ses rôles d’abruti sympathique, joue celui du maire de Colleville, qui se trouve accessoirement résistant: neuneu à souhait, sot, niais, le jour du débarquement, après avoir écouté Radio-Londres sur la table de la cuisine, une radio sans fil électrique qu’il place ensuite dans le placard alors qu’elle distille encore ses messages, "Jean a de grandes moustaches" par exemple, le message qui annoncerait le jour du débarquement, Bourvil, donc, fait sauter un série de poteaux électriques en disant, la seconde qui suit, avec le style nigaud et benêt qu’on lui connait: "ça marche!", tout étonné en effet que ça puisse marcher… Une autre scène le montre avec un casque de pompier sur la tête, riant comme un crétin, apportant du champagne aux soldats américains virils qui ne mouftent pas alors qu’ils se trouvent dans le capharnaüm des plages du débarquement… Chacun aura compris que les Français sont des guignols, que les résistants sont des comiques, que les habitants des campagnes sont des arriérés et qu’il était temps que des soldats US viriloïdes arrivent pour remettre de l’ordre dans tout ça…
De l’ordre, depuis, les Américains en ont remis: ce qu’ils n’ont pas réussi à imposer avec leurs troupes et leur administration empêchés par de Gaulle, ils l’ont obtenu avec leur plan Marshall qui, après leurs tapis de bombes destinés à détruire les villes de Normandie, leur a permis de financer la reconstruction de cette guerre, donc d’engranger des bénéfices considérables, donc de faire marcher à plein la machine économique yankee.
Ils ont donc réalisé leur projet de vassalisation avec leur plan Marshall, certes, mais aussi, d’une façon magistralement gramscienne, en imposant leur mode de vie, le fameux American Way Of Life, dans lequel le cinéma n’a pas joué un petit rôle! Ajoutons à cela la fabrication du désir des objets de la société de consommation par la publicité: la télévision, la mode, le jazz, le rock, la bande dessinée, les cigarettes blondes, le chewing-gum, le coca-cola, le blue-jean, autrement dit: un Overlord light, un Débarquement cool.
Qu’on se souvienne de la chanson de Boris Vian, La complainte du progrès, c’était en 1955, il listait les désirs des Français fascinés par le modèle venu d’outre-Atlantique: un frigidaire, un joli scooter, un atomixer, un Dunlopillo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts, des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, une armoire à cuillers, un évier en fer, un poêle à mazout, un cire-godasses, un repasse-limaces, un tabouret-à-glace, un chauffe-filous, un ratatine-ordures, un coupe-friture, un efface-poussière, un chauffe-savates, un canon à patates, un éventre-tomates, un écorche-poulet. C’est avec ce vide-grenier, chacun a pu le voir depuis, que la civilisation occidentale est devenue grande…
Le cinéma comme art français inventé à l’époque de l’affaire Dreyfus, est donc devenu un commerce américain qui fournit le paradigme mondial de la profession.
Certes, il existe deux extrémités à ce bâton sans bois: le cinéma intellectuel, onaniste et cérébral, ennuyeux et narcissique, snob et prétentieux, un cinéma de cinéphiles, celui de Godard s’il faut un nom, ou bien encore de Béla Tarr, et un cinéma de distraction, disons celui des Tuche, méprisé par les amateurs du premier, une situation qui se modifiera peut-être dans un demi-siècle quand les intellectuels du moment agiront comme Olivier Mongin ou Valère Novarina qui découvrent ces temps-ci la supposée profondeur de Louis de Funès en estimant que Le Gendarme de Saint-Tropez mérite désormais de figurer dans la liste qui commence avec Méliès et Gance… Télérama et France-Inter, France-Culture et L’Obs, si tout ça existe encore, gloussera en citant Les Tuche à l’Elysée -qui sait d’ailleurs, peut-être y seront-ils, l’Etat profond pourra se permettre de les y placer puisqu’il sait bien que le pouvoir véritable se trouve ailleurs…
Le cinéma fait donc partie de cet Etat profond qui, avec les médias et les banques, la finance et l’édition, la classe politique et l’université, reproduisent une idéologie sans jamais l’interroger.
Sur les questions de l’islam et de l’immigration, de la cause LGBT et de la marchandisation des corps, du réchauffisme et du capitalisme vert, de l’écologisme et du marché, de l’abolition des frontières et du gouvernement mondial, en un mot: de la transformation de la planète en vaste marché dans lequel tout se vendrait, et où, donc, les riches réduits à la portion congrue seraient les rois du pétrole pendant que les pauvres, devenus un sous-prolétariat mondial, vivraient une condition pire que celle des esclaves, sur ces questions, donc, il n’y aurait rien à dire ou à penser, mais tout à réciter sans jamais se demander qui a écrit ce catéchisme ultra-libéral et pour quelles raisons.
Après la dernière cérémonie des Césars, fut-il dit, plus jamais rien ne serait comme avant: en effet, tout le monde a désormais compris comment fonctionnait ce petit milieu incestueux. La machine s’est trouvée mise à nu, on a vu ses rouages. En vertu du principe hégélien de ruse de la raison, cette catégorie sociétale se fait le porte-voix d’une cause qui les asservit. Ils sont les bourreaux et les victimes -"Héautontimorouménos" aurait dit Baudelaire, le marteau et l’enclume, la gifle et la joue. En effet, ils dénoncent un monde dont ils vivent et se font, de ce fait, les courroies de transmission de l’idéologie du moment en croyant incarner une avant-garde alors qu’ils ne sont que des chiens de garde.
Sous régime fasciste, sous régime vichyste, sous régime nazi, sous régime communiste, sous régime franquiste, sous régime maoïste, sous régime capitaliste, sous régime libéral, sous régime maastrichtien, sauf rares exceptions, le cinéma est toujours l’un des engrenages de l’idéologie dominante. De la même manière que le cinéma américain est un cinéma de propagande qui défend son idéologie partout sur la planète, le cinéma européen vend la camelote maastrichtienne égocentrée, narcissique, célébrant avec force encens les mantras qui imposent la tyrannie des minorités. Dans un grand geste d’auto-congratulation, cette idéologie se nomme progressiste alors qu’elle n’est que progrès dans le nihilisme.
J’ai lu avec plaisir un livre enlevé et drôle d’Eric Neuhoff intitulé (Très) Cher Cinéma français (Albin Michel). Dans ce texte voltairien, il dénonce ce cinéma exsangue mieux que je ne pourrais le faire avec force exemples et quantité de détails.
Le cinéma a cessé d’être un art, faute de combattants ; il est devenu un marché, il a pour commerciaux, des voyageurs de commerce allant de festival en festival, des légions armées; le nom de leurs maréchaux se retrouve dans la liste bidon des Français prétendument préférés des Français.
Le paradoxe du comédien de Diderot a trouvé sa résolution: un grand nombre de gens qui font profession de changer d’identité tous les jours, plusieurs fois par jour même pour certains, s’offrent une difficile identité en ville à moindre frais. Rien n’est plus simple dans cas cas-là que d’enfiler les idées du jour comme un imperméable dont on se défait le moment venu. Or, ce vêtement est un uniforme -mais, ne leur dites pas, ils l’ignorent sous prétexte qu’il est signé par de grands couturiers…
Michel Onfray




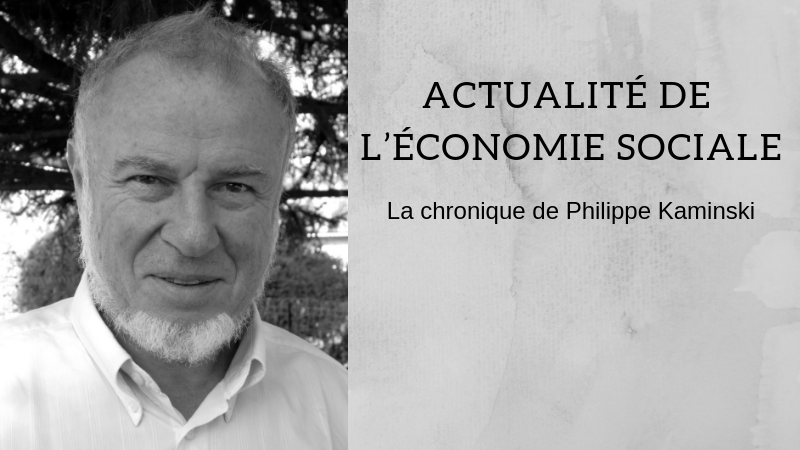












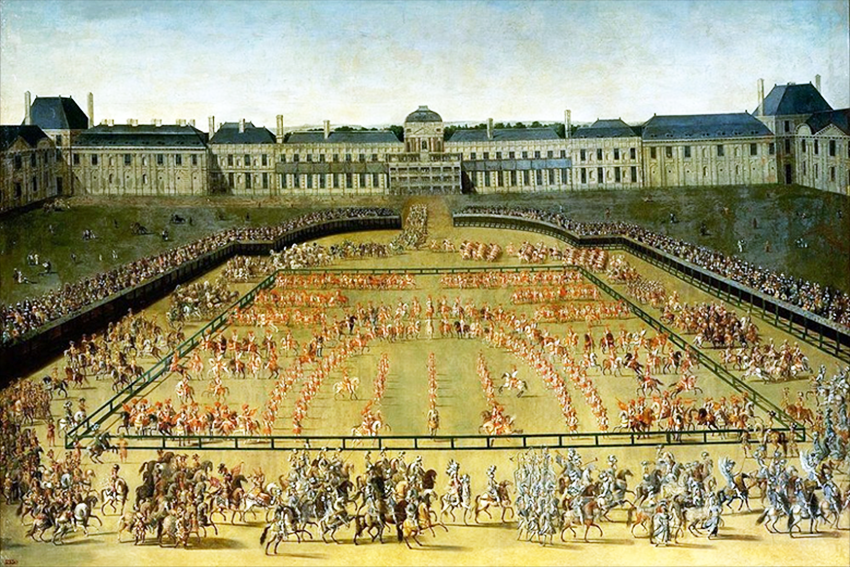



 Le sociologue Michel Maffesoli livre un texte consacré à la sécession du peuple à l’occasion du mouvement des Gilets Jaunes, et au désarroi des élites. En cette période troublée, conséquence inéluctable des profondes mutations à l’œuvre dans nos sociétés, peut-être n’est-il pas inutile de se souvenir de la distinction proposée par Nicolas Machiavel entre « la pensée du Palais » et « la pensée de la place publique ! »
Le sociologue Michel Maffesoli livre un texte consacré à la sécession du peuple à l’occasion du mouvement des Gilets Jaunes, et au désarroi des élites. En cette période troublée, conséquence inéluctable des profondes mutations à l’œuvre dans nos sociétés, peut-être n’est-il pas inutile de se souvenir de la distinction proposée par Nicolas Machiavel entre « la pensée du Palais » et « la pensée de la place publique ! »


 Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner ne se serait rendu compte de la gravité des faits que le soir du même samedi 16 mars vers 17 heures passées, après le saccage du Fouquet’s. Eh oui, ce n’est qu’alors, qu’il aurait compris que « ses instructions de la plus grande fermeté » n’avaient pas été exécutées, obligeant le chef de l’État, son ami, son patron, pour ne pas dire son parrain, à revenir de toute urgence de la station de ski des Pyrénées où il pensait s’offrir en toute tranquillité avec Brigitte, loin des Gilets jaunes, deux jours de détente bien méritée. Un sabotage, quoi, et qui expliquait tout ! « Un échec », avouait devant micros et caméras, avec la modeste ingénuité d’un truand repenti, notre Castaner national, lui qui se sent – il l’a fait savoir solennellement – toujours en service de haute vigilance, même au-delà de minuit, même au plus profond des boîtes de nuit, même après moult verres de vodka, même dans les bras câlins d’une jeune collaboratrice de ses précédentes fonctions.
Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner ne se serait rendu compte de la gravité des faits que le soir du même samedi 16 mars vers 17 heures passées, après le saccage du Fouquet’s. Eh oui, ce n’est qu’alors, qu’il aurait compris que « ses instructions de la plus grande fermeté » n’avaient pas été exécutées, obligeant le chef de l’État, son ami, son patron, pour ne pas dire son parrain, à revenir de toute urgence de la station de ski des Pyrénées où il pensait s’offrir en toute tranquillité avec Brigitte, loin des Gilets jaunes, deux jours de détente bien méritée. Un sabotage, quoi, et qui expliquait tout ! « Un échec », avouait devant micros et caméras, avec la modeste ingénuité d’un truand repenti, notre Castaner national, lui qui se sent – il l’a fait savoir solennellement – toujours en service de haute vigilance, même au-delà de minuit, même au plus profond des boîtes de nuit, même après moult verres de vodka, même dans les bras câlins d’une jeune collaboratrice de ses précédentes fonctions. Depuis le mois de novembre, Collomb s’étant judicieusement esbigné, c’est donc lui qui fait face à la révolte des Gilets jaunes. On sait suffisamment comment des groupes de casseurs s’en mêlèrent sans que jamais il ne fut apparemment possible de les cerner ni de les empêcher de nuire pour permettre aux Gilets jaunes de manifester selon le droit. Dès le mois de décembre, après les incidents de l’Arc de Triomphe, Castaner peut donc amalgamer dans son discours officiel casseurs et Gilets jaunes, prenant les dispositions en conséquence et justifiant la répression avec tous les moyens, dont les lanceurs de balles de défense (LBD 40) – il en a même expliqué l’usage aux enfants des écoles ! – et les grenades à effet de souffle, dites de désencerclement (GLI-F4). Le but politique était si évident que personne, ni à droite ni à gauche, ni surtout dans la police, n’en était dupe.
Depuis le mois de novembre, Collomb s’étant judicieusement esbigné, c’est donc lui qui fait face à la révolte des Gilets jaunes. On sait suffisamment comment des groupes de casseurs s’en mêlèrent sans que jamais il ne fut apparemment possible de les cerner ni de les empêcher de nuire pour permettre aux Gilets jaunes de manifester selon le droit. Dès le mois de décembre, après les incidents de l’Arc de Triomphe, Castaner peut donc amalgamer dans son discours officiel casseurs et Gilets jaunes, prenant les dispositions en conséquence et justifiant la répression avec tous les moyens, dont les lanceurs de balles de défense (LBD 40) – il en a même expliqué l’usage aux enfants des écoles ! – et les grenades à effet de souffle, dites de désencerclement (GLI-F4). Le but politique était si évident que personne, ni à droite ni à gauche, ni surtout dans la police, n’en était dupe. « Des instructions de retenue » auraient été données aux forces de l’ordre au rebours « des directives offensives » du ministre. Frédéric Dupuch a fait circuler une note – sans même en référer au préfet de police, précise-t-on – engageant à un usage plus modéré des LBD, ce qui, en soi, étant donné les risques graves encourus, les nombreuses blessures et plaintes ainsi que les condamnations sans appel des instances supranationales, se comprend parfaitement. Et d’autant plus que la direction de la Sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) avait créé après le 1er décembre les détachements d’action rapide (DAR) à qui revenaient les interpellations sur le tas et la sécurité des manifestations. Il y avait ainsi deux centres opérationnels. Soit. C’était une garantie de pondération ; et il y avait un commandement unique qui restait sous les ordres de Beauvau et de l’Élysée. Mais l’Élysée et Beauvau ne veulent plus qu’une seule machine unifiée de répression et il faut donc mettre au pas la grande maison de la Préfecture de Police qui a ses structures, ses habitudes et ses logiques qui lui viennent de son histoire et de sa connaissance des situations. La crise permet donc à Macron – et à Castaner sous ses ordres – de régler la question de la sécurité et de l’ordre public comme sont réglées toutes les autres questions de finances, de politique, de société : tout pouvoir entre les mains de l’exécutif en la personne du président de la République. C’est simple… et c’est fou.
« Des instructions de retenue » auraient été données aux forces de l’ordre au rebours « des directives offensives » du ministre. Frédéric Dupuch a fait circuler une note – sans même en référer au préfet de police, précise-t-on – engageant à un usage plus modéré des LBD, ce qui, en soi, étant donné les risques graves encourus, les nombreuses blessures et plaintes ainsi que les condamnations sans appel des instances supranationales, se comprend parfaitement. Et d’autant plus que la direction de la Sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) avait créé après le 1er décembre les détachements d’action rapide (DAR) à qui revenaient les interpellations sur le tas et la sécurité des manifestations. Il y avait ainsi deux centres opérationnels. Soit. C’était une garantie de pondération ; et il y avait un commandement unique qui restait sous les ordres de Beauvau et de l’Élysée. Mais l’Élysée et Beauvau ne veulent plus qu’une seule machine unifiée de répression et il faut donc mettre au pas la grande maison de la Préfecture de Police qui a ses structures, ses habitudes et ses logiques qui lui viennent de son histoire et de sa connaissance des situations. La crise permet donc à Macron – et à Castaner sous ses ordres – de régler la question de la sécurité et de l’ordre public comme sont réglées toutes les autres questions de finances, de politique, de société : tout pouvoir entre les mains de l’exécutif en la personne du président de la République. C’est simple… et c’est fou. L’opération n’a pas été faite. Beauvau commandait. Une fois les Champs-Élysées gagnés, les black blocs étaient les maîtres. La préfecture n’y pouvait plus rien ; elle ne pouvait que chercher à limiter la casse dans Paris.
L’opération n’a pas été faite. Beauvau commandait. Une fois les Champs-Élysées gagnés, les black blocs étaient les maîtres. La préfecture n’y pouvait plus rien ; elle ne pouvait que chercher à limiter la casse dans Paris.