La Monarchie royale, garantie d'une transition démocratique apaisée ?, par Jean-Philippe Chauvin.
La démocratie n’est pas toujours un long fleuve tranquille, et les récents événements survenus aux États-Unis autour et au sein même du Capitole en sont une preuve indéniable, du moins pour ceux qui cherchent le sens des choses plutôt que l’écume des seuls faits.

 La difficulté de M. Trump à accepter de quitter la Maison Blanche et les émeutes du 6 janvier (qui ressemblaient plus à un mouvement de colère qu’à une conjuration réfléchie) nous rappellent que la transition démocratique dépend aussi d’un contrat politique dans lequel la défaite est possible et le pouvoir issu de l’élection remis en cause à chaque nouvelle élection, deux éléments constitutifs des régimes démocratiques et, a priori, non négociables. Or, ces éléments doivent être intégrés autant par les dirigeants désignés par le suffrage (appartenant au « pays légal » sans en être toujours les véritables maîtres) que par les électeurs eux-mêmes (issus du « pays réel » sans en incarner toutes les dimensions et diversités). Dans le récent cas états-unien, c’est l’ancien président qui, bien que défait par le suffrage de façon assez nette (malgré les fraudes possibles, qui semblent néanmoins s’équilibrer de part et d’autre), a brisé le consensus autour de la nécessaire acceptation du sort des urnes, laissant souffler l’esprit de suspicion sur l’ensemble du scrutin et risquant de ruiner ses possibles chances d’un nouveau mandat dans quatre ans, tout en donnant raison à ceux de ses détracteurs qui, pour certains d’entre eux, avaient jadis contesté le résultat de novembre 2016 favorable à M. Trump. Bien sûr, la déception devant un résultat qui ne correspond ni à vos attentes ni à ce qui semblait promis par les sondages dans certains cas (Mme Clinton avait remporté tous les sondages sans emporter les suffrages suffisants…) peut entraîner des réactions d’émotion que la raison recouvre généralement le lendemain. Dans le cas de M. Trump, l’émotion est restée intacte jusqu’au 6 janvier, au point de menacer la transition démocratique et de fragiliser durablement ce processus et ce consensus d’acceptation parmi la population des États-Unis qui, désormais, seront peut-être moins certains lors des prochains scrutins.
La difficulté de M. Trump à accepter de quitter la Maison Blanche et les émeutes du 6 janvier (qui ressemblaient plus à un mouvement de colère qu’à une conjuration réfléchie) nous rappellent que la transition démocratique dépend aussi d’un contrat politique dans lequel la défaite est possible et le pouvoir issu de l’élection remis en cause à chaque nouvelle élection, deux éléments constitutifs des régimes démocratiques et, a priori, non négociables. Or, ces éléments doivent être intégrés autant par les dirigeants désignés par le suffrage (appartenant au « pays légal » sans en être toujours les véritables maîtres) que par les électeurs eux-mêmes (issus du « pays réel » sans en incarner toutes les dimensions et diversités). Dans le récent cas états-unien, c’est l’ancien président qui, bien que défait par le suffrage de façon assez nette (malgré les fraudes possibles, qui semblent néanmoins s’équilibrer de part et d’autre), a brisé le consensus autour de la nécessaire acceptation du sort des urnes, laissant souffler l’esprit de suspicion sur l’ensemble du scrutin et risquant de ruiner ses possibles chances d’un nouveau mandat dans quatre ans, tout en donnant raison à ceux de ses détracteurs qui, pour certains d’entre eux, avaient jadis contesté le résultat de novembre 2016 favorable à M. Trump. Bien sûr, la déception devant un résultat qui ne correspond ni à vos attentes ni à ce qui semblait promis par les sondages dans certains cas (Mme Clinton avait remporté tous les sondages sans emporter les suffrages suffisants…) peut entraîner des réactions d’émotion que la raison recouvre généralement le lendemain. Dans le cas de M. Trump, l’émotion est restée intacte jusqu’au 6 janvier, au point de menacer la transition démocratique et de fragiliser durablement ce processus et ce consensus d’acceptation parmi la population des États-Unis qui, désormais, seront peut-être moins certains lors des prochains scrutins.
Ce qui est vrai aux États-Unis peut-il l’être en France, aujourd’hui profondément déchirée entre des camps qui, depuis la révolte des Gilets jaunes, ne se parlent plus et se côtoient à peine et, en tout cas, ne se comprennent pas, leur langage et leurs principes étant de moins en moins communs ? Un indice inquiète : lorsqu’un sondage de la semaine dernière a placé Mme Le Pen à courte distance de la victoire à la prochaine présidentielle de 2022, les réactions (beaucoup moins nombreuses qu’attendues, au regard de ce qu’avait déclenché la qualification de M. Le Pen père en avril 2002) n’ont guère rassuré les tenants de la légitimité démocratique, nombre de citoyens (en particulier fonctionnaires d’État) annonçant qu’ils ne se soumettraient pas à un tel résultat et qu’ils entreraient en résistance active, sans que l’on sache exactement jusqu’où cette résistance autoproclamée pourrait aller… Le même discours est régulièrement tenu par nombre d’artistes, prêts à s’exiler d’une France « lepeniste » tel Victor Hugo se réfugiant à Guernesey pour ne pas avoir à saluer le nouvel empereur issu à la fois de l’élection (1) et, plus tard, du plébiscite démocratique à défaut d’être très régulier (2) ! L’on semble oublier que, lors de l’élection de Nicolas Sarkozy au poste suprême en mai 2007, de nombreuses grandes villes avaient assisté à des manifestations de protestation et de non-reconnaissance du résultat du scrutin, avec quelques dégâts à la clé, et que, après celle de François Hollande, un mouvement « Hollande n’est pas mon président » avait rapidement émergé et fait florès au cœur des manifestations hostiles au mariage homosexuel avant que de muer, avec une base élargie dès l’automne 2018 par le mouvement des Gilets jaunes, en mouvement « anti-Macron ».
Ce mouvement n’est sans doute pas inédit au regard de l’histoire de la démocratie en France, mais il semble prendre, depuis quelques temps, une ampleur nouvelle, au risque de fragiliser, non seulement les bases de la démocratie elle-même, mais aussi et surtout toute possibilité d’une transition paisible d’un président à un autre, la minorité électorale se sentant lésée et non plus seulement perdante « à la régulière ». Or, la démocratie et toute vie politique équilibrée nécessitent une reconnaissance de la défaite comme de la victoire, non pour s’en féliciter forcément (en particulier dans le premier cas…), mais pour permettre la possibilité d’une « revanche » (non pas dans le sens d’une vengeance mais, au contraire, d’une alternance ou, mieux, d’une alternative qui puisse satisfaire le camp du vainqueur sans humilier inutilement le camp du vaincu). Vaille que vaille, c’est ce modèle qui prédomine en France sous la Cinquième République, et il faut s’en féliciter, en particulier en tant que royaliste attaché à l’unité du pays et au concert des libertés. Ce qui ne signifie pas qu’il faille s’en contenter, bien évidemment !
Mais les remises en cause contemporaines de la légitimité démocratique doivent inciter à réfléchir aux meilleurs moyens (3) d’assurer une transition politique entre deux parties différentes (au regard de leurs propositions et pratiques institutionnelles, économiques ou sociales) de la nation sans menacer l’ordre et l’unité du pays. La virulence des débats dans la Cinquième République, virulence qui n’est pas toujours une mauvaise chose si la passion alimente la vie politique sans la détruire, s’explique aussi et peut-être principalement par la volonté de conquérir la « première place », ce faîte de l’État qui, dans une République centralisée comme la française et « monocratique » (certains diraient « monarchique ») comme la Cinquième, est parée de tous les attributs du prestige et de la puissance et, donc, attire toutes les convoitises et, parfois, les prédations… En libérant la « première place », cette magistrature suprême de l’État aujourd’hui livrée au Suffrage et à cet éternel combat des chefs qui transforme la vie politique en une « présidentielle permanente », la Monarchie royale remet les ambitions au niveau inférieur mais aussi nombre de pouvoirs indûment détenus par l’État (aujourd’hui trop envahissant) aux collectivités locales, professionnelles ou universitaires, ce que l’on pourrait nommer « les républiques françaises ». En fait, la Monarchie assure à la fois la continuité (voire la perpétuité) de l’État « par le haut » sans empêcher les transitions démocratiques entre des gouvernants d’obédiences différentes, voire adverses : le Royaume-Uni, au-delà de ce qui peut séparer son régime monarchique de celui, éventuel, de la France, montre bien tout l’intérêt de cette magistrature suprême qui ne doit rien aux querelles politiciennes et les surplombe sans renoncer à ce qu’elle est historiquement et traditionnellement, capable d’écouter et, dans le secret du salon royal, de conseiller le chef du gouvernement en exercice. Si la Monarchie royale « à la française » accorde plus de pouvoirs au souverain, elle n’en reste pas moins, une fois instaurée et enracinée (4), ce système institutionnel qui permet la continuité et l’arbitrage, ce trait d’union permanent entre les gouvernements qui se succèdent et les générations qui se suivent, sans empiéter sur les libertés « à la base » qui, garanties sans être livrées à elles-mêmes, assurent la libre circulation et l’équitable confrontation des idées…
Notes : (1) : Louis-Napoléon Bonaparte a été élu à la première élection présidentielle au suffrage universel masculin, en décembre 1848.
(2) : Après son coup d’État du 2 décembre 1851, le président « putschiste » l’a fait approuver par un plébiscite (nom ancien du référendum) qui a eu lieu du 14 au 21 décembre 1851, et qui l’a confirmé électoralement.
(3) : « Meilleurs » ne signifiant pas forcément « parfaits », la logique humaine étant parfois bien éloignée de la notion de perfection…
(4) : Le grand enjeu d’une instauration monarchique prochaine sera de réussir à s’établir et à s’enraciner, et il y faudra sans doute deux à trois générations de monarques (la durée de chacune pouvant varier sous l’effet de nombreux facteurs) pour s’assurer d’une continuité « perpétuelle ». Les échecs précédents, sur ce point particulier, de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, tout comme le succès de la Cinquième République depuis le général de Gaulle, doivent servir de leçons et permettre d’envisager la suite avec humilité mais sans crainte pour qui saura appliquer un sage empirisme organisateur…
Source : https://jpchauvin.typepad.fr/


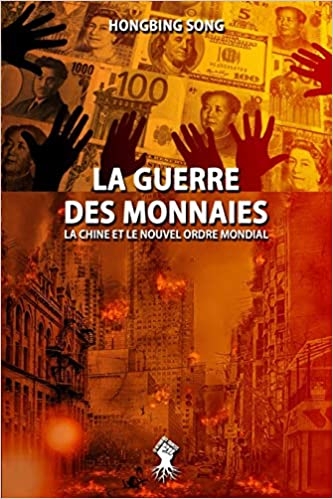
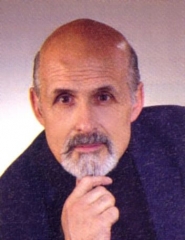








 Un mois plus tôt en totale violation du droit international et des résolutions de ce même Conseil, trois de ses membres permanents, dont la France, bombardaient la Syrie parce que des rumeurs signalaient des odeurs de chlore et des vidéos sur internet suggéraient une attaque chimique syrienne dans une banlieue de Damas. On en attend toujours les preuves. Macron avait ensuite rencontré Trump à Washington avec des démonstrations d’affection aux limites de la décence mais n’avait rien obtenu sur le dossier iranien où il croyait pouvoir peser. Dans un tel contexte, l’appel de la France « à la retenue », suite aux événements de Jérusalem, est totalement inaudible pour beaucoup d’Orientaux.
Un mois plus tôt en totale violation du droit international et des résolutions de ce même Conseil, trois de ses membres permanents, dont la France, bombardaient la Syrie parce que des rumeurs signalaient des odeurs de chlore et des vidéos sur internet suggéraient une attaque chimique syrienne dans une banlieue de Damas. On en attend toujours les preuves. Macron avait ensuite rencontré Trump à Washington avec des démonstrations d’affection aux limites de la décence mais n’avait rien obtenu sur le dossier iranien où il croyait pouvoir peser. Dans un tel contexte, l’appel de la France « à la retenue », suite aux événements de Jérusalem, est totalement inaudible pour beaucoup d’Orientaux. L’affaire fait ainsi apparaître deux visions, celle des partisans du traité de 2015, la ligne Obama, plutôt internationaliste, et celle que Trump est en train d’adopter, l’unilatéralisme sous influence israélienne. Ici, les récentes déclarations du conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ne laissent pas d’inquiéter : les nouvelles conditions qu’il veut imposer à l’Iran après la dénonciation du traité de 2015 sont inacceptables par un pays souverain. L’Amérique, poussée par Israël, cherche- t-elle le conflit ? Va-t-elle faire subir à l’Iran le même sort qu’à l’Irak ? il est peu probable que les Russes laissent faire et Trump n’a vraisemblablement pas l’intention de déclencher une guerre. En revanche, il va utiliser tous les moyens possibles pour rétablir des sanctions draconiennes et les imposer aux autres signataires du traité de 2015, en particulier la France, l’Allemagne et l’Union européenne. Or, l’Iran leur vend ses hydrocarbures et constitue en retour un marché considérable pour les entreprises européennes.
L’affaire fait ainsi apparaître deux visions, celle des partisans du traité de 2015, la ligne Obama, plutôt internationaliste, et celle que Trump est en train d’adopter, l’unilatéralisme sous influence israélienne. Ici, les récentes déclarations du conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, ne laissent pas d’inquiéter : les nouvelles conditions qu’il veut imposer à l’Iran après la dénonciation du traité de 2015 sont inacceptables par un pays souverain. L’Amérique, poussée par Israël, cherche- t-elle le conflit ? Va-t-elle faire subir à l’Iran le même sort qu’à l’Irak ? il est peu probable que les Russes laissent faire et Trump n’a vraisemblablement pas l’intention de déclencher une guerre. En revanche, il va utiliser tous les moyens possibles pour rétablir des sanctions draconiennes et les imposer aux autres signataires du traité de 2015, en particulier la France, l’Allemagne et l’Union européenne. Or, l’Iran leur vend ses hydrocarbures et constitue en retour un marché considérable pour les entreprises européennes.
 C'est une analyse importante - sous l'angle politique, juridique et institutionnel - que Mathieu Bock-Côté a publiée hier - mercredi 11 juillet - dans Le Figaro. Le grand quotidien du matin l'a fait précéder de la mention suivante : « Pour notre chroniqueur québécois, le Canada constitue l'avant-garde d'un gouvernement des juges hostile à la souveraineté populaire ». Mais, on le verra, Mathieu Bock-Côté parle tout aussi bien pour la France, notamment lorsqu'il mentionne pour la critiquer avec pertinence « la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le délit de solidarité au nom du principe de fraternité, en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. » Lorsqu'il conclut : « Pour peu [...] qu'on souhaite restaurer la souveraineté populaire, il faut convenir d'une chose : la question du régime vient de se rouvrir », nous savons bien que cette remise en cause du régime n'a pas le même sens pour lui que pour nous, qui sommes monarchistes. A nous de faire valoir nos arguments ! Lafautearousseau
C'est une analyse importante - sous l'angle politique, juridique et institutionnel - que Mathieu Bock-Côté a publiée hier - mercredi 11 juillet - dans Le Figaro. Le grand quotidien du matin l'a fait précéder de la mention suivante : « Pour notre chroniqueur québécois, le Canada constitue l'avant-garde d'un gouvernement des juges hostile à la souveraineté populaire ». Mais, on le verra, Mathieu Bock-Côté parle tout aussi bien pour la France, notamment lorsqu'il mentionne pour la critiquer avec pertinence « la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le délit de solidarité au nom du principe de fraternité, en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. » Lorsqu'il conclut : « Pour peu [...] qu'on souhaite restaurer la souveraineté populaire, il faut convenir d'une chose : la question du régime vient de se rouvrir », nous savons bien que cette remise en cause du régime n'a pas le même sens pour lui que pour nous, qui sommes monarchistes. A nous de faire valoir nos arguments ! Lafautearousseau Depuis une dizaine d'années, le Québec a amplement débattu du meilleur encadrement possible des accommodements raisonnables. Mais un rappel revenait en boucle: toute tentative de se dégager des contraintes du multiculturalisme fédéral ne passerait pas le «test des tribunaux» qui démonteraient la loi québécoise au nom de la Constitution canadienne. C'est en partie pour cela que le présent gouvernement québécois s'est contenté, avec la récente loi 62, d'un cadre minimaliste rendant obligatoire le fait d'offrir et de recevoir les services publics à visage découvert sans pousser plus loin la quête de la laïcité. Mais c'était encore trop.
Depuis une dizaine d'années, le Québec a amplement débattu du meilleur encadrement possible des accommodements raisonnables. Mais un rappel revenait en boucle: toute tentative de se dégager des contraintes du multiculturalisme fédéral ne passerait pas le «test des tribunaux» qui démonteraient la loi québécoise au nom de la Constitution canadienne. C'est en partie pour cela que le présent gouvernement québécois s'est contenté, avec la récente loi 62, d'un cadre minimaliste rendant obligatoire le fait d'offrir et de recevoir les services publics à visage découvert sans pousser plus loin la quête de la laïcité. Mais c'était encore trop. Sans plaquer la situation française sur celle du Canada, on constatera que la tendance au gouvernement des juges a depuis un bon moment traversé l'Atlantique, comme en témoigne la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le « délit de solidarité » au nom du « principe de fraternité », en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. D'ailleurs, les souverainetés nationales sont déjà très limitées, pour ne pas dire neutralisées, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui croit porter une conception transcendante du droit, alors que sa légitimité semble plus incertaine que ne le croient ses partisans.
Sans plaquer la situation française sur celle du Canada, on constatera que la tendance au gouvernement des juges a depuis un bon moment traversé l'Atlantique, comme en témoigne la récente décision du Conseil constitutionnel de supprimer le « délit de solidarité » au nom du « principe de fraternité », en limitant considérablement pour l'avenir la possibilité d'œuvrer contre l'immigration clandestine. D'ailleurs, les souverainetés nationales sont déjà très limitées, pour ne pas dire neutralisées, par la Cour européenne des droits de l'homme, qui croit porter une conception transcendante du droit, alors que sa légitimité semble plus incertaine que ne le croient ses partisans.


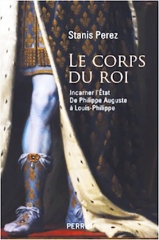






 Dans un livre controversé publié en 1994, The Curve Bell, le politologue Charles Murray et le psychologue Richard J. Herrnstein soutiennent une thèse qui va rester dans les annales : le quotient intellectuel, c’est-à-dire l’intelligence, va devenir de plus en plus déterminant pour se situer sur l’échelle sociale.
Dans un livre controversé publié en 1994, The Curve Bell, le politologue Charles Murray et le psychologue Richard J. Herrnstein soutiennent une thèse qui va rester dans les annales : le quotient intellectuel, c’est-à-dire l’intelligence, va devenir de plus en plus déterminant pour se situer sur l’échelle sociale. L’accélération technologique de ces dernières décennies change la donne à toute vitesse. Les industries du futur, qu’elles touchent à la robotisation, au Big Data, à l’économie numérique et toutes ses déclinaisons possibles autour de l’intelligence artificielle, ne demandent qu’une petite poignée de spécialistes hyper-intelligents qui, malheureusement, pourraient monopoliser les postes les plus rémunérateurs et ne laisser que des miettes au reste de la population¹.
L’accélération technologique de ces dernières décennies change la donne à toute vitesse. Les industries du futur, qu’elles touchent à la robotisation, au Big Data, à l’économie numérique et toutes ses déclinaisons possibles autour de l’intelligence artificielle, ne demandent qu’une petite poignée de spécialistes hyper-intelligents qui, malheureusement, pourraient monopoliser les postes les plus rémunérateurs et ne laisser que des miettes au reste de la population¹. Plus les gens sont intelligents, plus ils ont tendance à être patients, à comprendre les règles du jeu social et économique, et à les utiliser au plus grand bénéfice de tous. Inversement, moins les gens sont intelligents, moins ils sont patients, respectueux des règles et plus défiants. Les dix pays les plus riches et les plus productifs sont aussi les pays où le QI moyen est le plus élevé.
Plus les gens sont intelligents, plus ils ont tendance à être patients, à comprendre les règles du jeu social et économique, et à les utiliser au plus grand bénéfice de tous. Inversement, moins les gens sont intelligents, moins ils sont patients, respectueux des règles et plus défiants. Les dix pays les plus riches et les plus productifs sont aussi les pays où le QI moyen est le plus élevé. Les États pauvres, bureaucratisés et autoritaires, qui sont aussi des terres d’émigration, soumettent en règle générale des populations aux capacités cognitives plus limitées. Or l’Europe est l’objet d’une pression migratoire en provenance d’Afrique, qui, si on en croit le dernier livre de Stephen Smith La ruée vers l’Europe (2018), ne va cesser de s’intensifier dans les années à venir.
Les États pauvres, bureaucratisés et autoritaires, qui sont aussi des terres d’émigration, soumettent en règle générale des populations aux capacités cognitives plus limitées. Or l’Europe est l’objet d’une pression migratoire en provenance d’Afrique, qui, si on en croit le dernier livre de Stephen Smith La ruée vers l’Europe (2018), ne va cesser de s’intensifier dans les années à venir. Le génie biologique associé à l’essor de l’Intelligence artificielle détruirait en conséquence l’unité de l’humanité elle-même : « (…) loin de favoriser l’unité générale, la mondialisation risque de se traduire par une ‘spéciation’ : la divergence de l’humanité en castes biologiques, voire en espèces différentes
Le génie biologique associé à l’essor de l’Intelligence artificielle détruirait en conséquence l’unité de l’humanité elle-même : « (…) loin de favoriser l’unité générale, la mondialisation risque de se traduire par une ‘spéciation’ : la divergence de l’humanité en castes biologiques, voire en espèces différentes

 Aujourd'hui il reprend l'opération, mais avec en plus l'autorité du chef de l'État. Il décide du débat, des termes dans lesquels il est contenu, et s'il en fait nommer des garants en principe indépendants mais inféodés au système, c'est bien lui qui en détermine le sens général dont l'achèvement mènera à des conclusions incluses dans les prémisses. Celles qu'il a lui-même posées. Admirable tour de passe-passe d'un sophiste qui prétend parvenir à ses fins de gouvernement par l'habileté intellectuelle de ses brillants raisonnements dont l'irrémédiable défaut est tout uniment de n'être pas en accord avec la vérité des choses, la simple et si complexe réalité. Tel est Macron, tel il a toujours été. Un moderne Gorgias qui se croit maître de la cité par sa parole toute puissante, créatrice de fictives et futures réalités !
Aujourd'hui il reprend l'opération, mais avec en plus l'autorité du chef de l'État. Il décide du débat, des termes dans lesquels il est contenu, et s'il en fait nommer des garants en principe indépendants mais inféodés au système, c'est bien lui qui en détermine le sens général dont l'achèvement mènera à des conclusions incluses dans les prémisses. Celles qu'il a lui-même posées. Admirable tour de passe-passe d'un sophiste qui prétend parvenir à ses fins de gouvernement par l'habileté intellectuelle de ses brillants raisonnements dont l'irrémédiable défaut est tout uniment de n'être pas en accord avec la vérité des choses, la simple et si complexe réalité. Tel est Macron, tel il a toujours été. Un moderne Gorgias qui se croit maître de la cité par sa parole toute puissante, créatrice de fictives et futures réalités ! Le tour serait joué. Il fut prévu dans ces colonnes dès le mois de décembre. Ce n'est pas encore fait, tant c'est énorme. Macron pense ainsi obtenir une plus large participation et, selon sa stratégie éprouvée au cours des deux années passées, être le seul adversaire en face du Rassemblement National, évincer ses autres concurrents, battre le populisme, clore l'épisode des Gilets jaunes, éliminer l'opposition, faire passer sa réforme constitutionnelle sans faire appel au congrès et poursuivre sa politique dite progressiste qui va s'ouvrir bientôt aux questions dites sociétales.
Le tour serait joué. Il fut prévu dans ces colonnes dès le mois de décembre. Ce n'est pas encore fait, tant c'est énorme. Macron pense ainsi obtenir une plus large participation et, selon sa stratégie éprouvée au cours des deux années passées, être le seul adversaire en face du Rassemblement National, évincer ses autres concurrents, battre le populisme, clore l'épisode des Gilets jaunes, éliminer l'opposition, faire passer sa réforme constitutionnelle sans faire appel au congrès et poursuivre sa politique dite progressiste qui va s'ouvrir bientôt aux questions dites sociétales.

