Vu du Québec : Vive le drapeau français !

Une tribune de Mathieu Bock-Côté
Alors que François Hollande a appelé les Français à pavoiser lors de la journée d'hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre, Mathieu Bock-Côté estime, dans une tribune du Figaro du même jour (27.XI.2015) que cette agression a fait rejaillir un patriotisme refoulé depuis des années. Refoulé, d'ailleurs, par qui et pourquoi ? Nous retiendrons, sinon tous les détails, mais surtout le fond de cette réflexion où abondent remarques ou critiques justes et essentielles : « En fait, une crise comme celle provoquée par les attentats de 2015 nous force à sortir d'une théorie superficielle qui croyait pouvoir effacer les nations simplement en décrétant leur caractère périmé ou leur inutilité globale. » Pour ce qui est de pavoiser, et du drapeau, nous ajouterons, pour conclure, pour partie seulement en forme de boutade, que le drapeau du Québec nous paraît porteur d'un symbole - quatre fois répété - qui nous parle de nos racines les plus profondes, les plus anciennes et les plus vraies. Lafautearousseau
 À la grande surprise d'un système médiatique qui a mis du temps à le comprendre, et qui n'hésite pas à confesser de temps en temps sa perplexité, les Français, suite aux attentats du vendredi 13 novembre se tournent vers leur drapeau et le brandissent bien haut. Pire encore, ils chantent la Marseillaise sans même s'en excuser. François Hollande en a rajouté en invitant à pavoiser le pays alors que la gauche française, depuis un bon moment, déjà, confessait son grand malaise devant les symboles nationaux, qu'elle peinait à associer positivement à l'avenir de la France. Le propre d'un sursaut national, c'est d'emporter ceux qui, la veille encore, parlaient de leur pays avec désinvolture.
À la grande surprise d'un système médiatique qui a mis du temps à le comprendre, et qui n'hésite pas à confesser de temps en temps sa perplexité, les Français, suite aux attentats du vendredi 13 novembre se tournent vers leur drapeau et le brandissent bien haut. Pire encore, ils chantent la Marseillaise sans même s'en excuser. François Hollande en a rajouté en invitant à pavoiser le pays alors que la gauche française, depuis un bon moment, déjà, confessait son grand malaise devant les symboles nationaux, qu'elle peinait à associer positivement à l'avenir de la France. Le propre d'un sursaut national, c'est d'emporter ceux qui, la veille encore, parlaient de leur pays avec désinvolture.
Certains journalistes ont sondé les Français pour savoir ce que le drapeau tricolore représente pour eux ? Cette question en masque une autre, moins aisément avouable : comment osent-ils renouer avec ces symboles associés depuis une trentaine d'années à « l'extrême-droite » - faut-il préciser qu'on lui avait aisément concédé son monopole ? Pire encore, ces symboles ne sont-ils pas pour cela définitivement souillés ? Le mot est pourtant simple : le retour aux symboles nationaux est une manifestation pure et simple de patriotisme. L'appel au drapeau témoigne pourtant du lien absolument intime entre un homme et son pays, et plus encore, la part existentielle du lien politique.
En un mot, l'élan vers le drapeau témoigne d'un patriotisme spontané, qui se dérobe aux constructions philosophiques sophistiquées ou à son enrobage universaliste. On parle ici simplement d'une revendication d'appartenance clairement revendiquée. La philosophie politique contemporaine lorsqu'elle en reconnaît l'existence, réduit ce patriotisme à une forme de d'attachement primitif et à une communauté historique dégénérant presque inévitablement en xénophobie. Le progressisme a voulu amincir au possible la communauté politique en la réduisant à un pur système de droit exclusivement régulé par des valeurs universelles. Il s'agissait à terme de rendre toutes les sociétés interchangeables pour avancer vers une société mondiale.
Comment, dès lors, cultiver un lien presque sacré avec le pays qui est le sien, lorsqu'on le réduit à une surface plane où peuvent se déployer librement des flux mondialisés ? Car il y a bien de telles choses que des liens sacrés, au nom desquels, au fil de l'histoire, des hommes ont donné leur vie. Il semble pourtant que l'appartenance nationale soit bien plus forte que ne le croyaient certains sociologues qui n'y voyaient qu'une construction sociale assez récente et terriblement friable. En fait, une crise comme celle provoquée par les attentats de 2015 nous force à sortir d'une théorie superficielle qui croyait pouvoir effacer les nations simplement en décrétant leur caractère périmé ou leur inutilité globale.
On dissertait depuis un bon moment sur le retour du tragique. Mais il faut probablement qu'une société fasse l'expérience brutale de l'agression et de la mort violente pour en prendre vraiment conscience. L'agression fait rejaillir le refoulé patriotique, et plus largement, tout ce qui, dans la communauté politique, l'enracinait dans des couches de réalité imperceptibles pour ceux qui ne veulent voir le monde qu'à travers une citoyenneté limitée au statut de simple artifice juridique. Même si les citoyens n'ont plus les mots pour traduire cette appartenance, ils ont un drapeau à brandir pour l'afficher. C'est ainsi qu'on comprendra l'augmentation massive de l'enrôlement sous les drapeaux de jeunes Français qui découvrent la part sacrée de l'identité collective, qui réhabilitent, par ce fait même, la possibilité du sacrifice patriotique.
Mais un patriotisme vivant doit être éduqué, transmis et entretenu, sans quoi le sursaut n'aura qu'un temps. Car si le patriotisme est une pulsion vitale, il doit, pour irriguer vraiment les institutions, être inscrit au cœur de la culture, et non plus refoulé dans les marges sociales et idéologiques. Comment la nation a-t-elle pu, pendant un quart de siècle, être concédée à des formations protestataires ? On aime rappeler la fonction civique de l'enseignement de l'histoire. Paradoxalement, l'enseignement de l'histoire a servi, depuis plusieurs années déjà, à déconstruire le sentiment national et à disqualifier le patriotisme. On favorisait une pédagogie de la pénitence et de la repentance. Apprendre l'histoire, c'était apprendre à désaimer son pays. La fidélité aux grands ancêtres était remplacée par ce que Michel de Jaeghere nomme justement la haine des pères. Comment faire en sorte qu'elle redevienne source de vitalité identitaire ?
Les grands ancêtres sont pourtant plus nécessaires que jamais pour comprendre le bon usage du patriotisme. De Gaulle comme Churchill, au moment de la deuxième guerre mondiale, se firent les défenseurs admirables des libertés civiles et de la démocratie. Mais ils le firent au nom de la grandeur de la France, dans le premier cas, et de la civilisation occidentale et chrétienne, dans le second. En un mot, la démocratie ne fonctionne pas en lévitation, elle ne survit pas de manière stratosphérique, et doit s'alimenter de sentiments humains fondamentaux sans lesquels elle est condamnée à l'assèchement. La démocratie, sans la nation, est impuissante. Le patriotisme ouvre à une forme de transcendance qu'il faut reconnaître comme telle et savoir réinvestir. •
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologue et chargé de cours aux HEC à Montréal. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (VLB éditeur, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille: mémoire, identité et multiculturalisme dans le Québec post-référendaire (Boréal, 2007). Mathieu Bock-Côté est aussi chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada.


 Ailleurs en Europe, de ce que je vois ou entends dire, la vie politique ne donne pas ce sentiment de vaudeville, d'impuissance et de prétention tournant au ridicule, qui se dégage de la situation en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, par exemple, la vie publique fonctionne, tourne plus ou moins bien mais avance, des décisions sont prises, des choix parfois douloureux accomplis, un gouvernement existe. Les citoyens n'éprouvent pas cette sensation d'une fuite des dirigeants dans l'imposture de la communication à outrance, les polémiques, les manipulations, postures, mises en scène dans la seule perspective de la préservation ou de la conquête des postes.
Ailleurs en Europe, de ce que je vois ou entends dire, la vie politique ne donne pas ce sentiment de vaudeville, d'impuissance et de prétention tournant au ridicule, qui se dégage de la situation en France. En Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, par exemple, la vie publique fonctionne, tourne plus ou moins bien mais avance, des décisions sont prises, des choix parfois douloureux accomplis, un gouvernement existe. Les citoyens n'éprouvent pas cette sensation d'une fuite des dirigeants dans l'imposture de la communication à outrance, les polémiques, les manipulations, postures, mises en scène dans la seule perspective de la préservation ou de la conquête des postes.





 Entretien par
Entretien par 
 Il faut défendre notre civilisation contre ses ennemis. Alain Finkielkraut le disait récemment dans Le Figaro Magazine. Mais la formule est bien plus ambiguë qu'on ne le croit.
Il faut défendre notre civilisation contre ses ennemis. Alain Finkielkraut le disait récemment dans Le Figaro Magazine. Mais la formule est bien plus ambiguë qu'on ne le croit.
 « L’agence de notation B.and B. décide de dégrader la France », « le Maroc recule d’un point en matière de développement humain », « les universités françaises perdent une place dans le classement de Pékin », « la Ligue des droits humains met en garde Amman », « Paris recule dans le classement Bertelsmann sur la gouvernance », « l’agence X de Londres pointe la hausse de la dette marocaine », « le palmarès de Philadelphie (ou de Toronto, ou de Seattle, au choix) déclasse l’Espagne et le Portugal » etc. etc. Sans parler de la Russie ou de la Turquie, ces « cancres » par nature …
« L’agence de notation B.and B. décide de dégrader la France », « le Maroc recule d’un point en matière de développement humain », « les universités françaises perdent une place dans le classement de Pékin », « la Ligue des droits humains met en garde Amman », « Paris recule dans le classement Bertelsmann sur la gouvernance », « l’agence X de Londres pointe la hausse de la dette marocaine », « le palmarès de Philadelphie (ou de Toronto, ou de Seattle, au choix) déclasse l’Espagne et le Portugal » etc. etc. Sans parler de la Russie ou de la Turquie, ces « cancres » par nature …

 Emmanuel Macron comme Donald Trump : le phénomène est plus intéressant que le personnage lui-même. Comment expliquer l’actuel phénomène Macron, qui se veut candidat hors système, alors qu’il est justement un pur produit du système ?
Emmanuel Macron comme Donald Trump : le phénomène est plus intéressant que le personnage lui-même. Comment expliquer l’actuel phénomène Macron, qui se veut candidat hors système, alors qu’il est justement un pur produit du système ?
 L'élection présidentielle a montré, une fois de plus, la grande division des Français :
L'élection présidentielle a montré, une fois de plus, la grande division des Français :  Je ne me satisferai pas du résultat du 7 mai, et je ne peux être satisfait de cette République qui, aujourd'hui comme depuis si longtemps, sacrifie les intérêts de notre pays et de ses citoyens pour des chimères et des causes qui ne sont pas nôtres ni, même, proprement européennes au sens politique du terme. L'alternance qui nous a été tant vantée ces dernières années n'aura pas lieu mais sans doute aussi n'était-elle pas l'alternative à cette politique qui ne fonctionne plus depuis des décennies...
Je ne me satisferai pas du résultat du 7 mai, et je ne peux être satisfait de cette République qui, aujourd'hui comme depuis si longtemps, sacrifie les intérêts de notre pays et de ses citoyens pour des chimères et des causes qui ne sont pas nôtres ni, même, proprement européennes au sens politique du terme. L'alternance qui nous a été tant vantée ces dernières années n'aura pas lieu mais sans doute aussi n'était-elle pas l'alternative à cette politique qui ne fonctionne plus depuis des décennies...
 Après sa fulgurante conquête du pouvoir, balayant les caciques et les candidats du Système, les vieilles structures partisanes, ce dont personne ne s'est plaint et que nul ne regrette, en tout cas pas nous, voici déjà pour Emmanuel Macron le temps de la défiance et du déclin.
Après sa fulgurante conquête du pouvoir, balayant les caciques et les candidats du Système, les vieilles structures partisanes, ce dont personne ne s'est plaint et que nul ne regrette, en tout cas pas nous, voici déjà pour Emmanuel Macron le temps de la défiance et du déclin. 

 A la fin des années 1980, lors d'une campagne cantonale à laquelle la Fédération Royaliste de Bretagne participait par la présentation de trois candidats (dont moi-même en Ille-et-Vilaine), nous placardions une affiche sur laquelle était dit, en lettres capitales : « Pourquoi élisez-vous toujours les mêmes ? ».
A la fin des années 1980, lors d'une campagne cantonale à laquelle la Fédération Royaliste de Bretagne participait par la présentation de trois candidats (dont moi-même en Ille-et-Vilaine), nous placardions une affiche sur laquelle était dit, en lettres capitales : « Pourquoi élisez-vous toujours les mêmes ? ». 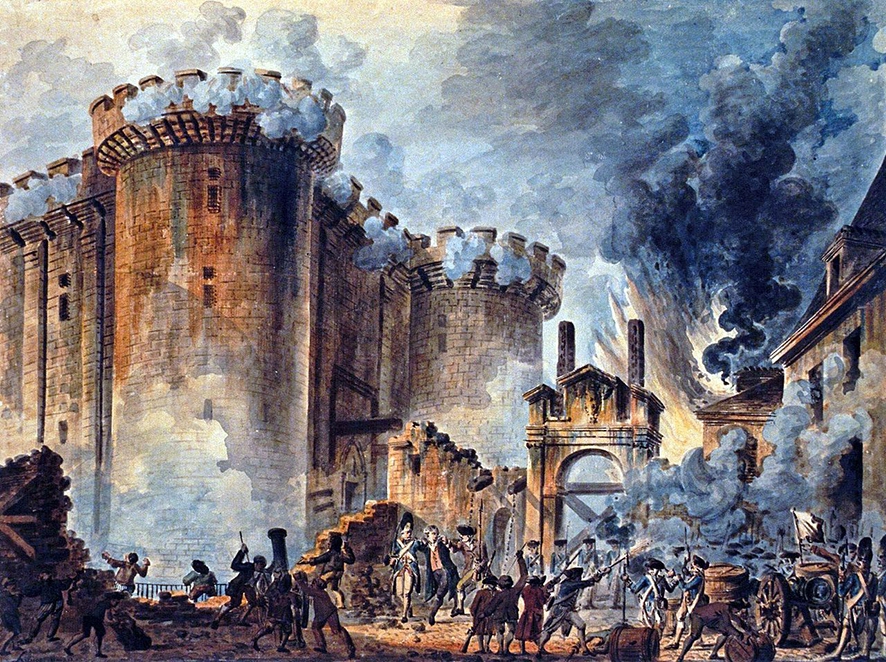
 Les penseurs libéraux ont souvent ce travers de postuler que les choix politiques sont motivés exclusivement par l’intérêt économique. Pourtant leur maître, Tocqueville, avait prédit qu’à l’ère de la démocratie de masse, l’envie serait un mobile déterminant. La fascination pour la gloire en est un autre. Elle permit à Napoléon de sacrifier impunément des Français par centaines de milliers et ceux qui en réchappaient, plus ou moins éclopés, s’enorgueillissaient d’avoir été de la chair à canon à Austerlitz, à Wagram, à Friedland, à Moscou.
Les penseurs libéraux ont souvent ce travers de postuler que les choix politiques sont motivés exclusivement par l’intérêt économique. Pourtant leur maître, Tocqueville, avait prédit qu’à l’ère de la démocratie de masse, l’envie serait un mobile déterminant. La fascination pour la gloire en est un autre. Elle permit à Napoléon de sacrifier impunément des Français par centaines de milliers et ceux qui en réchappaient, plus ou moins éclopés, s’enorgueillissaient d’avoir été de la chair à canon à Austerlitz, à Wagram, à Friedland, à Moscou.