Civilisation ou animal monstrueux ?
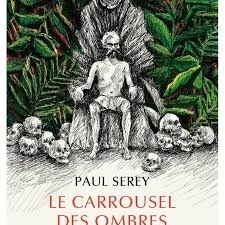 Entretien menée par la rédaction du magazine d’AF, « Le Bien Commun » avec Paul Serey.
Entretien menée par la rédaction du magazine d’AF, « Le Bien Commun » avec Paul Serey.
Ce texte d’entretien a été écrit durant le confinement et contrairement à ce qui a été indiqué dans LBC de juin, l’auteur est Paul Serey auteur du “Carrousel des ombres” aux éditions de l’équateur.
 La rédaction : Les modernes se croyaient maîtres et possesseurs de la nature. L’actuelle épidémie n’apporte-t-elle pas la preuve que notre civilisation technicienne n’est qu’un colosse aux pieds d’argile ?
La rédaction : Les modernes se croyaient maîtres et possesseurs de la nature. L’actuelle épidémie n’apporte-t-elle pas la preuve que notre civilisation technicienne n’est qu’un colosse aux pieds d’argile ?
Paul Serey : Depuis le XVIIème siècle – qu’il soit maudit ! –, à cause de Galilée qui avait pavé la voie, par la faute de Descartes, celui-là même que vous citez, l’homme s’est détaché d’une vision du monde comme Cosmos et a procédé, progressivement et peu à peu géométriquement, à la réification et la quantification de la nature. Maître et possesseur, quel rêve ! Rêve de possédés ! Quels maîtres sommes-nous devenus ! Qu’avons-nous fait de cette nature que nous avons si méticuleusement, scientifiquement, détachée de nous-même ? La nature n’est-elle pas devenue une simple banlieue, une « zone » vouée à la désertification ? Quelle possession que voilà !
Je crois qu’il est difficile de parler de civilisation aujourd’hui. En désensauvageant la nature, en la mettant en coupe réglée, nous l’avons simplement détruite. Nous sommes orphelins. Nous l’avons traitée en ennemie. Voilà la modernité. Et ce dont nous avons hérité, nous, postmodernes, cette nature plus ou moins maîtrisée, nous l’avons arasée. Car qu’est-ce que la postmodernité, si ce n’est l’abattage de toute verticalité ? Voilà où nous en sommes. Tout est atomisé, effondré ; tout est devenu poussière, cette poussière qui vole au-dessus d’un désert de sable. Nous ne sommes plus maîtres de rien que d’un terrain vague, immense et sans horizon, où nous errons comme les survivants d’une explosion atomique… Est-ce là une civilisation ?
C’est un oxymore de parler de civilisation technicienne. Comme nous l’a enseigné Ellul, la principale caractéristique de la technique (non pas seulement les machines mais tout ce qui régit le parc humain : technique de l’économie, technique de l’organisation, technique de l’homme) est qu’elle est autonome. Il fut un temps où l’homme maîtrisait son environnement, lorsqu’il considérait les techniques comme des prolongements de ses jambes, de ses bras, de sa langue. Jambes, bras, langue, voyez-vous ? Voyez-vous comme ces prolongements, presque naturels, sont devenus artificiels ? Démesurés et… autonomes ? Et cette autonomie, cette démesure, ne la voyez-vous pas grandir, comme un animal qui grossit et s’étend, un organisme à la fois agile et pesant qui s’étend et absorbe et englobe tout, la nature et l’homme lui-même ?
C’est un animal monstrueux, qui vit sa propre vie, et dont nous ne sommes que les cellules, emprisonnées dans des organes complexes et dépendants les uns des autres. Ce monstre est une chose vivante. Et comme tout animal complexe, aux organes dépendants, il est extrêmement fragile. C’est ce que nous révèle cette épidémie. Les organes sont atteints, d’un coup, de façon fulgurante. C’est une grippe, et les organes sont grippés. Et c’est tout l’animal qui se retrouve malade soudainement.
Un colosse aux pieds d’argile, oui ! Et c’est notre plus grand espoir. Qu’il s’effondre ! Qu’il se gangrène ! Qu’il pourrisse et disparaisse !
Beaucoup de cellules mourront. D’autres seront absorbées par d’autres petits organismes. Elles se réorganiseront, sous une forme plus simple, où elles trouveront plus d’autonomie, ne dépendant plus de ce gros animal pesant et compliqué que nous avons nommé civilisation et qui est notre perte. Encore faut-il que la Bête ne se régénère pas…
LR : Ce qui n’est pas gagné ! Car on continue à nous parler de progrès technique davantage que de décroissance. La Mégamachine ne risque-t-elle pas d’être paradoxalement renforcée par ses faiblesses ?
PS : J’ai utilisé l’image d’un organisme vivant. Mais, en réalité, ce n’est qu’un simulacre. C’est un animal mécanique qui a les caractéristiques du vivant. Mais comme je l’ai dit, il est complexe, et sa complexité augmente de jour en jour. Voudrait-on le simplifier qu’on ne le pourrait pas. Il grossit et se complexifie. Et je l’ai dit : de manière autonome. Décroître ? Cela supposerait qu’on puisse maîtriser cet animal. Cela supposerait qu’on en soit maître. Et qui en est maître ? Les Etats ? Les gouvernements ? Les organisations ? Les institutions ? Eh bien, non ! Le système technicien, ou plutôt technologique est son propre maître ! Ceux-là que j’ai cités ne sont que des organes. Ils obéissent. Ils servent la Bête, la Mégamachine. La décroissance est selon moi un doux rêve. C’est être bien naïf que de penser que cela se fera sans conséquences perverses.
Bien sûr, l’animal pourrait maigrir un peu. On pourrait lui faire perdre, par-ci par-là un peu de graisse, de toxines, ou que sais-je. Mais son fonctionnement, sa logique propre, n’en sera pas entravé. Voudrait-on lui faire perdre du muscle, il se renforcerait par ailleurs. Lui faire perdre une main, l’autre grandira, d’autres doigts lui pousseront. La Mégamachine est bien plus complexe que n’importe quel organisme terrestre. C’est sa fragilité, je l’ai dit. Mais c’est aussi sa force.
On le voit bien avec la crise actuelle. Un grain de sable – car c’est, me semble-t-il, un grain de sable (d’autres virus, d’autres catastrophes bien pires ont eu lieu par le passé sans engendrer de réactions si terribles) – a grippé la machine. Mais à cet incident la Mégamachine réagit en grossissant. Oui, voyant qu’elle perd le contrôle, il lui faut reprendre ce contrôle sur ses organes, et sur les cellules de son corps attaqué. Les Etats, les gouvernements, les institutions, les administrations, ne font que répondre à cette demande du système. La démocratie est l’organisation qui lui sied le mieux, car elle exige la docilité des cellules. La démocratie exige l’obéissance des citoyens. Et pour s’assurer de cette obéissance, le système a besoin de moyens de contrôle et de coercition.
On remarquera que la population obéit aux injonctions de l’Etat, sans moufeter. Le système n’est pas mis en danger. Grippé oui, mais sans dommages irrémédiables. Le système craint l’anarchie plus que tout. La démocratie est cette organisation qui contrôle le mieux le risque d’anarchie parce qu’elle organise la soumission volontaire. La dictature peut provoquer des révoltes violentes qui peuvent aller jusqu’à la mise à mort du dictateur. C’est le cas de toutes les monarchies absolues. La démocratie, quant à elle, fait accroire à la population qu’elle est maîtresse de son destin. Tout au plus observons-nous quelques manifestations de rue, quelques heurts, mais jamais rien qui soit vraiment dangereux pour le pouvoir. Néanmoins le pouvoir craint la rébellion. Tout mais pas l’anarchie ! Il faut que tout soit sous contrôle.
Or la population est en état de choc. Quelques manifestations de colères éclosent ici ou là, mais c’est le choc qui prédomine. Le choc et la peur. Voyant cela, le pouvoir, comme toujours, en profite. C’est le moment où la Mégamachine peut grossir et s’étendre. La population, abrutie par le choc et tremblante de peur est prête, prête à abdiquer un peu de liberté pour sa sécurité, prête à abdiquer le peu d’autonomie qui lui reste pour un peu de réconfort. Elle a besoin d’être rassurée et, pour cela, se laissera contrôler, traquer, pucer ; elle acceptera n’importe quelle intrusion dans sa vie privée si on lui promet que c’est pour son bien. La Mégamachine vit de ses crises. La crise, n’importe quelle catastrophe, est pour elle le moyen d’assurer son emprise, d’asservir un peu plus. La propagande fait déjà rage, et les mesures passent en loucedé.
LR : Aux critiques de la technique, on objecte systématiquement l’argument-massue des progrès de la médecine. Faut-il se libérer de la médecine pour se libérer de la Machine ?
PS : La médecine a elle aussi « progressé », c’est un fait. Elle est plus efficace, plus performante. Et tout le monde s’extasie. On en demande encore ! Toujours plus ! Il faudrait éradiquer toutes les maladies, chaque douleur. Du berceau à la tombe, aucune anicroche. Et une vie longue, sans fin. Pourquoi pas l’éternité ! On en rêve. On serait même prêt à se faire greffer toutes sortes de composants électroniques, se faire modifier les gênes, sélectionner ceux de nos enfants à naître, à naître dans un ventre étranger, pourquoi pas. Il me semble néanmoins que la machine a créé beaucoup de ces maladies (cancers, maladies infectieuses – dont le Covid19, pathologies psychiatriques, etc.) contre lesquelles elle lutte si joyeusement, mais passons…
Bien sûr, il est bon d’être soigné. Le docteur est le mage moderne. C’est l’incarnation du Bien. Le nouveau héros. N’y voyez pas que de l’ironie. Cette façon de voir est ancrée en chacun de nous. Et j’hésite à pousser mon raisonnement jusqu’à son terme.
Quand je dis qu’il faut détruire la Mégamachine, l’argument médical se met en travers de mon chemin. Qui ne tient pas à sa vie, à la vie de ses proches ? Pourtant, si l’on devait préserver la médecine telle qu’elle se pratique aujourd’hui, alors nous ne pourrions pas nous passer du reste du système technicien. Tout, dans ce système, est interdépendant ! Impossible de conserver ce confort ultime sans conserver, par là même et par exemple, les grands laboratoires pharmaceutiques, l’industrie chimique, l’industrie mécanique qui produit les robots et les ordinateurs, et par conséquent la pétrochimie et la production massive d’électricité et, évidemment, beaucoup d’autres choses !
Si la Mégamachine devait s’effondrer, il y aurait beaucoup de morts, des millions. Il faudrait à l’homme de nouvelles stratégies pour survivre, s’assurer un minimum de confort, préserver les siens. Fabriquer localement des outils ? Préparer des médicaments en pharmacie, comme cela se faisait autrefois ? Si l’on veut se débarrasser de l’oppresseur, il faudra être prêt à mille sacrifices tout en limitant la casse et en trouvant des solutions alternatives. Voulons-nous cette guerre ? Nous en avons fait, des guerres, contre de terribles oppresseurs, et ceci nous a coûté des millions de vies par le passé. Or ce système qui nous oppresse est-il moins terrible ? Je ne le crois pas. Mais suis-je moi-même prêt à cette guerre ? Je me pose la question.
LR : Et on craint de connaître la réponse concernant la masse des gens passant leur confinement sur un écran et ne rêvant que d’un « retour à la normale »… Peut-on espérer qu’advienne un jour une (Contre-)Révolution ou est-on condamné à attendre une plus redoutable épidémie, ou autres cataclysmes, pour que le système s’effondre de lui-même ?
PS : Je ne suis pas très optimiste. Je crois que le système est bien verrouillé. On a habitué les gens à un certain confort et, le voyant si fragile, ils n’auront en tête que de le retrouver. Ce temps de crise est profitable à certains, ceux qui recherchent une solitude qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de connaître vraiment, cette solitude qui enrichit, qui est intériorité et contemplation ! Mais la grande masse n’y aura trouvé qu’une occasion supplémentaire de se vautrer dans le divertissement netflixien et pornhubien, dans des jouissances médiocres et un laisser-aller à vomir.
Je ne parlerais pas de Contre-Révolution, si un bouleversement était possible, mais bien de Révolution. On ne peut se contenter de réaction. Il faut inventer de nouvelles filiations, faire de notre héritage quelque chose de nouveau. Je ne parle évidemment pas d’utopie. On ne fera pas un monde nouveau, en ce sens. Je parle d’avenir, de l’avenir de ce monde que nous connaissons. On n’efface pas le passé d’un coup de manche. Détruire le système technicien, la Mégamachine, oui. Après, il faudra reconstruire à partir de ce qu’il restera, si cela est possible. Ce qui restera, c’est notre héritage spirituel, nos racines, l’amour de notre famille, de nos enfants, de nos parents, de notre patrie, de nos patries, la petite et la grande. La France bien-sûr.
Quant à moi, je vois un roi, un roi bienveillant et paternel. Et je vois un peuple, un peuple enraciné, conscient, autonome. Je vois un peuple en armes, prêt à se libérer de toute servitude si nécessaire. Je vois des hommes et des femmes libres, avec un travail enrichissant et utile à tous, ancrés sur leur fiefs. Transhumants, pourquoi pas. Je vois des fêtes. Je vois des communautés. Je vois l’Anarchie. L’Anarchie plus un. Le peuple et son roi, sans rien entre les deux.
Si rien n’advenait cette fois-ci, d’autres catastrophes viendront. Mais il n’est pas dit que la machine ne se renforcera pas. Le seul espoir réside dans les hommes, pris individuellement, dans les communautés, les tribus, les familles. Organisons-nous, et saisissons les occasions que le système ne manquera pas de nous offrir.
LR : Ce souci (maladif) de la santé est-il lié au refus du Mal, et donc du Bien, dont vous parlez dans votre roman Le carrousel des ombres ?
PS : Dans Le Carrousel, j’expliquai de façon très littéraire qu’on ne peut concevoir le bien sans le mal. Et que pour avoir un grand bien qu’il faut avoir l’exemple d’un grand mal. Qu’on ne peut concevoir Dieu sans Satan. Que sans Gilles de Rais, Jeanne d’Arc ne serait pas la Sainte qu’on connaît. Qu’à ne plus distinguer le Mal du Bien, on n’avait certes plus de Mal, mais plus de Bien non plus. En gros, on a signé un chèque en blanc à Satan, qui se retrouve maître de nos principautés. Il est visible pourtant, contrairement à Dieu. Le Mal fait du bruit, le bien est silencieux. Nous avons détruit le monde du silence. Et nous ne percevons plus le bruit, tant nous y sommes immergés.
Nous ne reconnaissons plus le mal parce que nous l’avons nié pour nous débarrasser de Dieu. Nous vivons dans cet Empire du bien, génialement décrit par Muray. Et la maladie fait partie de ces choses que nous ne voulons pas voir, pour les raisons que je viens d’évoquer. Nous ne voulons pas la voir, nous refusons de voir la mort. Il faut à tout prix éradiquer la mort de nos vies et de l’espace public, à tour prix évincer la maladie et la souffrance de nos vies qui sans elles, pourtant, n’ont plus de relief et dont le sens métaphysique se perd dans un vide sidéral. La maladie, la mort, sont des thèmes éternels… ils ressurgiront, ils ressurgissent sous nos yeux.