Un chef d’État, un vrai !

C’est ce qu’attend la France. Pas un candidat qui réussit, mais un chef. Et qui sera en mesure de prendre toutes les décisions qui s‘imposent pour le salut de la France.
 Serait-il possible que la France ait un jour un chef de l’État ? D’une légitimité telle qu’elle soit incontestable ? Qu’il puisse être cette personne dont la constitution de la Ve République définit la fonction en son titre II, de l’article 5 à l’article 19 ? Mais voilà : son mode de désignation est aujourd’hui tel qu’il empêche l’exercice correct de cette magistrature parce qu’il porte atteinte à l’esprit même de l’institution.
Serait-il possible que la France ait un jour un chef de l’État ? D’une légitimité telle qu’elle soit incontestable ? Qu’il puisse être cette personne dont la constitution de la Ve République définit la fonction en son titre II, de l’article 5 à l’article 19 ? Mais voilà : son mode de désignation est aujourd’hui tel qu’il empêche l’exercice correct de cette magistrature parce qu’il porte atteinte à l’esprit même de l’institution.
La France sans chef
De l’effroyable chaos partisan que crée, maintenant de manière durable, l’élection présidentielle, avant, pendant et après, peut-il émerger une personnalité capable « d’assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État », « d’être le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités », « de nommer » souverainement « le Premier ministre », « de soumettre au référendum » un projet de loi, « de signer les ordonnances et les décrets » délibérés en Conseil des ministres, sans provoquer immédiatement l’effervescence des factions opposées ; et que dire s’il s’avisait de prendre des mesures extraordinaires qui seraient exigées par des circonstances exceptionnelles ?
À trois mois de la prochaine élection présidentielle qui mettra fin au calamiteux quinquennat de François Hollande et qui est censée ouvrir une ère nouvelle, n’y a-t-il donc personne pour énoncer avec simplicité cette évidente contradiction qui est au coeur de notre système politique et qui en altère profondément le fonctionnement ? Chacun des candidats, actuels ou futurs – et ils sont déjà nombreux ! – est trop persuadé que son tour viendra une prochaine fois pour vouloir mettre en cause des procédés institutionnellement aussi nocifs.
Et les partis qui vivent politiquement et financièrement de ce désordre permanent ne se risqueront pas à en interrompre le cours, la France dût-elle en périr. En France – et parce qu’elle est la France et que son histoire est une leçon en elle-même –, cette situation est plus grave qu’elle ne le serait en aucun autre pays civilisé. Cette chienlit perpétuelle lui est funeste. Pas un Français qui ait le cœur un peu haut placé, pour ne pas le ressentir !
L’avilissement de la fonction
Les primaires de la gauche comme celles de la droite ont illustré la vanité et la vacuité de la politique politicienne en France. Quel avilissement ! Ravaler la dignité du chef de l’État à cette comparution devant des jurys de journalistes ! Quel misérable spectacle que celui d’une nation réduite dans son expression à une salle de classe ! Des petits « profs » qui font les savants et qui harcèlent de questions péremptoires de minables élèves qui doivent répliquer à la moindre injonction. Mais la direction de la France ne relève pas d’un concours !
D’où l’absurdité de tant de paroles et d’engagements : à droite, des palanquées de chiffres soupesées aux balances d’improbables budgets ; à gauche, des palanquées de promesses, de droits à « qui qu’en veut », selon la chanson, de faire naître des enfants ou de les tuer à volonté et gratuitement, de mourir, de jouir, de ne plus travailler, jusqu’au revenu universel financé sur le miracle de recettes introuvables.
Voilà un futur chef de l’État qui doit dire ce qu’est l’école « républicaine », comment il faut y enseigner, à quel âge l’enfant doit être orienté, mais tout aussi bien comment l’hôpital devrait fonctionner, quel est le périmètre de la Sécurité sociale, ou encore combien de gendarmes, de policiers, de juges, de médecins il convient de déployer sur le territoire. Et chacun de rajouter des précisions, des projets dans son programme, sans jamais s’arrêter sur les vraies causes de tant de gabegies, de pagailles, d’incuries, de désorganisation généralisée.
Où est le chef de l’État ?
Qui aura le courage de dire : « Et la France ? » Le vrai chef de l’État s’occupe de la France et de la France seule, ce qui ne veut pas dire isolée. C’est sa mission essentielle. Il assure la politique générale du pays ; il lui donne sa place dans le monde ; il garantit l’ordre intérieur qui permet la prospérité et conforte les libertés réelles.
Si le chef de l’État remplit bien sa fonction, les affaires de la France se porteront d’autant mieux ; tout le monde en tirera profit. Comment ces vérités élémentaires ne sont-elle jamais rappelées ?
Le chef de l’État n’a pas à répondre à toutes les envies du moindre hurluberlu qui se prend pour un citoyen supérieur, aux réclamations des éternels agités, aux hurlements des groupuscules qui s’imaginent être la conscience avancée du monde et qui ne sont généralement que des instruments de puissances obscures et financièrement vicieuses.
Et il n’est pas chargé de répartir les richesses, de juger des bons et des mauvais élèves, de promouvoir l’égalité partout, de changer les mœurs, d’endoctriner le peuple, d’accueillir l’étranger au mépris des intérêts les plus certains du Français, de légaliser à tour de bras les dispositifs qui aboutissent à la destruction des familles, des traditions, des patrimoines, des consciences, de la vie. L’État a usurpé toutes ces fonctions qui justifient le politicien dans ses prétentions ; il se comporte exactement comme une contre-Église, mais totalitaire, ce qu’il est devenu de fait et de droit et ce qui est voulu. Les dernières lois en sont l’illustration.
Aucun homme politique n’est vraiment libre par rapport à cette sourde et continuelle pression qui est une oppression. Il ne peut pas parler de la France et à la France ; il est contraint à un langage convenu, ce qu’on appelle des éléments de langage. Pour plaire à qui ?
C’est une fin de régime
L’élu de la primaire de la gauche sera confronté, d’une part, à Jean-Luc Mélenchon et, d’autre part, à Emmanuel Macron. Il n’a évidemment aucune chance et il devra se désister, ce qui sera une fin ridicule. Cela a déjà été prévu dans ces colonnes. Aujourd’hui Macron rallie les suffrages ; il se montre plus candidat que tous les autres candidats. Est-ce la marque d’un futur chef de l’État ? Il dit tout et le contraire de tout, autrement dit rien. Ça plaît ! Sauf qu’il se croit et ce n’est jamais bon de trop se croire.
Fillon, lui, sera attaqué de toutes parts – et ça ne fait que commencer ! – de l’extérieur et de l’intérieur de son parti et, à chaque fois qu’il cédera à quelque chantage, il fragilisera sa position. Il oscillera, au milieu de factions et d’ambitions qui se déchirent, entre la crainte d’être soupçonné de quelques velléités réactionnaires à cause de son électorat premier et la peur de perdre le soutien des puissants à qui il sera forcément redevable.
Marine Le Pen joue sa partie. Elle a l’avantage d’une position patriotique nette qui plaira de plus en plus à des Français dépouillés de leur nationalité, de leur civilisation, de leur travail, de leur milieu de vie. Mais, à force de réduire son programme, sous l’influence de son entourage, à la seule économie dirigée et assistée, sans tenir compte des aspirations d’une France qui veut revivre spirituellement, elle risque de perdre son souffle dans une guerre impitoyable où, malgré toutes ses protestations, elle sera considérée comme l’Ennemi du genre humain.
Le plus probable et même le certain, c’est que l’élu de la présidentielle – quel qu’il soit – se trouvera dans une situation de déliquescence politique telle que, même avec une majorité à la chambre, il sera bien en peine de gouverner malgré les rodomontades des campagnes électorales et qu’il suffira de quelques difficultés majeures, dès aujourd’hui prévisibles, sécuritaires, économiques, sociales et surtout financières pour que la question du pouvoir se repose dans toute son acuité.
À quand la recherche d’une vraie légitimité ? •

 Un nouveau concept politico-linguistique fait actuellement beaucoup parler de lui : la « post-vérité ». Il y aurait donc une « anté-vérité » ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ?
Un nouveau concept politico-linguistique fait actuellement beaucoup parler de lui : la « post-vérité ». Il y aurait donc une « anté-vérité » ? Qu’est-ce que tout cela veut dire ?
 Le 28 mars dernier, lundi de Pâques, le prince Jean s’est envolé pour la Syrie en compagnie d’un groupe conduit par Mgr Dominique Rey, l’évêque de Fréjus-Toulon, qui avait d’ailleurs célébré son mariage en 2009. Ce court voyage, auquel Jean-Baptiste d’Albaret, rédacteur en chef de Politique Magazine, a également participé, et que j’ai eu le privilège d’accompagner, s’est achevé dans la nuit du 2 au 3 avril. L’organisation logistique avait été confiée à la jeune association SOS Chrétiens d’Orient, fondée en 2013 et très active sur le terrain. Grâce à elle, nous avons obtenu des autorités toutes les facilités pour circuler sans problèmes, étant entendu que nous sommes restés dans des régions dont l’armée a repris le contrôle, ce qui n’est pas le cas, par exemple, de certaines banlieues de Damas.
Le 28 mars dernier, lundi de Pâques, le prince Jean s’est envolé pour la Syrie en compagnie d’un groupe conduit par Mgr Dominique Rey, l’évêque de Fréjus-Toulon, qui avait d’ailleurs célébré son mariage en 2009. Ce court voyage, auquel Jean-Baptiste d’Albaret, rédacteur en chef de Politique Magazine, a également participé, et que j’ai eu le privilège d’accompagner, s’est achevé dans la nuit du 2 au 3 avril. L’organisation logistique avait été confiée à la jeune association SOS Chrétiens d’Orient, fondée en 2013 et très active sur le terrain. Grâce à elle, nous avons obtenu des autorités toutes les facilités pour circuler sans problèmes, étant entendu que nous sommes restés dans des régions dont l’armée a repris le contrôle, ce qui n’est pas le cas, par exemple, de certaines banlieues de Damas.  La deuxième partie du séjour s’est déroulée à Homs, ville terriblement sinistrée, où nous avons pu déambuler à pieds sur plusieurs centaines de mètres, sous la protection bienveillante des soldats syriens, très souriants comme tous ceux que nous rencontrions. Les deux cathédrales que nous avons visitées, la grecque-catholique et la syriaque-catholique, sont dans un état pitoyable : coupoles et toitures perforés par les obus, iconostase et autels brûlés, icônes aux yeux perforés par les balles des djihadistes. SOS Chrétiens d’Orient participe à la reconstruction de la première. Partout alentour, ce n’est qu’amoncellement d’immeubles détruits. Nous avons aussi prié sur la tombe du Père Frans van der Lugt, jésuite hollandais, qui avait tenu à demeurer sur place malgré les dangers, pour secourir les chrétiens qui n’avaient pas pu quitter la ville. Assassiné le 7 avril 2014, il est enterré dans le jardin de son couvent. Comme Homs, les deux autres villes de la région que nous avons visitées, Qussaïr et Yabroud, ont été pendant des mois le théâtre d’affrontements entre les djihadistes de diverses obédiences, y compris Daech, et l’armée nationale qui a finalement pu reprendre possession des lieux (en mai 2014 pour Homs), avec parfois l’appui du Hezbollah libanais. De notre autocar, nous pouvions alors contempler les sommets enneigés du pays du Cèdre.
La deuxième partie du séjour s’est déroulée à Homs, ville terriblement sinistrée, où nous avons pu déambuler à pieds sur plusieurs centaines de mètres, sous la protection bienveillante des soldats syriens, très souriants comme tous ceux que nous rencontrions. Les deux cathédrales que nous avons visitées, la grecque-catholique et la syriaque-catholique, sont dans un état pitoyable : coupoles et toitures perforés par les obus, iconostase et autels brûlés, icônes aux yeux perforés par les balles des djihadistes. SOS Chrétiens d’Orient participe à la reconstruction de la première. Partout alentour, ce n’est qu’amoncellement d’immeubles détruits. Nous avons aussi prié sur la tombe du Père Frans van der Lugt, jésuite hollandais, qui avait tenu à demeurer sur place malgré les dangers, pour secourir les chrétiens qui n’avaient pas pu quitter la ville. Assassiné le 7 avril 2014, il est enterré dans le jardin de son couvent. Comme Homs, les deux autres villes de la région que nous avons visitées, Qussaïr et Yabroud, ont été pendant des mois le théâtre d’affrontements entre les djihadistes de diverses obédiences, y compris Daech, et l’armée nationale qui a finalement pu reprendre possession des lieux (en mai 2014 pour Homs), avec parfois l’appui du Hezbollah libanais. De notre autocar, nous pouvions alors contempler les sommets enneigés du pays du Cèdre. 
 Sept fantômes du PS se sont disputés, jeudi soir à la télévision, la place de candidat à la présidentielle. Les Français les verront apparaître deux fois encore avant le premier tour de leur primaire, le 22 janvier: ce court délai devrait suffire pour faire le tour des programmes. Le manichéisme de Vincent Peillon, la démagogie de Benoît Hamon, la suffisance d'Arnaud Montebourg sont les vieux restes qui rappellent ce que fut le progressisme du temps de sa splendeur. Manuel Valls, qui avait ouvert le procès de ce socialisme infatué, ne cesse depuis de se renier pour tenter de rassembler une armée des ombres. L'entendre rejeter le libéralisme après avoir déclaré son « amour» de l'entreprise est une incongruité parmi d'autres. Lundi, un sondage du Figaro donnait l'ancien premier ministre perdant au second tour face à Montebourg, soutenu par les « socialos » morts-vivants. Valls se perd à vouloir séduire des zombies.
Sept fantômes du PS se sont disputés, jeudi soir à la télévision, la place de candidat à la présidentielle. Les Français les verront apparaître deux fois encore avant le premier tour de leur primaire, le 22 janvier: ce court délai devrait suffire pour faire le tour des programmes. Le manichéisme de Vincent Peillon, la démagogie de Benoît Hamon, la suffisance d'Arnaud Montebourg sont les vieux restes qui rappellent ce que fut le progressisme du temps de sa splendeur. Manuel Valls, qui avait ouvert le procès de ce socialisme infatué, ne cesse depuis de se renier pour tenter de rassembler une armée des ombres. L'entendre rejeter le libéralisme après avoir déclaré son « amour» de l'entreprise est une incongruité parmi d'autres. Lundi, un sondage du Figaro donnait l'ancien premier ministre perdant au second tour face à Montebourg, soutenu par les « socialos » morts-vivants. Valls se perd à vouloir séduire des zombies.
 La droite catholique a voté. Tout le monde en convient. C’est le signe le plus clair des primaires de la droite. Suivant la rumeur qui s’amplifia soudain dans le corps électoral, selon aussi les consignes données sur les réseaux sociaux et sous des instigations qui se devinent, elle s’est portée sur François Fillon.
La droite catholique a voté. Tout le monde en convient. C’est le signe le plus clair des primaires de la droite. Suivant la rumeur qui s’amplifia soudain dans le corps électoral, selon aussi les consignes données sur les réseaux sociaux et sous des instigations qui se devinent, elle s’est portée sur François Fillon.
 Ils battent leur coulpe. Ils reconnaissent leurs torts. Ils promettent de s'amender. Ils sont journalistes, patrons de journaux, universitaires, intellectuels, économistes, ou patrons du numérique dans la Silicon Valley. Ils vivent dans les grandes métropoles de l'est ou de l'ouest de l'Amérique ; et ont fait campagne jusqu'au bout en faveur d'Hillary Clinton. Une campagne violente, sans mesures ni limites, sans aucun respect pour la déontologie journalistique ou la rigueur scientifique, à la hauteur de l'aversion qu'ils éprouvaient pour leur adversaire Donald Trump.
Ils battent leur coulpe. Ils reconnaissent leurs torts. Ils promettent de s'amender. Ils sont journalistes, patrons de journaux, universitaires, intellectuels, économistes, ou patrons du numérique dans la Silicon Valley. Ils vivent dans les grandes métropoles de l'est ou de l'ouest de l'Amérique ; et ont fait campagne jusqu'au bout en faveur d'Hillary Clinton. Une campagne violente, sans mesures ni limites, sans aucun respect pour la déontologie journalistique ou la rigueur scientifique, à la hauteur de l'aversion qu'ils éprouvaient pour leur adversaire Donald Trump.



 Nous ne nous lasserons jamais de le répéter : le désespoir en politique est une sottise absolue. Une nouvelle preuve nous en a été fournie ce samedi 13 mai 2017. Alors que, hélas, le dimanche précédent, le pire n’avait pu être évité pour la France avec l’élection de Macron, c’est rue Cléry, dans le deuxième arrondissement de Paris, qu’un signe fort d’espérance est apparu dans le ciel assombri du pays, avec la participation du dauphin de France à notre colloque sur le Bien commun, participation qui en a fait tout le succès. Je reprendrai les mots de François Bel-Ker, secrétaire général de l’Action française : «
Nous ne nous lasserons jamais de le répéter : le désespoir en politique est une sottise absolue. Une nouvelle preuve nous en a été fournie ce samedi 13 mai 2017. Alors que, hélas, le dimanche précédent, le pire n’avait pu être évité pour la France avec l’élection de Macron, c’est rue Cléry, dans le deuxième arrondissement de Paris, qu’un signe fort d’espérance est apparu dans le ciel assombri du pays, avec la participation du dauphin de France à notre colloque sur le Bien commun, participation qui en a fait tout le succès. Je reprendrai les mots de François Bel-Ker, secrétaire général de l’Action française : « 


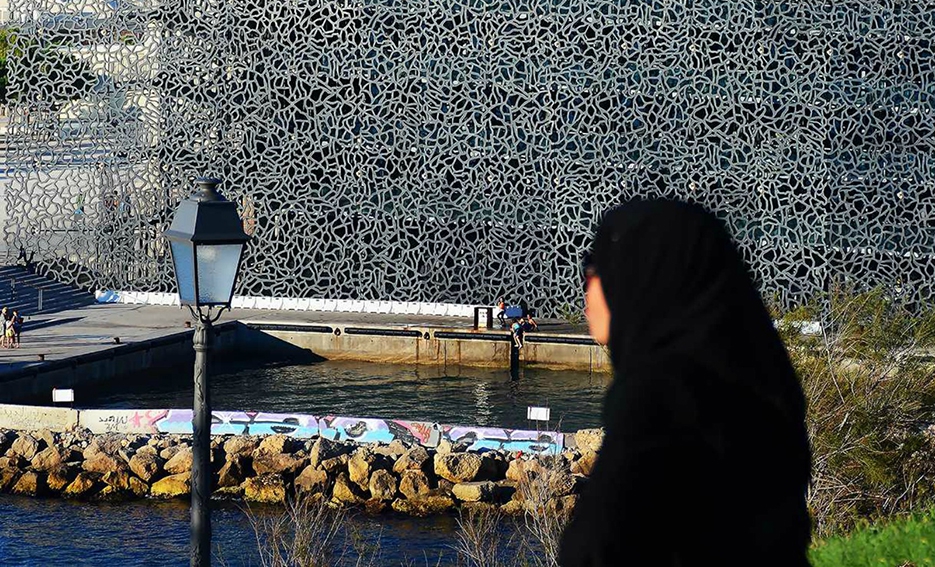
 Je venais de traverser le Panier, qui comme son nom l’indique est une colline au-dessus du port de Marseille, et en redescendant, je suis tombé sur l’immense esplanade désespérée qui mène au MUCEM. « Aventuriers des mers » : un programme d’autant plus alléchant que l’Inspection générale a eu la bonne idée de décréter que le thème des prépas scientifiques, cette année, serait justement l’Aventure (Homère, Conrad, Jankelevitch).
Je venais de traverser le Panier, qui comme son nom l’indique est une colline au-dessus du port de Marseille, et en redescendant, je suis tombé sur l’immense esplanade désespérée qui mène au MUCEM. « Aventuriers des mers » : un programme d’autant plus alléchant que l’Inspection générale a eu la bonne idée de décréter que le thème des prépas scientifiques, cette année, serait justement l’Aventure (Homère, Conrad, Jankelevitch). Ainsi parlait le prospectus de présentation, en toute logique . Explorateurs et aventuriers ont peut-être des pensées de commerce et de lucre, mais l’inspiration initiale leur vient des mythes littéraires. L’Occident s’est enté sur Ulysse et Enée, l’Odyssée et l’Enéide, l’Orient sur Sindbad et les 1001 nuits. On « fait comme » — puis on dépasse la légende pour construire la sienne. Les navigateurs arabes sont partis eux aussi à la poursuite d’un rêve, des démons et merveilles comme cet oiseau Rukhkh (ou Roc, dans les traductions françaises) qui s’en prend justement au navire de Sindbad.
Ainsi parlait le prospectus de présentation, en toute logique . Explorateurs et aventuriers ont peut-être des pensées de commerce et de lucre, mais l’inspiration initiale leur vient des mythes littéraires. L’Occident s’est enté sur Ulysse et Enée, l’Odyssée et l’Enéide, l’Orient sur Sindbad et les 1001 nuits. On « fait comme » — puis on dépasse la légende pour construire la sienne. Les navigateurs arabes sont partis eux aussi à la poursuite d’un rêve, des démons et merveilles comme cet oiseau Rukhkh (ou Roc, dans les traductions françaises) qui s’en prend justement au navire de Sindbad. Birmanie, la Malaisie — et retour, un homme que les gentils Musulmans de l’époque obligèrent, lui et sa famille, à se convertir à l’islam sous peine de mort. C’est même à cette apostasie pas du tout imposée que l’on doit le récit de son voyage, car le pape auquel il était allé demander pardon du sacrilège consentit à le ramener dans le sein de la chrétienté pourvu qu’il raconte son périple à son secrétaire, Poggio Bracciolini. D’où la mine d’informations dont a bénéficié Fra Mauro pour établir sa carte.
Birmanie, la Malaisie — et retour, un homme que les gentils Musulmans de l’époque obligèrent, lui et sa famille, à se convertir à l’islam sous peine de mort. C’est même à cette apostasie pas du tout imposée que l’on doit le récit de son voyage, car le pape auquel il était allé demander pardon du sacrilège consentit à le ramener dans le sein de la chrétienté pourvu qu’il raconte son périple à son secrétaire, Poggio Bracciolini. D’où la mine d’informations dont a bénéficié Fra Mauro pour établir sa carte. Je ne veux pas avoir l’air de dénigrer. L’exposition du MUCEM est encore riche d’objets précieux, comme ce bézoard (la panacée, l’anti-poison miracle, le remède des remèdes, comme la corne de rhinocéros pilée ou les poils de tigre) ramené des Indes [ci-contre].
Je ne veux pas avoir l’air de dénigrer. L’exposition du MUCEM est encore riche d’objets précieux, comme ce bézoard (la panacée, l’anti-poison miracle, le remède des remèdes, comme la corne de rhinocéros pilée ou les poils de tigre) ramené des Indes [ci-contre].



 L’élection d’Emmanuel Macron devait ouvrir une ère nouvelle : elle se contente d’aggraver les défauts de l’ancienne sans qu’il faille attendre du nouveau pouvoir la volonté de répondre aux défis qui se posent à notre pays. Entre enfumage et brutalité, le but désormais avoué est au contraire d’achever la société française dans son équilibre traditionnel, de plus en plus précaire.
L’élection d’Emmanuel Macron devait ouvrir une ère nouvelle : elle se contente d’aggraver les défauts de l’ancienne sans qu’il faille attendre du nouveau pouvoir la volonté de répondre aux défis qui se posent à notre pays. Entre enfumage et brutalité, le but désormais avoué est au contraire d’achever la société française dans son équilibre traditionnel, de plus en plus précaire.




