 Emmanuel Macron l'a montré lors des premiers mois de sa présidence : il aime les symboles. Il sait qu'ils n'ont rien d'anecdotique.
Emmanuel Macron l'a montré lors des premiers mois de sa présidence : il aime les symboles. Il sait qu'ils n'ont rien d'anecdotique.
Le débat récent sur le drapeau européen, qu'Emmanuel Macron a reconnu officiellement lors du Conseil européen des 19 et 20 octobre, est donc tout sauf un sujet marginal.
L'introuvable Etat européen
Le drapeau fait partie des cinq symboles de l'Union européenne, avec l'hymne, également officiellement reconnu, l'euro, la devise « unis dans la diversité » et la journée de l'Europe le 9 mai.
Ces symboles sont dits « étatiques » alors que l'UE n'a ni Etat ni nation. Elle n'est pas une Europe des nations mais elle n'est pas non plus une nation européenne. Il existe bien une monnaie européenne, mais tous les pays ne l'ont pas adoptée et, privé du fédéralisme lui permettant de combler par la solidarité les divergences qu'une monnaie unique génère, elle est incomplète.
Surtout, il n'y a pas de « souveraineté européenne » de laquelle un Etat européen puisse émaner. Depuis la création de l'UE, ce sont au contraire les divergences entre les nations, aussi bien économiques que politiques, qui se sont accentuées.
L'euro est très révélateur des contradictions de l'Union européenne. Les billets sont signés par le gouverneur de la banque centrale européenne, banque sans Etat, et marqués d'un copyright comme pour une entreprise. Ils sont coupés de toute histoire nationale mais aussi de l'histoire européenne, précisément parce que celle-ci est faite des histoires des nations.
Après que bien des symboles sont écartés au motif qu'ils « succombent du fait du biais national » (Van Middelaar), il fût décidé qu'au recto des billets devaient apparaître des personnalités anonymes et au verso des éléments architecturaux. Ceux-ci ont finalement été représentés à la fois au recto et au verso. Ils n'ont rien à voir avec des monuments existants.
L'étude des billets suffit à comprendre pourquoi l'euro est condamné à s'effondrer. S'il n'a pas de « visage », comme l'écrit Hervé Juvin, c'est parce qu'il est une « monnaie sortie de l'histoire ». Il ne correspond pas aux réalités.
Subordination du national au supranational
Le processus dit d'« intégration européenne » n'a, certes, pas les mêmes conséquences pour tous les pays.
L'Allemagne a utilisé l'Union européenne, comme l'a montré Marie France Garaud dans ses écrits, pour se reconstituer pacifiquement un Etat. C'est pourquoi le chancelier Kohl avait demandé dans une lettre adressée à François Mitterrand l'accélération du calendrier de mise en place d'une Union économique et monétaire et un nouveau traité, qui deviendrait le traité de Maastricht, « pour des raisons de politique intérieure ».
Depuis, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe selon laquelle il ne peut y avoir de démocratie européenne en l'absence de peuple européen veille à la primauté de la loi fondamentale allemande, alors qu'en France les traités ont été constitutionnalisés.
En France, ajouter au drapeau français le drapeau européen revient à subordonner le national au supranational.
Le drapeau européen fait partie du portrait officiel du président de la République depuis Nicolas Sarkozy, sous la présidence duquel a été ratifié le traité de Lisbonne. Il se trouve au Palais Bourbon, où siègent les représentants du peuple, depuis 2008.
Accoler deux drapeaux lors d'une rencontre entre chefs d'Etat ne participe pas du tout de la même logique, chacun représentant son propre pays et portant ses intérêts propres. Le drapeau européen marque l'ascendant d'un objet non politique et sans légitimité, puisqu'assis sur aucune souveraineté européenne et rejeté par les Français en 2005, sur la nation, cadre de la démocratie.
Par ses choix symboliques, Emmanuel Macron s'inscrit pleinement dans la continuité des dernières décennies plutôt qu'il ne contribue à édifier une « nouvelle Europe » illusoire, qui comporterait enfin la solidarité nécessaire à sa viabilité.
Le faux débat sur « l'emblème confessionnel »
Les parlementaires insoumis ont cependant amené le débat sur un autre terrain, celui de la dimension religieuse ou non du drapeau, qui - en l'occurrence - paraît bien anecdotique.
Le drapeau européen date de 1955. Il était d'abord celui du Conseil de l'Europe. Le fonctionnaire à l'origine du drapeau se serait inspiré d'une médaille représentant la Vierge Marie.
Cependant, contrairement à ce qui a pu être dit, les douze étoiles ne sont pas une référence directe aux apôtres. Le nombre d'étoiles était initialement de quinze ; il fût décidé de le ramener à douze car - entre autres raisons - dans la symbolique c'est le nombre de la perfection et de la plénitude. En revanche, comme l'a souligné Alexis Corbière, le drapeau a bien été adopté le jour où l'on fête l'Immaculée Conception.
Outre que l'inspiration dudit fonctionnaire ne signifie pas une volonté délibérée de marquer religieusement le drapeau européen, il semble que toute préoccupation religieuse ait été étrangère à l'attribution du symbole du Conseil de l'Europe à la communauté économique européenne dans les années 1980.
Parler d'« emblème confessionnel » est inadapté, et cet argument en dit sans doute plus sur ceux qui l'ont émis que sur l'objet sur lequel il porte. Ce que les députés Insoumis semblent surtout regretter, c'est que l'Europe - et non pas l'Union européenne - ait des racines romaines, grecques et judéo-chrétiennes.
L'antécédent de 2005
Les Insoumis ont avancé un autre argument bien plus intéressant. Le peuple français a rejeté en 2005 le traité qui comprenait les symboles européens. Le traité de Lisbonne qui s'y est substitué, bien qu'il reprenne l'essentiel du texte précédent, ne les conserve pas. 16 des 28 Etats les ont reconnus dans la déclaration 52 annexée au traité de Lisbonne : la France, l'Irlande et les Pays-Bas n'en font pas partie. Cela n'a pas empêché un emploi fréquent de ces symboles en France, lors de la fête nationale du 14 juillet par exemple, sur les portraits officiels des présidents comme il a été dit ou au fronton des bâtiments publics.
Les Français, bien sûr, n'ont pas voté « non » au TCE parce qu'ils étaient contre le drapeau ou l'hymne européens mais ils sont indissociables du contenu du traité qui a motivé les refus des peuples. Ils ont de fait été amenés en 2005 à symboliser la logique supranationale à l'œuvre qui défait les nations. Les parlementaires, comme l'a déclaré Jean-Luc Mélenchon, devraient en conséquence pouvoir s'exprimer sur la reconnaissance officielle du drapeau et de l'hymne européen. Mais cela reste bien insuffisant.
L'organisation d'un référendum sur les questions européennes où tous les enjeux seraient clairement posés fait cruellement défaut. Il est encore très improbable dans la mesure où 2005 et ses suites sont encore dans toutes les têtes dirigeantes.
Au nom de l'impératif européen, la voix du peuple français est condamnée au silence. •
Laurent Ottavi est auteur à Atlantico et Liberté Politique.



 A entendre les médias, l'inédit est permanent : ainsi, au moment de la décapitation d'un industriel par un islamiste ordinaire non loin de Grenoble, il y a quelques semaines, la presse s'exclama que c'était la première fois dans notre beau pays et depuis le Moyen âge que cela arrivait. La photo faite par un policier et relayée par les réseaux sociaux puis la photo que les islamistes ont mis en circulation la semaine dernière, différente si le modèle reste tragiquement le même, de la tête accrochée à une grille de l'usine visée par l'attentat, ont choqué, et à juste titre. Nos sociétés sont devenues sensibles à une horreur qui, malheureusement, est monnaie (plus ou moins) courante sur des terres qui nous semblent lointaines et exotiques, de la Syrie au Mali, de l'Algérie au Nigéria, mais aussi à travers nombre de séries télévisées et de films à grand spectacle, et pas seulement dans Highlander... Mais en France, comment est-ce possible !
A entendre les médias, l'inédit est permanent : ainsi, au moment de la décapitation d'un industriel par un islamiste ordinaire non loin de Grenoble, il y a quelques semaines, la presse s'exclama que c'était la première fois dans notre beau pays et depuis le Moyen âge que cela arrivait. La photo faite par un policier et relayée par les réseaux sociaux puis la photo que les islamistes ont mis en circulation la semaine dernière, différente si le modèle reste tragiquement le même, de la tête accrochée à une grille de l'usine visée par l'attentat, ont choqué, et à juste titre. Nos sociétés sont devenues sensibles à une horreur qui, malheureusement, est monnaie (plus ou moins) courante sur des terres qui nous semblent lointaines et exotiques, de la Syrie au Mali, de l'Algérie au Nigéria, mais aussi à travers nombre de séries télévisées et de films à grand spectacle, et pas seulement dans Highlander... Mais en France, comment est-ce possible !


 « Il y a une centralité de la pensée de Maurras à droite, comme il y a une centralité de la pensée de Marx à gauche »
« Il y a une centralité de la pensée de Maurras à droite, comme il y a une centralité de la pensée de Marx à gauche »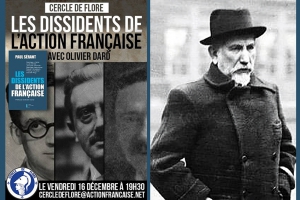

 Que vous inspire le vote des Britanniques ?
Que vous inspire le vote des Britanniques ?

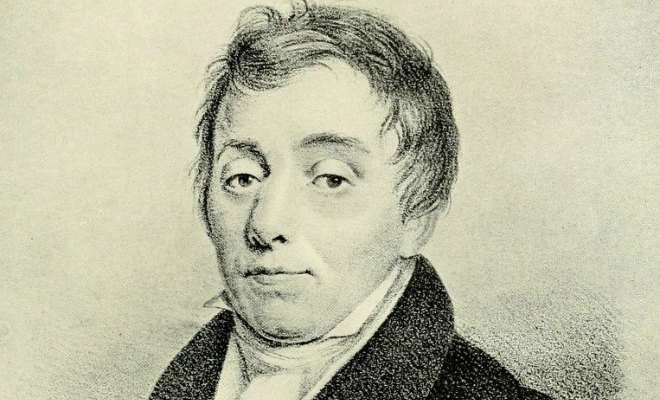
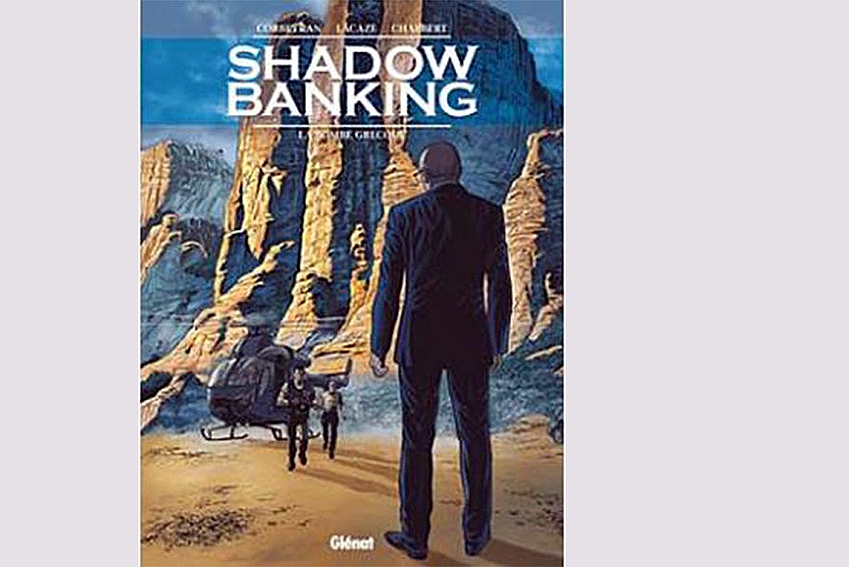

 Depuis de longues années, Philippe Delorme s'intéresse à la destinée tragique de Louis XVII,
Depuis de longues années, Philippe Delorme s'intéresse à la destinée tragique de Louis XVII, 


 Emmanuel Macron l'a montré lors des premiers mois de sa présidence : il aime les symboles. Il sait qu'ils n'ont rien d'anecdotique.
Emmanuel Macron l'a montré lors des premiers mois de sa présidence : il aime les symboles. Il sait qu'ils n'ont rien d'anecdotique.

