Un mathématicien égaré en économie, par François Reloujac *
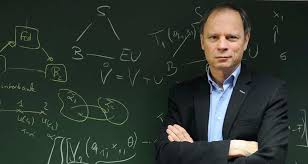
Le 13 octobre dernier, l’académie Nobel a attribué le prix d’économie au chercheur français Jean Tirole. Une manifestation de « la France qui gagne » aussitôt saluée par le président de la République et par le Premier ministre. Mais personne ne s’est véritablement interrogé sur la raison qui permet d’affirmer que les travaux de Jean Tirole illustrent la pensée économique française, même si, officiellement, celui-ci a été récompensé pour ses travaux sur « le pouvoir de marché et la régulation ».
Jean Tirole est un ancien élève de l’école polytechnique. Il est allé mettre en œuvre ses acquis théoriques d’exploitation des statistiques économiques au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. C’est là qu’il s’est familiarisé avec la théorie des jeux, un ensemble d’outils qui analyse les situations dans lesquelles l’action optimale pour un agent dépend des anticipations qu’il forme sur la décision d’un autre agent. étant entendu que cet agent peut être aussi bien une personne physique qu’une entreprise.
S’il n’a pas pris la nationalité américaine – contrairement à un autre prix Nobel d’économie « français », Gérard Debreu – c’est qu’il est revenu en France pour y créer, sur le modèle des universités américaines, la « Toulouse School of Economics » (TSE). Cette dernière est uniquement financée par des grandes entreprises. Les cours y sont dispensés en anglais à des étudiants qui, pour 60 % d’entre eux sont étrangers, par des professeurs dont bien peu sont de nationalité française.
Rien d’étonnant, donc, dans le fait que cette école soit soutenue par des grandes entreprises ouvertes à l’international et ayant sur leurs marchés respectifs une position de monopole ou de quasi-monopole. La théorie des jeux et les études statistiques pointues qui sont développées à l’école toulousaine leur sont très utiles : elles leur permettent d’améliorer continuellement leur capacité à analyser toutes les combinaisons possibles des réactions de leurs « partenaires » (administration, fournisseurs, consommateurs). Le jeu est d’autant plus « payant » qu’un joueur principal – une entreprise en position de force sur un marché – est mieux « informé » que les autres. C’est pourquoi cette école cherche à tempérer cet avantage que possède le plus fort par un mécanisme dit de « régulation » dont le but avoué est de maintenir une apparence de libre concurrence.
Que récompense le prix Nobel d’économie ?
Jean Tirole est un grand mathématicien, un excellent professeur et un chercheur consciencieux. Mais sa distinction révèle les limites du prix Nobel qui ne couronne plus des économistes dont les travaux cherchent à améliorer le système ou le bien commun économique, mais qui distingue désormais uniquement des spécialistes travaillant sur des secteurs particuliers, fussent-ils utiles à tous ou simplement à un petit nombre.
De fait, pour Jean Tirole comme pour nombre de ses prédécesseurs, l’économie, relevant de la « science », doit toujours l’emporter sur le politique. Il se rattache donc, comme l’a dit le professeur Christian Stoffaes, « à la gauche utopique pré-marxiste et au positivisme » et, comme la plupart des « ingénieurs-économistes », adhère « à l’idéologie du progrès par la science ». C’est pourquoi Jean Tirole a toujours considéré que le « régulateur » économique – en France, l’Autorité de la concurrence – devait être mis à l’abri de toute influence politique. Il a d’ailleurs tiré les conclusions de cette logique pour justifier la création d’une Union bancaire européenne qui ne dépendrait pas des états : « Il ne faut pas, a-t-il dit, que les gouvernements puissent intervenir dans la réglementation prudentielle car les gouvernants ont leurs propres objectifs qui peuvent après entraîner des difficultés importantes pour les banques ».
Ainsi, depuis plus de vingt ans, le prix Nobel d’économie ne couronne que des spécialistes de micro-économie. D’une part, parce que l’analyse des statistiques individuelles permet de donner une tournure plus scientifique à la recherche que l’étude des statistiques nationales. D’autre part, parce que de telles études ont une apparence plus « démocratique » que les analyses macro-économiques : pour les « démocrates », en effet, l’intérêt général n’est que la somme des intérêts individuels. Si l’on « maximise » le profit de chacun, on « maximisera » le bien-être de tous. Pour le plus grand bonheur des (grandes) entreprises.
C’est l’avis de Manuel Valls qui a remis au goût du jour un projet déjà porté par Nicolas Sarkozy mais qui est maintenant revêtu de l’autorité du prix Nobel : la fusion des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée dans un contrat de travail « unique » !
Que penser du contrat de travail unique ?
Derrière cette « réforme » se cache en fait la suppression des CDI, accusés de rigidifier le marché du travail en « surprotégeant » ceux qui en bénéficient, et la généralisation du CDD. Elle est bien vue des grandes entreprises multinationales qui y voient le moyen de délocaliser plus facilement leur production vers des pays où les charges sociales sont moins élevées ou de remplacer les travailleurs autochtones par des immigrés moins exigeants, mais elle se heurte, naturellement, à l’hostilité des syndicats de salariés. Avec une telle réforme, on se rapprocherait du système américain. Mais, si le marché du travail américain est plus fluide et moins contraint que le nôtre, cela ne signifie pas obligatoirement que sa fluidité est « la » cause du plein emploi. à l’inverse, les études statistiques relatives à l’activité des multinationales montrent effectivement qu’elles se portent mieux si elles peuvent « presser le citron et jeter la peau ». Autrement dit, remplacer leurs salariés dès qu’ils sont jugés moins performants. On a beau dire que le marché du travail, en France, protège trop l’emploi et pas assez le salarié, ce n’est pas cette mesure qui, à elle seule, changerait la donne en profondeur. Le chômage ne diminuerait pas uniquement du fait d’une telle « réforme ». Il ne diminuera que si les produits fabriqués en France trouvent preneur au prix auquel ils sont obtenus et s’ils correspondent à un besoin réel des consommateurs. Agir uniquement sur la nature juridique des contrats du travail, c’est s’intéresser à un symptôme dans le but de n’avoir pas à affronter les causes du mal. Qu’un mathématicien, égaré dans le monde économique de la grande entreprise se laisse tenter, soit ; qu’un homme politique, responsable du bien commun, lui emboîte le pas, non !
Le prix Nobel d’économie 2014 vient donc couronner un Français qui a fait le choix, à un moment crucial de sa carrière, de revenir en France… Mais dont on peut se demander si, même inconsciemment, il n’est pas plus au service des intérêts américains qu’un Français ayant assimilé les acquis intellectuels américains pour les faire servir au rayonnement de la France dans le monde. ♦
Source : Politique magazine



 Aucune analyse de l’actualité, aucune prévision raisonnable, aucune protestation des populations maltraitées, pressurées, rejetées n’ont jusqu’à présent changé les habitudes politiciennes et l’inconcevable permanence de leur médiocrité. Voilà que la violence absolue surgit... Alors ?
Aucune analyse de l’actualité, aucune prévision raisonnable, aucune protestation des populations maltraitées, pressurées, rejetées n’ont jusqu’à présent changé les habitudes politiciennes et l’inconcevable permanence de leur médiocrité. Voilà que la violence absolue surgit... Alors ?
 Aucune autorité politique ou financière ne semble avoir tiré les leçons de la grande crise de 2008, qui a failli faire s’écrouler toute l’économie mondiale. Un nouveau krach est-il possible ?
Aucune autorité politique ou financière ne semble avoir tiré les leçons de la grande crise de 2008, qui a failli faire s’écrouler toute l’économie mondiale. Un nouveau krach est-il possible ?

 L'écologiste Alexander Van der Bellen sera donc le prochain président de la République d'Autriche. Jusqu'au premier tour du scrutin, le 24 avril dernier, pas une personne sur 100 000, en Europe, ne connaissait le nom du président sortant dont le mandat s'achève (il s'agit du socialiste Heinz Fischer). A écouter le discours tenu ces jours derniers par des experts dont on se demande s'ils ont mis un jour les pieds dans ce pays, discours relayé par des médias qui dévident en boucle de la pensée automatique, le successeur du président Fischer devait être le sauveur ou à l'inverse le fossoyeur de la démocratie autrichienne.
L'écologiste Alexander Van der Bellen sera donc le prochain président de la République d'Autriche. Jusqu'au premier tour du scrutin, le 24 avril dernier, pas une personne sur 100 000, en Europe, ne connaissait le nom du président sortant dont le mandat s'achève (il s'agit du socialiste Heinz Fischer). A écouter le discours tenu ces jours derniers par des experts dont on se demande s'ils ont mis un jour les pieds dans ce pays, discours relayé par des médias qui dévident en boucle de la pensée automatique, le successeur du président Fischer devait être le sauveur ou à l'inverse le fossoyeur de la démocratie autrichienne.
 Pléthore de candidats à la candidature : à droite, à gauche, bientôt au centre et jusque dans le résidu qui subsiste du parti écologiste où, déjà, trois candidats se sont déclarés.
Pléthore de candidats à la candidature : à droite, à gauche, bientôt au centre et jusque dans le résidu qui subsiste du parti écologiste où, déjà, trois candidats se sont déclarés.
 Dans quelques jours sera tranchée l'élection la plus pitoyable de l'histoire américaine. Un spectacle affligeant offert par la « grande démocratie » qui entend si souvent donner des leçons au monde, et s'imposer en modèle. Mais de cette élection, les Français n'auront eu que le miroir déformant de médias hexagonaux occupés à se boucher le nez devant les sorties effarantes et vulgaires du clown milliardaire. Une façon de nous faire oublier l'essentiel : jamais une élection n'a à ce point montré de proximité entre les forces qui agitent l'Amérique et celle qui travaillent l'Europe dans son ensemble et la France en particulier.
Dans quelques jours sera tranchée l'élection la plus pitoyable de l'histoire américaine. Un spectacle affligeant offert par la « grande démocratie » qui entend si souvent donner des leçons au monde, et s'imposer en modèle. Mais de cette élection, les Français n'auront eu que le miroir déformant de médias hexagonaux occupés à se boucher le nez devant les sorties effarantes et vulgaires du clown milliardaire. Une façon de nous faire oublier l'essentiel : jamais une élection n'a à ce point montré de proximité entre les forces qui agitent l'Amérique et celle qui travaillent l'Europe dans son ensemble et la France en particulier.
 Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner l’histoire dans des quartiers réputés difficiles ?
Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner l’histoire dans des quartiers réputés difficiles ?
 L’invitation faite à Marion Maréchal-Le Pen, pour participer au colloque organisé par le diocèse de Fréjus-Toulon à la Sainte-Baume, a suscité beaucoup de réactions, certaines sans doute sincères, mais beaucoup surjouées. Comme s’il était insupportable d’ouvrir une discussion avec une dirigeante d’un parti définitivement ostracisé ! Décidément, on ne se départit pas aisément d’une sorte de réflexe inquisitorial qui consiste à frapper d’interdit moral et canonique l’adversaire politique ! Et ce sont ceux qui se targuent le plus d’ouverture à l’autre, quelles que soient ses différences, qui sont les plus implacables. À l’encontre du conformisme qui continue à sévir dans le catholicisme français, je n’hésiterai pas à affirmer que la venue de la jeune dirigeante à la Sainte-Baume s’inscrit dans un processus inévitable. Il est impossible désormais d’ignorer un secteur d’opinion qui regroupe au moins un quart de l’électorat français. L’attitude, qui consiste à imaginer qu’on pourrait l’entourer d’une sorte de cordon sanitaire isolant des millions d’intouchables, relève d’une étrange mentalité.
L’invitation faite à Marion Maréchal-Le Pen, pour participer au colloque organisé par le diocèse de Fréjus-Toulon à la Sainte-Baume, a suscité beaucoup de réactions, certaines sans doute sincères, mais beaucoup surjouées. Comme s’il était insupportable d’ouvrir une discussion avec une dirigeante d’un parti définitivement ostracisé ! Décidément, on ne se départit pas aisément d’une sorte de réflexe inquisitorial qui consiste à frapper d’interdit moral et canonique l’adversaire politique ! Et ce sont ceux qui se targuent le plus d’ouverture à l’autre, quelles que soient ses différences, qui sont les plus implacables. À l’encontre du conformisme qui continue à sévir dans le catholicisme français, je n’hésiterai pas à affirmer que la venue de la jeune dirigeante à la Sainte-Baume s’inscrit dans un processus inévitable. Il est impossible désormais d’ignorer un secteur d’opinion qui regroupe au moins un quart de l’électorat français. L’attitude, qui consiste à imaginer qu’on pourrait l’entourer d’une sorte de cordon sanitaire isolant des millions d’intouchables, relève d’une étrange mentalité.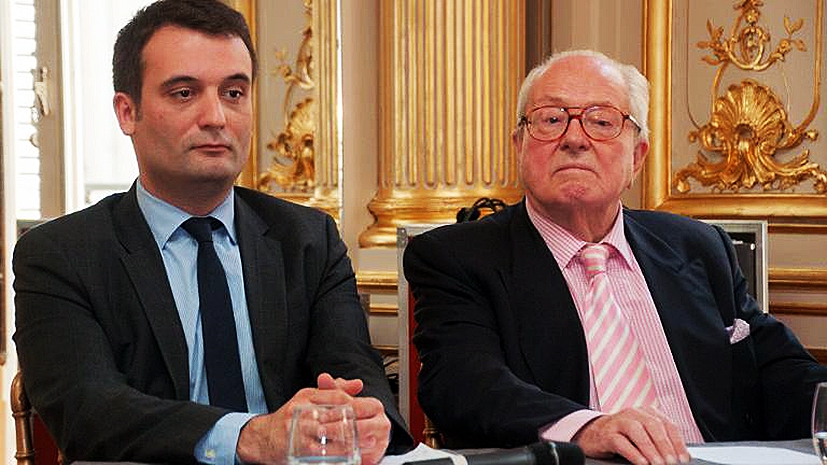
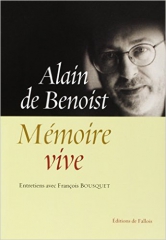

 La semaine dernière, Malek Boutih rendait
La semaine dernière, Malek Boutih rendait 



 Il a longuement hésité. Pesé le pour et le contre. Pris des avis de sens contraire. Entendu les arguments des uns et des autres. Souri complaisamment aux uns comme aux autres. Laissé croire à ses interlocuteurs, quels qu’ils fussent, ce qu’ils avaient envie de croire. D’un côté, il y avait un marqueur traditionnel de la gauche. De l’autre, la possibilité d’une manœuvre politicienne fructueuse. Entre la fidélité aux grands principes, au risque de paraître manquer de détermination face au terrorisme, et l’éventuel avantage électoral qu’il pourrait tirer d’une posture de fermeté, François Hollande a balancé, au point que même deux des ministres les plus directement intéressés, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, ont pu s’y tromper et que la dernière nommée a entrepris la tournée des dupes qui l’a menée à Alger et au bord de la rupture. Puis le Président a tranché – on sait dans quel sens.
Il a longuement hésité. Pesé le pour et le contre. Pris des avis de sens contraire. Entendu les arguments des uns et des autres. Souri complaisamment aux uns comme aux autres. Laissé croire à ses interlocuteurs, quels qu’ils fussent, ce qu’ils avaient envie de croire. D’un côté, il y avait un marqueur traditionnel de la gauche. De l’autre, la possibilité d’une manœuvre politicienne fructueuse. Entre la fidélité aux grands principes, au risque de paraître manquer de détermination face au terrorisme, et l’éventuel avantage électoral qu’il pourrait tirer d’une posture de fermeté, François Hollande a balancé, au point que même deux des ministres les plus directement intéressés, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, ont pu s’y tromper et que la dernière nommée a entrepris la tournée des dupes qui l’a menée à Alger et au bord de la rupture. Puis le Président a tranché – on sait dans quel sens.


