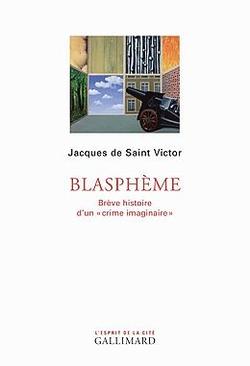Société • Mathieu Bock-Côté : la crèche et la nation

Crèche de Noël, installée dans la mairie des XIIIe et XIVe arrondissements de Marseille en décembre 2014
 Rares sont ceux, probablement, qui n'abordent pas avec une certaine perplexité la querelle entourant la place accordée ou non à la crèche dans les bâtiments publics. Non pas qu'elle soit sans intérêt : au contraire, cette querelle pose la question du rapport de la nation française avec le catholicisme, qui l'a marqué d'une profonde empreinte, et qui est encore agissant en elle, malgré la sacralisation de la laïcité républicaine. N'est-il pas légitime que l'identité historique d'une nation s'inscrive de différentes manières au cœur de ses institutions ? En fait, on se demande comment on peut voir dans la présence publique de ce symbole un scandale, à une époque où le catholicisme n'a plus rien de conquérant et semble surtout demander qu'on reconnaisse sa valeur patrimoniale. Faut-il vraiment s'offusquer de cette trace visible de la religion du pays dans ses institutions ? La crèche compromet-elle sérieusement la laïcité ? Qui s'imagine vraiment que le catholicisme français témoignerait ici d'un fantasme de la restauration ?
Rares sont ceux, probablement, qui n'abordent pas avec une certaine perplexité la querelle entourant la place accordée ou non à la crèche dans les bâtiments publics. Non pas qu'elle soit sans intérêt : au contraire, cette querelle pose la question du rapport de la nation française avec le catholicisme, qui l'a marqué d'une profonde empreinte, et qui est encore agissant en elle, malgré la sacralisation de la laïcité républicaine. N'est-il pas légitime que l'identité historique d'une nation s'inscrive de différentes manières au cœur de ses institutions ? En fait, on se demande comment on peut voir dans la présence publique de ce symbole un scandale, à une époque où le catholicisme n'a plus rien de conquérant et semble surtout demander qu'on reconnaisse sa valeur patrimoniale. Faut-il vraiment s'offusquer de cette trace visible de la religion du pays dans ses institutions ? La crèche compromet-elle sérieusement la laïcité ? Qui s'imagine vraiment que le catholicisme français témoignerait ici d'un fantasme de la restauration ?
Mais on le sait, la querelle de la crèche s'inscrit dans un contexte politique fort agité. En un mot, la France est aujourd'hui fragilisée comme jamais. L'immigration massive des dernières décennies a engendré une mutation identitaire majeure que seuls les gardiens de la révolution diversitaire diront heureuse. Spontanément, le pays, de mille manières, veut rappeler aux immigrés qu'ils ne rejoignent pas une page blanche non plus qu'un no man's land administratif. Il veut réaffirmer son identité trop longtemps occultée. La France n'est pas qu'une république laïque désirant incarner de manière exemplaire des principes universels. C'est aussi un vieux pays aux profondes racines chrétiennes. Si toutes les convictions sont égales devant la loi, toutes les traditions religieuses ne sont pas égales devant la mémoire. Il s'agit dès lors de rendre visible la marque chrétienne de l'identité française, pour rappeler aux immigrés dans quel monde ils arrivent et quel univers symbolique ils doivent accepter et intérioriser.
Mais il faut probablement aller au-delà de ce désir de conserver la particularité historique du pays pour comprendre ce qui pousse plusieurs à se tourner vers la crèche, et peut-être inconsciemment, par-là, vers la croix. La seule référence à la république, aussi essentielle soit-elle, ne suffit manifestement plus à définir ce que les Français cherchent à sauver et à défendre. Et dès lors, s'ils cherchent à se définir autrement, ou du moins, s'ils cherchent une définition plus complète d'eux-mêmes, ils se tournent spontanément vers ce qui semble être leur plus ancienne tradition. Ou du moins, ils semblent croire que les références chrétiennes permettent de toucher la part la plus intime du pays ou ce qu'on aurait appelé autrefois ses origines. La crèche devient donc un symbole politique censé permettre à la nation de se connecter avec ses profondeurs intimes et de réactiver les strates les plus profondes de l'identité nationale. Il s'agit de se mobiliser en rappelant ce qu'on pourrait appeler la part sacrée de la patrie, enfouie sous la modernité.
On aurait tort, toutefois, d'y voir un désir plus ou moins refoulé de confessionnalisation de la vie politique. D'ailleurs, sauf dans les marges les plus lointaines de la vie politique, on ne trouvera personne entretenant cette aspiration. On doit plutôt voir dans cette mémoire catholique politiquement revendiquée une manière de ressaisir une identité plus charnelle, plus substantielle, ne se laissant pas dissoudre dans les seuls paramètres de la modernité contractualiste. Le catholicisme, aussi universaliste soit-il dans ses prétentions, devient alors le symbole de ce qui est spécifiquement français, ou plus largement, puisque ce phénomène est présent aussi dans d'autres pays, de ce qui est spécifiquement occidental dans l'identité française. À tout le moins, il se présente comme une tradition permettant à la France d'assurer sa continuité historique et d'assumer son histoire longue.
Ce catholicisme patrimonial, censé conduire aux strates profondes de l'identité nationale, n'est donc pas contradictoire, dans l'esprit public, avec la laïcité. On peut, à bon droit, et avec raison, distinguer le catholicisme comme religion culturelle et le catholicisme comme foi, et vouloir accorder ses droits au premier sans se plier aux convictions métaphysiques du second. Les croyants répondront que coupé de sa source, le premier est condamné à la sécheresse. Mais ce n'est pas à l'État à trancher dans cette querelle qui ne le concerne pas vraiment. On ne voit pas pourquoi on lui prêterait une compétence théologique et comment on pourrait empêcher un croyant de voir dans une crèche quelque chose de plus qu'un symbole patrimonial. Mais l'État, toutefois, exprime politiquement une nation historique aux sources identitaires nombreuses, et doit, dans une certaine mesure, s'alimenter à chacune d'entre elles, en sachant que d'une époque à une autre, toutes ne seront pas également sollicitées.
Dans un monde où ce qu'on nomme plus ou moins adéquatement le choc des civilisations prend surtout le visage de l'islam conquérant, on comprend que chaque peuple revienne sur ce qu'il croit être sa propre tradition religieuse. Le paradoxe du monde occidental, aujourd'hui, est d'y revenir sans trop y croire, tout en sachant que ses racines chrétiennes le connectent à une part de l'existence qu'il ne peut renier sans s'appauvrir mais qu'il ne sait plus trop comment symboliser. Une chose est certaine: le politique, quoi qu'on en pense, est lié à une certaine idée de l'homme, ainsi qu'à une certaine idée de sacré. Il s'inscrit, autrement dit, dans une civilisation qui donne une réponse particulière aux grandes questions qui traversent l'âme humaine. Il n'est pas surprenant que l'esprit public, aujourd'hui, refuse de voir une contradiction entre la laïcité et les racines chrétiennes: elles représentent deux visages d'une même civilisation. •
« La seule référence à la république, aussi essentielle soit-elle, ne suffit manifestement plus à définir ce que les Français cherchent à sauver et à défendre. »
 Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.
Mathieu Bock-Côté est docteur en sociologie, chargé de cours aux HEC à Montréal et chroniqueur au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Ses travaux portent principalement sur le multiculturalisme, les mutations de la démocratie contemporaine et la question nationale québécoise. Il est l'auteur d'Exercices politiques (éd. VLB, 2013), de Fin de cycle: aux origines du malaise politique québécois (éd. Boréal, 2012) et de La dénationalisation tranquille (éd. Boréal, 2007). Son dernier livre, Le multiculturalisme comme religion politique, vient de paraître aux éditions du Cerf.



 Au commencement était le journal. Un premier, puis un second article dans l'hebdomadaire Marianne, en pleine bataille contre la réforme des programmes scolaires engagées par Najat Valaud-Belkacem. Avec ses éditoriaux frémissants d'une colère légitime et talentueuse, Jacques Julliard fit partie de cette escouade de « pseudo-intellectuels » dénoncés par la ministre, qui chargèrent et sabrèrent avec la fureur et l'efficacité redoutable de la cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau. Aussitôt lus dans l'hebdomadaire, aussitôt repérés par un éditeur à l'œil acéré ; aussitôt commandés, imprimés, publiés. Les deux éditos sont désormais précédés d'une longue et utile mise en perspective, mais ils n'en constituent pas moins le cœur battant du texte. À juste titre. Ils méritaient les honneurs d'une publication. Le coup d'éditeur n'est pas seulement cette fois simple ravaudage commercial. Le travail a été rapide, expédié mais pas bâclé ; le libelle de circonstance s'avère le produit d'une lente et profonde maturation.
Au commencement était le journal. Un premier, puis un second article dans l'hebdomadaire Marianne, en pleine bataille contre la réforme des programmes scolaires engagées par Najat Valaud-Belkacem. Avec ses éditoriaux frémissants d'une colère légitime et talentueuse, Jacques Julliard fit partie de cette escouade de « pseudo-intellectuels » dénoncés par la ministre, qui chargèrent et sabrèrent avec la fureur et l'efficacité redoutable de la cavalerie de Murat à la bataille d'Eylau. Aussitôt lus dans l'hebdomadaire, aussitôt repérés par un éditeur à l'œil acéré ; aussitôt commandés, imprimés, publiés. Les deux éditos sont désormais précédés d'une longue et utile mise en perspective, mais ils n'en constituent pas moins le cœur battant du texte. À juste titre. Ils méritaient les honneurs d'une publication. Le coup d'éditeur n'est pas seulement cette fois simple ravaudage commercial. Le travail a été rapide, expédié mais pas bâclé ; le libelle de circonstance s'avère le produit d'une lente et profonde maturation.
 Pourquoi la gauche, malgré ses prétentions critiques face à l'Histoire, se montre-t-elle aujourd'hui incapable de penser le monde? A cette question déplaisante pour les grandes têtes molles du gauchisme culturel, il conviendrait d'en associer une seconde afin d'être complet. Pourquoi la droite, malgré ses prétentions patrimoniales, se montre-t-elle incapable de conserver le monde ? Les « mystères de la gauche » dont a merveilleusement parlé le philosophe Jean-Claude Michéa dans un « précis de décomposition » d'un genre un peu particulier s'appréhendent à la seule condition d'envisager en miroir ceux de la droite. Là, ceux qui ne sont plus capables de rien comprendre ; ici, ceux qui ne veulent plus rien sauver — surtout ceux qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui n'ont rien : les pauvres et le peuple. C'est cependant à la seule gauche postmoderne que s'en prend le philosophe Renaud Garcia dans Le Désert de la critique, déconstruction et politique (Editions l'Echappée). Un livre qui fera date, soyons en sûr, comme ont fait date Orwell anarchist tory (1995), L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes (1999) et Impasse Adam Smith (2002) de Jean-Claude Michéa.
Pourquoi la gauche, malgré ses prétentions critiques face à l'Histoire, se montre-t-elle aujourd'hui incapable de penser le monde? A cette question déplaisante pour les grandes têtes molles du gauchisme culturel, il conviendrait d'en associer une seconde afin d'être complet. Pourquoi la droite, malgré ses prétentions patrimoniales, se montre-t-elle incapable de conserver le monde ? Les « mystères de la gauche » dont a merveilleusement parlé le philosophe Jean-Claude Michéa dans un « précis de décomposition » d'un genre un peu particulier s'appréhendent à la seule condition d'envisager en miroir ceux de la droite. Là, ceux qui ne sont plus capables de rien comprendre ; ici, ceux qui ne veulent plus rien sauver — surtout ceux qui en ont le plus besoin, à savoir ceux qui n'ont rien : les pauvres et le peuple. C'est cependant à la seule gauche postmoderne que s'en prend le philosophe Renaud Garcia dans Le Désert de la critique, déconstruction et politique (Editions l'Echappée). Un livre qui fera date, soyons en sûr, comme ont fait date Orwell anarchist tory (1995), L'enseignement de l'ignorance et ses conditions modernes (1999) et Impasse Adam Smith (2002) de Jean-Claude Michéa.
 L’invitation faite à Marion Maréchal-Le Pen, pour participer au colloque organisé par le diocèse de Fréjus-Toulon à la Sainte-Baume, a suscité beaucoup de réactions, certaines sans doute sincères, mais beaucoup surjouées. Comme s’il était insupportable d’ouvrir une discussion avec une dirigeante d’un parti définitivement ostracisé ! Décidément, on ne se départit pas aisément d’une sorte de réflexe inquisitorial qui consiste à frapper d’interdit moral et canonique l’adversaire politique ! Et ce sont ceux qui se targuent le plus d’ouverture à l’autre, quelles que soient ses différences, qui sont les plus implacables. À l’encontre du conformisme qui continue à sévir dans le catholicisme français, je n’hésiterai pas à affirmer que la venue de la jeune dirigeante à la Sainte-Baume s’inscrit dans un processus inévitable. Il est impossible désormais d’ignorer un secteur d’opinion qui regroupe au moins un quart de l’électorat français. L’attitude, qui consiste à imaginer qu’on pourrait l’entourer d’une sorte de cordon sanitaire isolant des millions d’intouchables, relève d’une étrange mentalité.
L’invitation faite à Marion Maréchal-Le Pen, pour participer au colloque organisé par le diocèse de Fréjus-Toulon à la Sainte-Baume, a suscité beaucoup de réactions, certaines sans doute sincères, mais beaucoup surjouées. Comme s’il était insupportable d’ouvrir une discussion avec une dirigeante d’un parti définitivement ostracisé ! Décidément, on ne se départit pas aisément d’une sorte de réflexe inquisitorial qui consiste à frapper d’interdit moral et canonique l’adversaire politique ! Et ce sont ceux qui se targuent le plus d’ouverture à l’autre, quelles que soient ses différences, qui sont les plus implacables. À l’encontre du conformisme qui continue à sévir dans le catholicisme français, je n’hésiterai pas à affirmer que la venue de la jeune dirigeante à la Sainte-Baume s’inscrit dans un processus inévitable. Il est impossible désormais d’ignorer un secteur d’opinion qui regroupe au moins un quart de l’électorat français. L’attitude, qui consiste à imaginer qu’on pourrait l’entourer d’une sorte de cordon sanitaire isolant des millions d’intouchables, relève d’une étrange mentalité.
 Un jour, le soleil s’est couché et il ne s’est pas relevé… C’était le 1er septembre d’il y a trois siècles : et pourtant, comme il l’avait promis, sa mort physique marque aussi sa « sur-vie » politique, au-delà de son temps et pour la mémoire des siècles, par la reconnaissance que l’Etat est maître du pays, par son administration et son autorité, mais aussi à travers ses monuments, autant Versailles que ce que Napoléon qualifiera des « masses de granit », c’est-à-dire les grands principes qui fondent l’Etat moderne et son fonctionnement. Louis XIV, d’une phrase célèbre prononcée sur son lit de souffrance et de mort, déclare : « Messieurs, je m’en vais, mais l’Etat demeurera toujours », sorte d’explication de texte à la formule rituelle de la Monarchie française « Le roi est mort, vive le roi », qui, après le dernier soupir du monarque, fut prononcée comme une évidence « absolue » au balcon du palais royal.
Un jour, le soleil s’est couché et il ne s’est pas relevé… C’était le 1er septembre d’il y a trois siècles : et pourtant, comme il l’avait promis, sa mort physique marque aussi sa « sur-vie » politique, au-delà de son temps et pour la mémoire des siècles, par la reconnaissance que l’Etat est maître du pays, par son administration et son autorité, mais aussi à travers ses monuments, autant Versailles que ce que Napoléon qualifiera des « masses de granit », c’est-à-dire les grands principes qui fondent l’Etat moderne et son fonctionnement. Louis XIV, d’une phrase célèbre prononcée sur son lit de souffrance et de mort, déclare : « Messieurs, je m’en vais, mais l’Etat demeurera toujours », sorte d’explication de texte à la formule rituelle de la Monarchie française « Le roi est mort, vive le roi », qui, après le dernier soupir du monarque, fut prononcée comme une évidence « absolue » au balcon du palais royal. 
 D'abord, il y a le style. Impétueux et tempétueux, un fleuve de montagne qui se déverse sans souci de ce qu'il charrie, formules en rafale, répétées autant de fois que nécessaire, sans respect de la bienséance littéraire. Et puis, il y a les mots, les mots employés à jet continu, les mots interdits aujourd'hui, banals hier : « race », « peuple » ou « famille française ». Comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Les Cahiers de l'Herne ont eu la bonne idée de publier les textes parmi les plus connus de Charles Péguy. On y retrouve ses formules les plus célèbres, celles qui ont fait sa gloire, citées à tort et à travers : « Tout commence en mystique et finit en politique…» ; ou encore: « Pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul face à l'esprit ».
D'abord, il y a le style. Impétueux et tempétueux, un fleuve de montagne qui se déverse sans souci de ce qu'il charrie, formules en rafale, répétées autant de fois que nécessaire, sans respect de la bienséance littéraire. Et puis, il y a les mots, les mots employés à jet continu, les mots interdits aujourd'hui, banals hier : « race », « peuple » ou « famille française ». Comme un voyage dans le temps et dans l'espace. Les Cahiers de l'Herne ont eu la bonne idée de publier les textes parmi les plus connus de Charles Péguy. On y retrouve ses formules les plus célèbres, celles qui ont fait sa gloire, citées à tort et à travers : « Tout commence en mystique et finit en politique…» ; ou encore: « Pour la première fois dans l'histoire du monde l'argent est seul face à l'esprit ». 

 Modernité… Tous les médias n’ont plus que ce mot à la bouche. Il faut être moderne, nous dit-on, « parce qu’on n’arrête pas le progrès ». Au fait, ça veut dire quoi, la « modernité » ?
Modernité… Tous les médias n’ont plus que ce mot à la bouche. Il faut être moderne, nous dit-on, « parce qu’on n’arrête pas le progrès ». Au fait, ça veut dire quoi, la « modernité » ?
 "Les ridicules légendes de la Bastille"
"Les ridicules légendes de la Bastille"




 L'ancien président de SOS-Racisme ne craint pas d'arriver aux mêmes conclusions que des observateurs classés à droite, d'où la hargne qu'il suscite dans sa famille politique, explique Chantal Delsol*.
L'ancien président de SOS-Racisme ne craint pas d'arriver aux mêmes conclusions que des observateurs classés à droite, d'où la hargne qu'il suscite dans sa famille politique, explique Chantal Delsol*.

 Les chiffres donnent le tournis : 58,4 millions de dollars pour un chien gonflable de Jeff Koons (Balloon Dog), 100 millions de dollars pour une tête de mort (certes incrustée de diamants) de Damien Hirst (For the Love of God), 70,5 millions de dollars acquittés le 11 novembre dernier, chez Sotheby’s à New York, pour des gribouillages sur tableau noir signés de Cy Twombly (Untitled). Selon le site Artprice, le chiffre d’affaires annuel du marché de l’art contemporain serait aujourd’hui de 1,7 milliard d’euros, soit une augmentation de 1 800 % en quinze ans !
Les chiffres donnent le tournis : 58,4 millions de dollars pour un chien gonflable de Jeff Koons (Balloon Dog), 100 millions de dollars pour une tête de mort (certes incrustée de diamants) de Damien Hirst (For the Love of God), 70,5 millions de dollars acquittés le 11 novembre dernier, chez Sotheby’s à New York, pour des gribouillages sur tableau noir signés de Cy Twombly (Untitled). Selon le site Artprice, le chiffre d’affaires annuel du marché de l’art contemporain serait aujourd’hui de 1,7 milliard d’euros, soit une augmentation de 1 800 % en quinze ans ! L’Imposture de l’art contemporain, une utopie financière, d’Aude de Kerros, Eyrolles, 256 pages, 25 €.
L’Imposture de l’art contemporain, une utopie financière, d’Aude de Kerros, Eyrolles, 256 pages, 25 €.