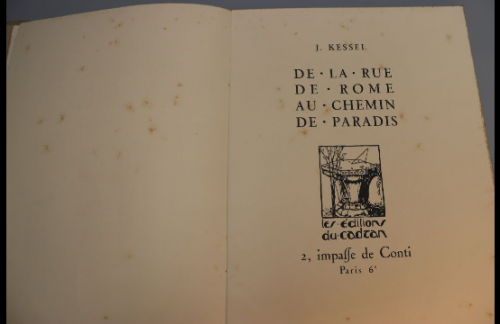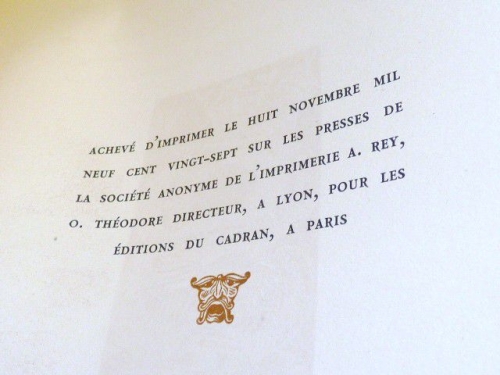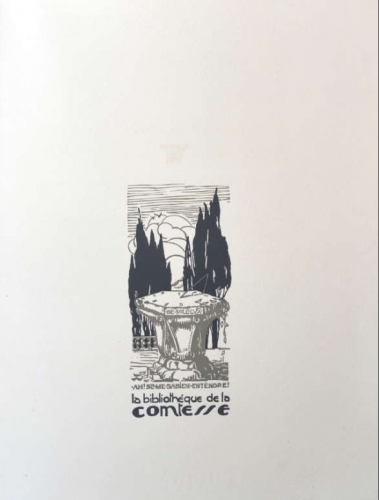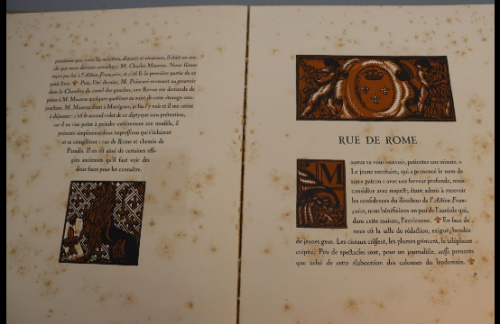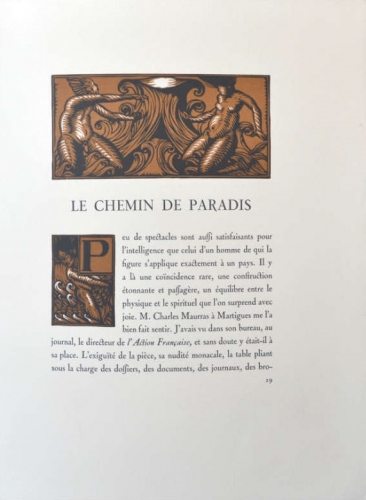"De la rue de Rome au Chemin de Paradis" : (1/2) Joseph Kessel vient visiter deux fois Charles Maurras...
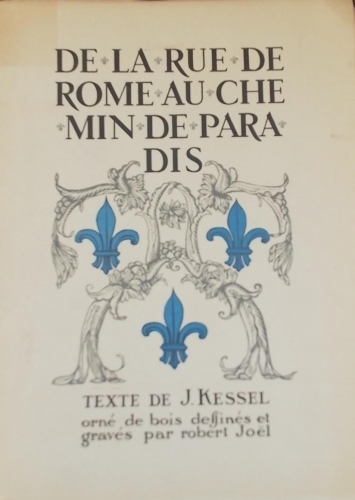
La seconde de ces visites aura lieu en 1926, à Martigues, chez Maurras, dans sa Bastide du Chemin de Paradis : non seulement Maurras accorda à Kessel l'entretien que celui-ci sollicita, mais il le retint à déjeuner : L'Action française publiera un compte-rendu de cette visite, que vous lirez dans notre livraison suivante.
Par contre, le journal ne publia rien sur la première de ces rencontres, qui eut lieu en 1924 au siège central du mouvement, alors situé au 20 rue de Rome, à Paris. Joseph Kessel était accompagné de Georges Suarez, et il a lui-même raconté ces deux visites dans un petit livre pour bibliophiles, un "livre d'art", dont on voit la couverture ci-dessus, et qu'il présente comme "deux modestes essais", un "petit livre" un "diptyque".
Nous commencerons donc, aujourd'hui, en donnant l'intégralité du récit de Kessel dans ce "petit livre", concernant la première visite à Maurras. Et, dans notre prochaine livraison, nous donnerons et le récit de Kessel (plus long que le compte-rendu du journal) et, justement, le compte-rendu du journal.
Kessel parle avec raison d'un "petit livre" car il suffit de 45 pages pour contenir le récit de ces deux visites; encore sont-elles écrites en assez gros caractères, dans ce joli petit volume de 33 centimètres sur 25, édité par les Éditions du Cadran, 2 Impasse de Conti, Paris 6ème.
Précisons juste que, lors de sa première visite à Maurras, Kessel, né en 1898, a vingt-six ans et Maurras, né trente ans auparavant, en 1868, en a cinquante neuf...
En dernière page, on lit :
Achevé d'imprimer le 8 Novembre 1927, sur les presses de la Société anonyme de l'imprimerie A. Rey, O. Théodore directeur, à Lyon, pour les éditions du Cadran, à Paris
Il n'en fut tiré que 530 exemplaires.
En page d'entrée on lit ceci :
JUSTIFICATION
Ce livre a été tiré à 530 exemplaires, dont 30 hors commerce
Savoir :
46 Vieux Japon à la forme des Manufactures Impériales, numérotés de 1 à 46
72 Hollande Van Gelder de 40 kilos, numérotés de 47 à 118
412 Vélin d'Arches de 45 kilos, numérotés de 119 à 530"
L'exemplaire dont j'ai fait l'acquisition porte le numéro 267.
L'ouvrage se compose d'un très court AVANT-PROPOS (pages 7 et 8); puis du récit de la première visite faite à Maurras, intitulé RUE DE ROME (de la page 9 à la page 15, c'est le morceau que nous donnons ci-après); enfin du récit de la seconde visite de Kessel, cette fois à Martigues, chez Maurras lui-même, qui en profita pour retenir Kessel à déjeuner (pages 29 à 46, que nous donnerons dans la livraison suivante), intitulé LE CHEMIN DE PARADIS.
François Davin
----------------------------------
1. Voici donc, d'abord, le très court
AVANT-PROPOS
"Voici deux modestes essais. Ils ont pour objet le même homme, et l'on s'étonnera peut-être qu'ils soient différents de ton et de dessin. C'est qu'ils ont été tracés à deux ans d'intervalle et dans une atmosphère qui en modifiait du tout au tout les contours. Les conditions où ils furent tentés étant, si l'on peut dire, historiques, qu'on me permette de les rappeler. Le premier des entretiens rapportés ici date de l'époque où le Bloc National achevait sa carrière. Les élections approchaient, celles du 11 Mai. Mon ami Georges Suarez - le vivant et brillant écrivain politique que l'on sait - et moi, chargés d'une enquête auprès des maîtres de l'heure, nous pensâmes que, outre les ministres, députés et sénateurs, il était un oracle que nous devions consulter : M. Charles Maurras. Nous fûmes reçus par lui à l'Action française, et c'est là la première partie de ce petit livre. Pui, l'été dernier, M. Poincaré revenant au pouvoir dans la Chambre du cartel des gauches, une Revue me demanda de poser à M. Maurras quelques questions au sujet de cette étrange conjoncture. M. Maurras étant à Martigues, je fus l'y voir et il me retint à déjeuner : c'est le second volet de ce diptyque sans prétention, car il ne vise point à peindre entièrement son modèle, il présente simplement deux impressions qui s'éclairent et se complètent : rue de Rome et chemin de Paradis. Il en est ainsi de certaines effigies anciennes qu'il faut voir des deux faces pour les connaître.
2. Puis (de la page 9 à la page 25) le premier récit :
RUE DE ROME
"Maurras va vous recevoir, patientez une minute." Le jeune secrétaire, qui a prononcé le nom de son "patron" avec une ferveur profonde, nous considère avec respecte; étant admis à recevoir les confidences du directeur de l'Action française, nous bénéficions un peu de l'auréole qui, dans cette maison, l'environne. En face de nous est la salle de rédaction, exigüe, bondée de jeunes gens. Les ciseaux crissent, les plumes grincent, le téléphone crépite. Peu de spectacles sont, pour un journaliste, aussi prenants que celui de cette élaboration des colonnes du lendemain. Comme nous attendons sans impatience dans un couloir étroit, le jeune secrétaire vient à nous. - Excusez Maurras, dit-il. Il reçoit les délégués des étudiants belges. Il est mortellement occupé. Songez que tout ligueur d'Action française de passage à Paris veut le voir, lui parler, recevoir ses directives. Songez qu'il tient à dépouiller tout le courrier. De nouveau une admiration profonde vibre dans sa voix, cette admiration que l'on sent partagée par toute une rédaction jeune, homogène, fanatisée. Enfin, au bout du couloir, une porte s'ouvre. Nous voici dans un réduit étroit, sorte de sombre cellule monacale. Sur la table se dresse une barricade énorme de livres, de papiers, de coupures. Trois fauteuils tiennent le reste de la chambre. M. Charles Maurras nous sourit. Qui verrait passer dans la rue cet homme de taille moyenne, de traits réguliers, penserait, en regardant sa mise toute simple et sa barbiche modeste : c'est un petit instituteur. Mais ici, dans la lumière moite d'une lampe voilée, au milieu de ses livres et de ses collaborateurs, son visage a un relief saisissant et ferme, qu'arrête brusquement un front très étroit. Ce masque de bois dur est illuminé par des yeux d'une étonnante douceur, profonds et naïfs à la fois. Et cette douceur, si étrange chez c e doctrinaire redoutable, se retrouve dans l'accueil amical, dans les gestes affectueux, dans la voix qui explique posément, qui insinue, suggère et qui s'élève à peine pour les inflexions les plus rudes. Voix qui fait songer au style même de M. Maurras qui, dans la plus véhémente invective, garde la ligne nette et sereine. Visiblement, une satisfaction intime emplit M. Charles Maurras, la satisfaction d'un anachorète qui a trouvé la vérité, qui ne respire que par elle, y habite comme en un vase clos, et dans laquelle il trouve toute sa raison et toute sa joie de vivre. Cette vérité, on la sent pour lui indiscutable, infrangible, absolue. Dès notre première question, il la pose comme un axiome : -Les élections ! s'écrie-t-il, le plus tard possible, certes ! Vous pensez bien que je n'en voudrai jamais pour mon pays. On sait ce qu'elles valent ! Les meilleures Chambres n'engendrent que des catastrophes. La plus grande toutes, l'Assemblée nationale de 1789, conduisit à l'émeute, à la Terreur et à l'invasion; l'Assemblée nationale d e1848, composée en majorité de catholiques et de royalistes, aboutit au Deux-Décembre, et le Deux-Décembre à Sedan; l'Assemblée nationale de 1871, en majorité conservatrice, nous a donné le septennat, c'est-à-dire la république, et vous savez ce que j'en pense ! La législature de 1885 (deux cent conservateurs) nous valut le boulangisme, une crise présidentielle, le scandale Wilson, les amorces du Panama; la bonne Chambre de 1893 fit naître l'affaire Dreyfus. Enfin, le 16 Novembre 1919 nous a donné le Bloc national ou la faillite de quatre cents bonnes volontés.
La réponse est caractéristique. Aucun jugement de M. Charles Maurras n'est basé sur l'actualité seulement. Il a tant médité sur l'histoire, elle a tellement inspiré ses thèses, ou - à ce qu'assurent ses adversaires - il l'a tellement pliée à ses théories, qu'il ne peut envisager les évènements quotidiens qu'en liaison et corrélation avec le passé. Une chaîne ininterrompue, un faisceau noué à travers les âges, voilà comme se présente à lui toute question. Et sa vaste mémoire, son étonnante lecture, sa puissance rationnelle et dialectique lui permettent d'en jouer incomparablement. Mais nous voulons une opinion plus précise sur le moment et demandons : - Pourtant, puisqu'il faut admettre la date comme inéluctable... - Si, pour le malheur de la France, il y a des abstentions, notre rôle, à nous, royalistes, est d'y corriger par notre présence, par notre appui incessant au bien, par notre opposition radicale au malles ridicules effets. Notre supériorité est de ne pas croire à la règle du jeu et de tenir ce jeu pour abominable. Du reste, j'ai toujours voté. Mais j'ai mal débuté dans ce mauvais métier : j'avais vingt-et-un ans aux élections de 1889 et j'étais électeur dans le cinquième arrondissement. Devinez qui j'ai nommé : le juif Naquet ! Ô beauté de la discipline boulangiste ! - L'Action française aura-t-elle de nombreux candidats ? - Nous présenterons des listes dans tous les secteurs de Paris et quelques autres en province; en 1919 nous avions perdu beaucoup de monde à la guerre. Nos cadres surtout avaient été éprouvés : trois mille hommes d'élite, la fleur de notre jeunesse de l'Action française, avaient disparu. Je ne parle pas du chiffre total des morts royalistes. Je compte les meilleurs, en qui nous avions placé nos espoirs, pour le succès immédiat de nos idées.
Une soudaine tendresse détend l'austère visage. Il semble que M. Maurras parle de ses fils les plus chers. Avec fierté il ajoute : - Eh bien ! Ceux qui les ont remplacés aujourd'hui sont dignes d'eux. Nos cadres sont reformés. Ils ont la même foi, la même intelligence, le même courage indomptable : c'est de la bonne graine de chefs. Vous les verrez à l'oeuvre dans toutes les mêlées, même électorales. - Espérez-vous gagner des sièges ? - Je ne veux pas faire de pronostics. Je n'en fais jamais sur ce terrain-là. Mais nous sommes en ce moment dans une période de souscription. Je dépouille chaque jour beaucoup de lettres de souscripteurs. Il est curieux de constater les sentiments passionnés, les arguments solides, neufs, - tirés de l'expérience - que des correspondants souvent inconnus invoquent pour venir à nous. Beaucoup disent : "Vous avez raison. Vous aviez prévu ce qui arrive." Il y a une vague de mécontentement sur le pays. Les gens sensés savent bien que ce n'est pas la révolution qui changera les choses à leur avantage. Ils se tournent vers nous, réactionnaires, hommes d'ordre et d'autorité. - La crise de régime, que beaucoup dénoncent, vous paraît donc comme évidente ? Un léger haussement d'épaules atteste l'inutilité de notre question. Pour M. Maurras elle est depuis si longtemps résolue qu'il lui semble un peu ridicule même de la poser. La réponse vient abondante, facile. Comme toutes les opinions de M. Maurras, elle fait partie de son système intellectuel si bien agencé que toutes ses parties se commandent l'une l'autre et s'entraînent dans un mouvement qu'on dirait automatiquement réglé. - Le malaise s'aggrave chaque jour, dit-il, mais la crise elle-même n'a pas cessé d'exister depuis que la France est ne république. La démocratie est, par définition, un régime de crise, de secousses, de spasmes, d'ailleurs suivis de lourds comas. Elle a créé une atmosphère de rivalité et d'ambition où s'étiolent les efforts courageux et honnêtes, où s'épanouissent les forces négatrices de la patrie et de l'État. Toute la masse du régime est tendue et systématisée pour empêcher le bien et pour sauver le mal. Ainsi la centralisation, qui empêche toute réforme et en faveur de laquelle il n'est pas possible d'invoquer aujourd'hui un argument sérieux, demeure à la base des institutions républicaines. Pourquoi ? Parce que, sans le mal centralisateur, il n'est pas d'élections possibles, et, sans élections, pas de démocratie : le parti au pouvoir serait sans défense contre les aspirations populaires s'il était privé des fonctionnaires qui, mués en agents électoraux et relevant directement de l'autorité centrale, sont contraints de mettre leurs influences et leurs crédits au service des partis qui les ont nommés. Voilà qui paralyse tout et qui empêche même toute économie. M. Maurras s'arrête, puis continue de ce ton plus doux et plus grave où l'on reconnaît tous les bâtisseurs de théories lorsqu'il les supposent réalisées. - Admettez un instant que notre équipe d'Action française change les bases du pouvoir. La monarchie peut faire son oeuvre : les communes sont affranchies, les nouvelles provinces reconstituées. Centralisation politique à Paris, décentralisation administrative au profit de chaque capitale des provinces. L'État se concentre, amis il abandonne tous ses monopoles étatistes, onéreux et encombrants. Il a la liberté de les vendre, de s'enrichir, d'alléger la contribution des particuliers. L'État n'a plus d'intérêt à être marchand de tabac, entrepreneur de téléphone, maître de postes, distributeur d'instruction publique. Tout cela retombe peu à peu au domaine privé. L'État ne conserve que les fonctionnaires d'État : en économisant sur le reste, il peut payer convenablement, largement ses diplomates, ses officiers et sous-officiers, ses juges, sa police. Enfin l'État, décongestionné, peut travailler en paix aux oeuvres de la vie nationale. - Ne croyez-vous pas que les masses sont profondément républicaines ? - Il fut une époque où c'était très vrai. Mon coin de Provence, par exemple, fut représenté pendant vingt-cinq ans au Parlement par Camille Pelletan. Un district voisin élisait Émile Brisson. J'ai connu des paysans pour qui la République était la Sancto, "la sainte". Aujourd'hui, la trace de cet enthousiasme est bien effacée. L'homme de la terre s'en moque, l'homme des villes est fatigué de la politique. À Paris, je cause parfois avec des ouvriers, des artisans des boutiquiers.
Comment ne pas évoquer, à ce moment l'image de M. Charles Maurras au milieu du petit peuple, et comment ne pas penser, devant ce disciple de la lumineuse Hellade, aux philosophes qui s'en allaient, eux aussi, sobrement vêtus, l'esprit curieux, recueillir les opinions des humbles bouches et tremper leur doctrine à la sagesse des simples. Et n'est-ce pas la maïeutique de Socrate que rappellent les propos qui suivent : - Le boucher me dit : "Moi, je ne tiens pas plus que ça au régime actuel", cependant il ajoute : "Mais est-ce que le peuple accepterait un roi ?" Si j'interroge son garçon, celui-ci tient exactement le même raisonnement : lui n'est pas démocrate, ni républicain, mais le peuple ne l'est-il pas ? Je me réponds tout bas : "Où est-il ce peuple républicain ?" À chaque degré de la hiérarchie sociale apparaissent le même détachement du régime et la même crainte que la désaffection ne soit pas unanime. D'où l'on peut conclure que le Français est indifférent, qu'il redoute vaguement que son voisin tienne encore à l'idole démodée. - Si la monarchie s'instaurait en France, les attributions du Parlement deviendraient-elles inexistantes ? - Inexistantes ! C'est beaucoup dire. Le Parlement cesserait d'être le souverain ou de représenter le souverain. Mais comptez-vous pour rien une masse d'affaires d'ordre intérieur, administratif ou fiscal qui serait de son ressort ? Un Parlement réorganisé, ou plutôt, à mon sens, subdivisé en de nombreuses Chambres, organiques et spéciales, aurait à jouer un rôle consultatif très important qui tiendrait en haleine les organismes nationaux et qui donnerait une impulsion à la bureaucratie. Il n'est que dans les grands problèmes vitaux, dont l'avenir du pays dépend, où j'estime que son action devrait être très limitée. Elle l'est en effet. On ne consulte vraiment les Chambres ni sur la paix, ni sur la guerre. Elles ratifient, elles enregistrent ce qui est en fait au-dessus d'elles. Eh bien ! il ne faut pas tricher, il faut dire les choses. Ni la masse, ni les représentants ne sont compétents sur les intérêts qui les touchent le plus. La masse ne sent jamais rien que l'immédiat, là où il faut prévoir. L'esprit public ne s'éveille que lorsqu'il est trop tard, - sous les coups - comme en 1914, quand la menace allemande, que l'Action française dénonçait depuis quinze ans, devient une épouvantable réalité.
Et voici que le système joue de nouveau. Ayant exposé le mal, M. Maurras donne le remède, et nous sommes ramenés au point de départ, qui est en même temps le point d'arrivée. - Le souverain-né, dit-il, est mieux placé. Il a, par sa position, le souci vivace de ses intérêts propres qui s'identifient ave ceux de la nation. Ses nerfs vibrent, sa raison s'alarme à des signes lointains. C'est son métier de s'émouvoir pour la maison qui est la sienne. Ce que l'inertie des masses et des assemblées ne sent pas, le réflexe normal qui s'opère chez le monarque l'en avertit. "Un roi de France n'aurait jamais signé le Traité de Versailles." - C'était un traité de coalition. Nous ne pouvions pas espérer que la volonté de la France triompherait sur tous les points. Un sourire léger, sans méchanceté, mais victorieux d'avance, passe sur les lèvres de M. Maurras. Il aime, on le sent, la contradiction, par ce qu'il se sent sûr de la réfuter. Ainsi devaient sourire les grands rhéteurs antiques, lorsqu'ils répondaient à d'inhabiles opposants. Et cette confiance imperturbable en sa propre doctrine a quelque chose à la fois qui émeut et inquiète. M. Maurras se recueille un instant, choisit dans son arsenal historique les armes les mieux fourbies et parle avec une force plus grande, car il touche à une idée qui lui est chère entre toutes : le démembrement de l'Allemagne. - Sans doute, réplique-t-il, mais il y avait des points vitaux où une action plus ardente, plus énergique, plus lucide l'aurait emporté. Voyez Talleyrand à Vienne. Il avait la partie moins belle, il était le vaincu. Il retourna l'Europe en se tenant bien à sa position. Nous ne nous sommes pas cramponnés à la nôtre, car nous n'en avions pas. En cédant l'unité à l'Allemagne, nous avons tout cédé. C'était le point où il n'y avait pas de transaction acceptable : l'avenir de la patrie était engagé. On dit : ce n'était pas possible ! Quelle fable ! Songez que l'Allemagne, depuis ses origines, a tenté cinq fois de réaliser son unité. Cinq fois elle a échoué. Le saint empire a toujours succombé en quelques lieux qu'il eut placé sa capitale : Rome, Francfort ou Vienne. Pourquoi le règne de Berlin serait-il plus durable ! L'Allemagne est un pays mal fait, composé de morceaux disparates, tiraillé entre les intérêts contradictoires. Il a fallu le fer et le feu pour les réunir. Et que de difficultés pour les tenir ! Rappelez-vous les embarras que trouva Guillaume II dans l'affaire des canaux de l'Elbe. Il fallut tout un jeu de concessions et de difficiles marchandages. Tout divise l'Allemagne. Il y a des intérêts qui la groupent, mais les forces centrifuges qui la disloquent sont autrement puissants. - Les derniers évènements de la Rhénanie sembleraient pourtant témoigner de la réalité de l'unité allemande. -Elle est réelle ! L'occupation de nos provinces de 1914 à 1918 était réelle aussi. On en a bien fini avec cette réalité. L'autre n'est pas immortelle ! D'ailleurs il faut savoir ce que l'on veut : quand on prétend s'abstenir de toucher à l'unité bismarckienne, il faut considérer les conséquences. Elles sont inévitables. Ce qui est unifié de l'Allemagne n'est pas tout le pays où résonne la langue allemande. Il faut dès lors prévoir d'autres mouvements unificateurs qui, après avoir réuni les pays d'Alsace et de Pologne séparés à Versailles, se continueront en Autriche, dans les pays baltes, en Suisse, aussi loin que va l'allemand. L'unité allemande est d'abord une idée qui va. Plus vous lui donnerez et plus elle prendra. Elle ne s'arrêtera dans aucune position intermédiaire. Notre politique a été lamentable sur la rive gauche du Rhin. Cela ne date pas de M. Poincaré. Il n'y a avait qu'une attitude : celle qui consistait à parler franc et à montrer au monde que notre politique était la seule politique de paix. Nous n'avons pas fait cela. Nous avons cru devoir ménager l'Angleterre et ne pas profiter de nos avantages sur Berlin. Nous avons laissé l'ordre et la force revenir en Allemagne et nous avons eu les massacres de Kaiserslautern et de Pirmasens. Nous avons obéré l'avenir par cette faiblesse. - Il y avait eu auparavant, en 1919, l'expérience de Kurt Eisner en Bavière qui n'était guère encourageante. - Parce que nous avons oublié ou méconnu les directives politiques de nos meilleurs gouvernements. Richelieu, en des cas semblables, soutenait en Allemagne l'anarchie protestante contre les catholiques du Sud et de l'Ouest. Que n'avons-nous aidé les bolchéviks bavarois de 1919 contre les nationalistes allemands ! L'occasion était bonne, il fallait la saisir. - Une chose qui surprend généralement l'opinion, c'est, étant donné le jugement que vous portez sur la politique rhénane de M. Poincaré, le soutien que l'Action française lui a prêté presque sans interruption depuis le début de son Ministère. M. Charles Maurras se lève, puis s'assied sur le bras de son fauteuil. Dans cette pose familière et penché vers nous, il explique ainsi cette contradiction : - Nous avons désiré ce Ministère. Nous avons aidé à le faire. Car enfin, avant lui, il y avait Briand ! Indépendamment des considérations morales tirées du passé de M. Poincaré, de l'unité de sa vie politique, nous l'avons soutenu encore comme compatriote et ami de Barrès, parce qu'il était un homme de l'Est mieux averti que d'autres de la menace allemande. Ces Lorrains qui voient périodiquement l'ennemi séculaire venir chez eux, piller leurs biens, dévaster leurs champs, massacrer femmes et enfants, canonner leurs cimetières, ont un sens plus aigu de ce danger-là que les autres Français. - Mais Clemenceau n'est pas de l'Est, et, sans lui, l'Allemagne n'eût pas été aussi facilement défaite. - Je le crois. Mais Clemenceau n'a pas eu la sensation du péril allemand, ni de la menace allemande, aux années d'avant-guerre : sans cela, comment expliquer la politique de son premier Ministère de 1906, 1906 à 1919 ? Elle nous désarmait presque autant que celle de Waldeck-Rousseau. La guerre venue, ou plutôt le pouvoir entre ses mains, il a fait la guerre admirablement, avec la lucidité, avec l'énergie d'une grande passion. Les souvenirs de 1870 se sont réveillés, l'émotion, l'irritation, la rage du vaincu. Mais ensuite, voyez : que d'illusions sur l'armistice, sur la paix, sur l'Angleterre ! À peine désabusé par l'attitude l'Angleterre, c'est vers l'Amérique qu'il se retourne ! Il avait su discerner la "noble candeur" du président Wilson, mais n'était-il pas encore tout imbu des "idées" de notre Victor Hugo ? - Ne vous semble-t-il pas que sa farouche énergie eût mieux servi le pays après la guerre que l'esprit juridique de M. Poincaré ?
Le regard de M. Maurras se fait plus vif, sa parole plus nuancée. Cette fois, il sort du domaine de la logique et de la dogmatique pour analyser des hommes. Il le fait en artiste, en quelques mots intenses et qui rendent un son plein : - Je ne sais pas, je ne crois pas. On peut tout attendre de Clemenceau. Mon opinion sur lui a souvent varié. Comme lui, parbleu ! Il est insaisissable, parce que nul ne peut prévoir les décharges de ce paquet de nerfs. À la fin de la guerre, ses réflexes ont servi glorieusement la cause nationale; après la guerre, ses mêmes réflexes l'ont desservie. Tant qu'il a senti la bataille, il l'a soutenue en héros. Quand il a senti la paix, il a tout sacrifié aux belles couleurs de l'aurore nouvelle, et c'est M. Poincaré qui lui donnait alors de bons avertissements. Quant à celui-ci, son tort est double : comme républicain, sa volonté devient chiffe sans consistance dès que le droit écrit ou le parti organisé lui impose une solution; comme Français, il a le tort de se représenter toute la France sur le modèle de la patrie lorraine. Il n'est pas possible à tous les Français de sentir comme ceux des pays envahis. Il me souvient du récit que que me fit Barrès d'une impression que lui donna un jour Poincaré. Barrès lui rapportait le mot d'un paysan provençal interrogé au cours d'un voyage. Ce paysan, bon patriote, mais éloigné par position du théâtre de la lutte franco-allemande, lui disait : "Pourquoi provoquer ainsi les Allemands ? Pourquoi nous en aller fourrager dans leur pays ? Est-ce que cela ne les fera pas revenir ?" À ces mots, à l'idée d'un Français du Midi moins éclairé qu'un Français de l'Est sur les conditions du problème allemand, le président du Conseil devint pâle d'étonnement. Cela m'a expliqué très nettement comment, en dépit de leur patriotisme, nos "princes lorrains" n'ont jamais rien compris au mécanisme de la part du combattant qui avait pour objet d'intéresser, d'associer, des Pyrénées aux Alpes, du Rhin à l'Océan, le camp entier de nos soldats à la possession de nos gages, aux maigres fruits de notre victoire. - Cependant le public a l'illusion qu'il y a a au pouvoir une volonté inébranlable. - Le public commence à craindre d'être déçu. La popularité de M. Poincaré a diminué et je le regrette pour mon pays. Quel malheur qu'il n'ait pas pris les avantages qui lui étaient offerts, cet automne, par la situation de l'Allemagne ! L'esprit juridique de M. Poincaré construit dans l'abstrait, sur des textes : Briand, qui ne sait rien, mais qui a des antennes, voit le réel, réel sale comme lui, et il choisit ses hommes. Pour le premier, les étiquettes et les individus ne comptent pas. Pot le second, il n'y a que cela qui compte. Il est à craindre que Briand n'ait M. Poincaré. - Et si la Chambre future a une majorité de gauche, quelle sera l'attitude des royalistes ? - Ils feront une politique nationale, conformément à l'ordre du prince : Tout ce qui est national est nôtre. Ils donneront leur appui à ce qui leur semblera d'intérêt national, ils le refuseront aux mesures qu'ils jugeront funestes à la sécurité et à l'intégrité du pays. - Et si, d'après eux, cette Chambre devenait un péril national pressant ? - Elle n'irait pas au bout de sa législature, elle sauterait ! - Voyez-vous, dans l'opposition de demain, quelque tempérament de chef ? - Tout le monde, j'entends tout le monde politique, s'attribue volontiers un don spécial, unique, pour conduire les hommes. Mais chacun ne le veut que pour soi.
Une brusque malice creuse aux commissures des lèvres la bouche de M. Charles Maurras, cette malice débonnaire qu'on voit paraître sur les visages tannées des paysans de Provence lorsqu'ils s'apprêtent à détailler une histoire amusante, et lentement, pour nous en mieux faire goûter la saveur, il commence cet apologue : - C'est la scène de Rabagas. Vous êtes trop jeunes pour avoir vu ou lu cela. Mais voici : les conspirateurs sont réunis pour élaborer le gouvernement du lendemain. Ils sont trois, se regardent avec admiration et pris du même élan : Bon ! un triumvirat... Mais à peine l'un d'eux est-il appelé au-dehors, ceux qui restent en scène haussent les épaules : Non, non, un consulat ! Et, comme ils oublient de sortir ensemble, le dernier revient sur ses pas, fait un grand salut au public : Enfin seul ! une dictature ! Un silence assez long, et, détachant les mots, M. Charles Maurras conclut : -Si l'on veut bien y réfléchir, il n'y a pas de plus grand argument en faveur de ce genre de monarchie, au titre héréditaire, qui élimine naturellement la compétition !
A travers les arguments et les digressions sociales, politiques, historiques, philosophiques, le leitmotiv monarchiste a développé sa courbe. Nous voici ramenés au point initial. M. Maurras, en virtuose, a bouclé la boucle.
--------------------------------------------
Ainsi s'achève le récit de la première visite à Maurras de Joseph Kessel et George Suarez, effectuée au siège central du mouvement royaliste, alors situé au 20, rue de Rome.
La seconde visite à Maurras de Kessel s'effectuera en solitaire, et, cette fois, non plus à Paris mais à Martigues, où Maurras prenait quelques jours de repos, chez lui, dans son "Martigues plus beau quez tout !" : accédant à la demande de Kessel de le rencontrer, Maurras le retiendra même à déjeuner : elle est racontée juste après celle qui précède, et surtout, dans le quotidien, comme on le verra dans la "Grande "Une"..." qui suit celle-ci.
Dans le petit livre d'art qui nous a servi, la première visite occupe dix-sept pages; la seconde en occupera dix-huit...